|
Section 03 du comité national de la recherche scientifique (des particules aux noyaux) |
Compte rendu
de la session d’automne
12/11 -
16/11 2002
compte rendu approuvé au cours de la séance spéciale
du 1er juillet 2003
Réunions précédentes et ordre du jour
Commissions interdisciplinaires (CID)
Titularisation des chercheurs stagiaires
Demandes de subventions pour écoles et conférences
Conférences, colloques, congrès
examens des laboratoires et des chercheurs affectés
examen à deux ans du PCC UMR 7553
renouvellement à 4 ans du CENBG
Evaluation à deux ans du GANIL
Examen à 4 ans de l’ISN Grenoble
Renouvellement à 4 ans de l’IPN de Lyon
Renouvellement à 4 ans du LAPP
Examen à deux ans du LPNHE Paris
examen à 4 ans du Centre de Calcul (CCIN2P3)
Directions de laboratoires en renouvellement
grandes collaborations : ALICE et AVAL du CYCLE
électronucléaire
Politique du ministère : présentation de B.Tamain
Organisation des concours 2003
Exposé de politique scientifique de la directions
scientifique.
Cas particuliers de chercheurs
Motion sur le renouvellement des directeurs de
laboratoires
Evaluation de la participation française à la
collaboration ALICE au LHC
Rapports des rapporteurs concernant les laboratoires
examen à deux ans du PCC UMR 7553
renouvellement à 4 ans du CENBG
Evaluation à deux ans du GANIL
Examen à 4 ans de l’ISN Grenoble
Renouvellement à 4 ans de l’IPN de Lyon
Renouvellement à 4 ans du LAPP
Examen à deux ans du LPNHE Paris
Membres de
la section
Jean-Pierre Barbe, Michel Baubillier, Robert Baumgarten, Monique Bex, Guy Coignet, Philippe Chomaz, Maryvonne De Jésus, Jacques Dumarchez, Alain Falvard, Robert Frascaria, Denis Jouan, Amel Korichi, Pierre Lutz, Stéphane Monteil, Jean Péter, Philippe Quentin, Alexandre Rozanov, Jean Pierre Thibaud
Direction scientifique[1]
Daniel Guerreau, Stavros Kastanevas, Elisabeth Le Marois, Guy Wormser
Secrétariat du comité national
Carmen Diop
Directeurs
de laboratoire[2]
P.Aguer, J.Chauvin, J.Colas, Y.Collot, Y.Declais, B.Haas,
Représentant
de la Mission Scientifique Universitaire [3]
B.Tamain
La section approuve le compte rendu de la réunion de printemps 2002 et de l’automne 2001, avec quelques remarques :
- Compte rendu d’automne 2001: A.Rozanov rappelle qu’il s’est prononcé contre le rapport concernant les grandes collaborations ATLAS et CMS.
- Compte rendu de printemps : ajouter dans le titre qu’en annexe se trouvent les résultats de concours
Fonctionnement de la section
Remplacement des deux démissionnaires : la décision officielle n’est pas sortie, 4 noms ont été proposés.
Au titre de la section, Jacques Lefrancois était membre du conseil scientifique de l’IN2P3 et Vanina Ruhlmann-Kleider était membre du conseil d’administration du département.
Jacques Lefrancois a accepté de participer au conseil scientifique qui se réunira début décembre.
Concours 1994 annulé
Concours 94 annulé : le conseil d’état, suite a une demande de L.Gonzales-Mestres, a sommé le CNRS de rétrograder les lauréats rétroactivement. Les candidats auront une feuille de paye négative fin 2002. le service dans la fonction de DR2 ayant cependant été fait depuis 1994, ils toucheront une indemnité compensatoire. Un arrangement a pu aussi être trouvé pour la personne partant à la retraite.
Budgets et postes
L’arrêté précisant les postes au concours n’est pas encore paru. Actuellement des discussions ont lieu a propos des Commissions InterDisciplinaires. Cependant le nombre de postes correspondant à la section 03 est approximativement connu : 10 postes CR et 7 postes DR2.
Les postes pourraient être répartis comme suit
- 6 postes DR2
- 1 poste DR2 pour Atlas à l’ISN
- 1 poste CR1
- 1 poste CR1 pour Antares au CPPM
- 6 postes CR2
- 1 CR2 : méthodes statistiques de traitement du signal et de l’image, traitement intensif et fusion des données, calcul distribué : applications aux projets de physique subatomique et des astroparticules (STIC)
- 1 CR2 pour ALICE à l’IPNO
De plus , le CSNSM recevra un poste de CR2 recruté par la section 19
pour le CID astroparticules, 1 poste DR2, 1 CR1 et 2 CR2 sont prévus, dont un des postes pourraient correspondre finalement à l’IN2P3. L’affichage est très large
·
physique fondamentale appliquée à l’astrophysique,
notamment, concernant la matière ultradense,
·
astrophysique nucléaire,
·
cosmologie théorique,
·
cosmologie observationnelle,
·
détection des phénomènes cosmiques de hautes énergies.
:
Ces chiffres seront a comparer globalement avec ceux de l’année dernière: 8 DR2 et 14 CR.
R.Frascaria demande quels sont les recrutements dans les autres sections.
D.Guerreau répond que si la discipline est une des plus mal servies, toutes les sections ont vu leurs recrutements baisser très fortement, à la suite des 137 postes supprimés au CNRS. On peut trouver cependant une certaine compensation dans les 200 possibilités de CDD qui sont ouvertes cette année, et auxquelles des Français peuvent postuler. Ce seront probablement des contrats de l’ordre de 18 mois.
D .Jouan remarque que l’année dernière un plan de recrutement pluriannuel avait été défini par le ministère pour le CNRS, de l’ordre de 200 postes de plus par an sur 5 ans. C’est donc une diminution de 357 postes. Dans le même temps on crée des CDD: il semble clair que la politique soit de remplacer les postes statutaires par des postes précaires. A terme de telles évolutions sur les statuts des personnels conduisent à la disparition du CNRS actuel, surtout que dans le même temps le comité national est marginalisé par l’administration.
Il est inquiet de l’évolution des effectifs dans les laboratoires IN2P3 dans les prochaines années. Si les chercheurs partaient à la retraite a 60 ans, on pourrait avoir 20% de baisse de l’effectif total dans les cinq prochaines années. Et tous les laboratoires ne seront pas touchés de la même manière. Par ailleurs avec une limitation stricte du rapport ITA/chercheur, ceci pourrait entraîner un effet sur les ITA qui pourrait désorganiser des services techniques.
Pour D.Guerreau on aurait une baisse plus faible, de 10% a la fin de la décennie, en fonction des extrapolations faites à partir des modalités des départs en retraite observés ces dernières années. P.Lutz rappelle que ces dernières années on a eu tendance à surestimer les départs.
A.Korichi demande que la section émette une motion.
M.De Jesus est inquiète de l’effet des affichages dans ce contexte de baisse.
D.Guerreau complète la description en rappelant que les activités de radiochimie sont importantes dans les laboratoires de l’IN2P3, et que ceci est reconnu par le CNRS. Pour la troisième année consécutive cette thématique bénéficie d’un recrutement, cette année un poste de chimie des solides, section 19, va être affiché pour le CSNSM, à la suite de discussions avec le département de chimie.
R.Frascaria rappelle que le futur du potentiel ITA est aussi une question cruciale pour celui de la discipline, et qu’un rapport a été produit par la direction de l’IN2P3, coordonné par JP.Reppelin.
Commissions interdisciplinaires (CID)
A la session de printemps on avait déjà fait le constat que le fonctionnement des concours interdisciplinaires n’était pas complètement satisfaisant à cause de leur composition qui limite le nombre d’experts des autres sections. La Directrice du CNRS a proposé de créer des commissions interdisciplinaires, qui ont le grand avantage d’être prévues par le statut actuel du centre. La CPCN s’est déclarée favorable à une solution plus légère que ces commissions, dont la géométrie était de plus contestée pour au moins 3 sur les 5 proposées. La CPCN a voté à l’unanimité contre ce projet de CID en septembre 2002. la situation est d’autant plus compliquée que le Conseil Scientifique, le Conseil d’administration et le Comité Technique Paritaire ont émis un vote favorable. Une réunion est prévue au ministère cette semaine à ce sujet[4].
Ce qui est prévu actuellement : des commissions de 21 membres, dont 14 à élire dans le comité national dans son ensemble, par les membres des sections du comité national concernés. Il n’y donc pas de quota par section concernée, ni même de limitation aux sections. Il s’agit d’une procédure très lourde.
La section 14 a émis une motion, elle soutient la création de la CID astroparticules, mais précise les limites des attributions de cette commission.
- Limite dans le temps : ce n’est pas un précurseur du redécoupage
- Limitation du rôle : exclusivement le recrutement, pas l’évaluation
- Pas d’évaluation d’unité en particulier
- Composition : puisque limité aux concours il n’est pas utile de désigner des élus C, par ailleurs 12 membres dans les trois sections concernées suffisent
- L’affectation doit être faite par la commission en accord avec le département concerné
P.Quentin remarque qu’il faudra tenir compte des postes astroparticules qui seront affectés par cette commission dans la distribution qui sera réalisée par la 03. D.Guerreau confirme que l’origine de ces postes se trouve dans les départements disciplinaires. J.P.Thibaud remarque que cette nouvelle structure va compliquer la vision générale, on crée une usine à gaz alors que l’on arrivait à gérer correctement les questions liées aux astroparticules. P.Lutz fait ressortir que des problèmes existent dans les situations générées récemment par des jurys de concours interdisciplinaires. Pour J.P.Thibaud dans le cas évoqué il n’est pas surprenant que le contexte pose problème, puisqu’il s’agissait d’un échange a priori. Pourquoi faire recruter par une autre section un poste d’expérimentaliste dans un laboratoire IN2P3 ? A.Falvard pense que c’est la gestion qui pose problème : il faudrait se limiter à la section concernée, ne pas rajouter d’extérieurs. Il faut éviter les solutions inutilement administratives.
M.Baubillier pense qu’il est important que les sections soient fortement associées au problème des affectations en général , ceci éviterait aussi en particulier que des sections ou des candidats ignorent délibérément le problème de l’adéquation du candidat au poste.
D.Guerreau reconnaît que les CID semblent une machinerie lourde, mais que c’est la seule solution réglementairement possible –le cadre de la fonction publique est rigide- pour tenter de résoudre les problèmes posés par la gestion de l’interdisciplinarité, dont on voit bien aussi qu’ils existent. Il faut réaliser un brassage plus grand. Pour J.Dumarchez, une commission interdisciplinaire aurait conduit dans le cas le plus récent à un simple échange de candidats, c’est à dire une solution profondément non interdisciplinaire. L’interdisciplinarité telle qu’elle se pratique actuellement n’apporte pas de moyens supplémentaires, on se borne à enlever des postes dans les sections disciplinaires pour les affecter à l’interdisciplinaire. J.Peter souhaite une solution intermédiaire, proche du fonctionnement actuel mais avec plus d’experts extérieurs dans les jurys de concours. P.Lutz précise qu’actuellement il y a une limite sur le nombre d’experts dans les concours, et rappelle qu’ils doivent appartenir au comité national.
En réponse à une question sur le sens du poste DR2 affecté au CID, D.Guerreau rappelle que c’est une demande de G.Berger d’avoir un affichage thématique très large (voir au dessus) pour les CID. Ce poste de DR2 a été rajouté par le comité de direction du CNRS. J.P.Thibaud remarque que ceci ne respecte pas ce qui avait été annoncé par la direction du CNRS : ces commission ne devaient s’intéresser qu’au recrutement de jeunes chercheurs.
Apres une discussion et une série de votes concernant le détail du texte, une motion a été votée (voir annexe).
Calendrier 2003
Les visites de laboratoires sont maintenant effectuées au printemps
Au premier semestre 2003, calendrier de la section 03 :
Session de printemps (visites de laboratoires) 17 au 21 mars
Auditions 13 au 16 mai
Jury d’admissibilité 26 au 28 mai
La titularisation arrive désormais plus tôt, après un an.
La section émet un avis favorable pour la titularisation de :
Christian FINCK UMR 6457 Nantes
Berrie
GIEBELS LLR Palaiseau
Arnaud LUCOTTE
LAL Orsay
Matteo BARSUGLIA
LAL Orsay
Gregory CANCHEL CENBG
Bordeaux
Jean Christophe HAMILTON ISN
Grenoble
Fairouz HAMMACHE IPN Orsay
Santiago PITA PCC Collège de France
Emmanuel SAUVAN CPPM Marseille
Edwige TOURNEFIER LAPP Annecy
Benjamin TROCME IPN Lyon
Pierre VAN HOVE IReS Strasbourg
Patrice VERDIER LAL Orsay
Karsten JEDAMZIK UMR5825 (SPM) Montpellier
Thierry AUGER UPR2801 (SC)
Vitry
A revoir au printemps 2003 :
Cristina CARLOGANU LPC Clermont
Affectation Directeur de recherche
F. DERUE ATLAS LPNHE Paris SCHWEMLING
M. KERVENO PACE IReS Strasbourg G.RUDOLF
N. LE NEINDRE SPIRAL IPN
Orsay M.F.RIVET
V. POIREAU BABAR LAPP Annecy J.P.LEES
N.REGNAULT CMS LLR Palaiseau P.BUSSON
P. ROBBE LHCb LAL Orsay O.CALLOT
J. STARK D0
ISN Grenoble G.SAJOT
R. TIEULENT ALICE IPN Lyon J.Y.GROSSIORD
D. VERNEY SPIRAL GANIL Caen F. DE OLIVEIRA
D.AUTIERO OPERA IPN
Lyon
D. BRASSE Biologie-Physique IReS
Strasbourg
K.
HAUSCHILD Structure Nucléaire CSNSM
Y. GALLANT Astr. Gamma GAM Montpellier
B.REVENU AUGER GReCO/IAP(SDU) N.DERUELLE
La section désigne un parrain pour suivre ce chercheur affecté dans un laboratoire hors IN2P3 : J.DUMARCHEZ
Dossier traité par la section :
G. DUBUS AUGER LPNHE Paris LETESSIER-SELVON
dans la 14 un parrain a été désigné : P.TUCKEY
Ecoles thèmatiques
Avis favorable pour
Physique du Tev au collisionneur les Houches
Physique des particules et cosmologie Cargese
Physique et astrophysique du rayonnement cosmique Orsay
du détecteur à la mesure Roscoff
Ecole de Gif Gif
Ecole Joliot Curie Maubuisson
Moriond gravitation Moriond
Moriond cosmologie Moriond
Moriond interaction électrofaible et théories unifiées Moriond
Moriond QCD et interactions hadroniques à haute énérgie Moriond
Conférences, colloques, congrès
Classement en deux groupes :
Groupe A :
PAVI0, from
parity violation to hadronic structure and more..
COMEX
IWM2003
international workshop on Multifragentation and related topics
Where
cosmology and fundamental physics meet
Rencontres
de Moriond
EEP03
international workshop on probing nuclei via (e,e’p) reaction
Journées jeunes chercheurs de la division champs particules matière de la SFP
Groupe B :
Congrès ALICE dimuons
JUAS (joint
universities accelerator school
EU Network (ondes gravitationnelles)
First
European Health Grid
Weak
interaction in nuclei and astrophysics: standard model and beyond
Le conseil de laboratoire a soutenu la solution finalement proposée : une équipe de direction.
J.P.Thibaud déplore que la section ne soit consultée qu’après coup
Pour D.Jouan ceci résulte cependant d’un processus complexe. La direction avait retiré sa proposition au printemps, mais l’a reposée pendant les vacances, tandis que dans le laboratoire il n’y a finalement pas eu une mobilisation très forte pour défendre une solution alternative, même si celle proposée par la direction avait été majoritairement mise de coté. Du coté de la section on en avait parlé à l’automne 2001 et la direction avait alors précisé que elle attendait des propositions. Le retard n’est donc pas uniquement du fait de la direction.
P.Chomaz insiste pour que, indépendamment du fond, la forme soit respectée.
P.Lutz regrette que au niveau de la lettre du département on ait parlé de nomination du directeur, alors que la section n’avait pas encore donné son avis et que le bureau avait expressément précisé que il fallait attendre cette décision, même si compte tenu de la situation créée par cette discussion qui durait depuis un an, des mesures transitoires pouvaient être prises pour mettre en place la solution à laquelle le conseil de l’IPN avait apporté son soutien.
Au niveau du laboratoire, l’ancien directeur avait d’ailleurs évité de parler de nomination, mais seulement de prise de fonction.
R.Baumgarten et R.Frascaria estiment que, quelles que soient les justifications invoquées, on est obligés de constater que la section est toujours consultée après coup, ce qui est inadmissible.
P.Quentin suggère que, de façon générale sur ces questions, la direction de l’in2p3 envisage de se doter d’un calendrier.
J.P.Barbe remarque que la notion d’équipe de direction aura un sens effectif, notamment parce que la division de la recherche et sa direction participeront fortement à la définition de la politique scientifique.
J.Dumarchez se demande néanmoins comment le refus initial a pu se transformer en acceptation.
Finalement la section a émis un avis favorable sur la nomination de D.GUILLEMAUD-MUELLER à la direction de l’IPN
(8 oui, 3 non, 3 abstentions, 4 refus de vote)
Par ailleurs une motion concernant la procédure de renouvellement des directeurs de laboratoire a été votée (voir annexe)
Certains chercheurs ne font pas leur rapport. On s’interroge sur la manière d’insister aupres de ceux qui ne réagissent pas au rappel: faut il passer par le directeur de laboratoire ? Pour conserver l’indépendance du fonctionnement du comité national, alors que les propositions de l’administration du CNRS vont dans le sens de diminuer ses prérogatives au profit des directions de département et de laboratoire, peut être est il préférable de développer plutôt les contacts directs avec la section.
Pour les renouvellements de directeurs, on constate certains problèmes pour arriver à ce que le processus se passe correctement au niveau des consultations des instances, en particulier celles des conseils de laboratoires. L’IN2P3 devrait insister auprès de ses directeurs pour que ceux ci respectent bien les procédures (voir motion).
Les compensations des astreintes ont été plusieurs fois évoquées, soit pour les charges importantes qu’elles pourraient peut être entraîner si le nouveau cadre était accepté pour les ITA au CNRS, soit pour les disparités – qui peuvent être acceptées par les personnels concernés - dans les habitudes actuelles, soit pour les limitations qu’elles imposent dans le suivi technique de dispositifs expérimentaux. Une réflexion est d’ailleurs en cours au niveau du CNRS, les directeurs de laboratoires ont été interrogés.
La question du futur des recherches fondamentale en physique nucléaire a été plusieurs fois posée en constatant qu’un déséquilibre tendait à se former entre les équipes travaillant sur des thématiques appliquées liées à l’énergie thermonucléaire, qui bénéficient de recrutements, et celles travaillant sur la physique nucléaire fondamentale dont l’existence pourrait être menacée par de prochains départs en retraite. Or l’existence d’activités appliquées n’est possible à terme qu’en s’appuyant sur des activités fondamentales, et il faudrait veiller à ce qu’une situation déséquilibrée ne s’instaure pas par excès de priorités ou par manque d’anticipation.
Le colloque de prospective de l’IN2P3 à Giens a bien montré qu’un futur était possible et souhaitable pour des faisceaux stables.
Une discussion a eu lieu plusieurs fois sur les limites de la sphère d’intérêt de la section, certains militent pour une définition plutôt exclusive du type « ce que la direction de département et les directions de laboratoires ne font pas déjà », d’autres considèrent que les sections du comité national ont vocation à s’intéresser à tout ce qui a effet sur les activités des chercheurs.
Un problème récurrent est la communication entre les personnes et l’ambiance de travail. La section est-elle compétente pour s’intéresser à ces questions ? Mais sinon qui est compétent ?
Faut-il s’intéresser à la structuration des équipes dans les laboratoires ? Faut-il favoriser les regroupements ? Mais n’est ce qu’une affaire d’organigramme pyramidal ? il semble y avoir un certain consensus que quoi qu’il en soit il n’est pas efficace de brusquer les évolutions.
Dans les mois qui viennent il y aura une discussion concernant l’avenir des participations à D0 et l’articulation avec les participations au LHC.
L’IN2P3 est passé à une gestion centralisée pour les visiteurs étrangers, c’était alors pour résoudre un problème légal, mais il semble que maintenant la direction générale encourage les labos à proposer directement des dossiers.
Dans certains endroits (CCIN2P3, LLR) les personnels techniques sur statuts précaires (CDD) se sont multipliés.
examen à deux ans du PCC UMR 7553
Le PCC est un laboratoire très dynamique, très équilibré compte tenu des choix scientifiques formant un ensemble cohérent, concentré sur la physique hors accélérateurs.
La production scientifique du laboratoire est excellente dans tous les domaines de recherche abordés. Les axes de recherche sont tous tournés vers des sujets d’avenir avec un important potentiel de découvertes. Néanmoins, on peut noter la perturbation occasionnée par l’arrêt de GLAST au sein du laboratoire. L’arrêt de l’expérience HELLAZ a également marqué les personnes concernées mais le travail de R&D, lourd, fait l’objet d’un transfert de technologie vers le DAPNIA dont l’accord a été signé.
Nous avons remarqué un impact visible et important au sein des diverses collaborations nationales et internationales qui se traduit en un nombre important de stagiaires et thésards.
Tout ceci mérite que l’on félicite le laboratoire.
Pour l’avenir à court terme la gestion des modifications d’implantation dans les locaux du laboratoire du Collège de France devra se faire de façon à ne pas entraver les activités de recherche.
A l’horizon 2005 le laboratoire envisage de façon résolue son avenir dans le projet APC dans le cadre d’un partenariat élargi avec l’Université Paris VII, l’INSU et le CEA.
Dans l’état actuel du projet un Plan Pluri-Formation (PPF) a été mis en œuvre et ceci constitue une des deux origines budgétaires de la fédération ( la seconde étant en provenance des départements CNRS et CEA). Une partie du personnel déplore le manque de transparence et de concertations entre le conseil de laboratoire et la direction de l’APC.
Malgré le caractère exemplaire de la démarche entreprise, le comité souligne le réalisme avec lequel cette perspective doit être envisagée. Il n’apparaît pas de problèmes insurmontables mais un des points centraux sera à l’évidence le potentiel technique de la future unité à Tolbiac.
renouvellement à 4 ans du CENBG
Le Centre d’études nucléaires de Bordeaux-Gradignan donne une remarquable impression de mouvement et de dynamisme. Les succès importants qui ont été enregistrés ces dernières années dans les différents groupes de physique (grâce à un support technique de qualité) placent ce laboratoire, petit par la taille, à un excellent niveau au sein de l’IN2P3. Il doit être remarqué que cet excellent niveau est obtenu en dépit d’un soutien de base par équipe qui nous paraît inférieur à celui dont peuvent bénéficier d’autres laboratoires du même genre.
Une caractéristique importante du laboratoire est d’être à la fois très engagé dans les thématiques soutenues par l’IN2P3 (aval du cycle, noyaux exotiques, physique du neutrino, astronomie g de haute énergie) et également fortement intégré dans le paysage universitaire et régional à travers des recherches de type plus interdisciplinaire (physique avec des lasers de puissance, interface Physique Biologie, faibles radioactivités) Ceci nous paraît être un atout très fort pour le laboratoire, atout qui doit être préservé et même développé.
Les équipes travaillant sur des thématiques plus spécifiquement IN2P3 sont remarquables, leurs perspectives pour les quatre ans à venir sont claires, elles doivent être soutenues aussi fortement que possible.
Pour les autres activités, nous émettrons trois recommandations :
- L’opération AIFIRA nous parait très importante par la qualité des objectifs de physique, par son aspect pluridisciplinaire et par l’ancrage qu’elle représente pour le laboratoire au niveau universitaire et régional. Cette opération est bien partie, les moyens du laboratoire ne doivent pas manquer pour qu’elle soit une réussite
- La physique autour des lasers de puissance que développe une des équipes du laboratoire, avec le soutien fort de l’Université, nous parait originale et riche de promesses. Elle représente une certaine prise de risque scientifique qui nous parait pouvoir être soutenue par l’IN2P3, après examen scientifique par les instances compétentes.
- Le développement de la spectroscopie g à très bas bruit de fond par deux chercheurs du laboratoire a été indispensable. Elle a par ailleurs donné lieu localement à des développements pluridisciplinaires originaux. Il serait important de trouver rapidement une solution pour que cette expertise ne disparaisse pas.
- L’équipe de physique théorique doit être à terme renforcée pour que ne disparaisse pas un support indispensable au rayonnement de la discipline et à son enseignement
Evaluation à deux ans du GANIL
Le GANIL joue pleinement le rôle qui lui est demandé: il délivre les faisceaux d'ions lourds que la communauté des physiciens de cette discipline attend. Il développe et réalise les accélérateurs et les lignes de faisceaux qui résultent des projets des physiciens et des décisions des autorités de tutelle en respectant les cahiers des charges et les délais qui lui sont impartis. Il participe et intègre les grands ensembles expérimentaux jusqu'aux acquisitions de données qu'il standardise.
Le GANIL affirme son ouverture pluridisciplinaire avec le CIRIL et le secteur biologique a travers deux équipements: -une ligne basse énergie -IRRSUD- utilisable en permanence et une structure d'accueil pour la radiobiologie
Le parc d'accélérateurs et de lignes de faisceaux augmentant, le personnel permanent restant a peu près constant ,l'emploi du temps associé au nouveau régime des 35 heures posant des problèmes d'organisation du temps de travail-en particulier pour ce qui concerne les astreintes nécessaires à une bonne exploitation des installations- il est à craindre une surcharge de travail qui ne puisse être assumée par un personnel très impliqué dans ses tâches et dans la démarche qualité qu'il y associe. Ce personnel souhaite participer efficacement au projet SPIRAL phase 2, pour lequel un Avant Projet Detaille est demandé pour l'été 2003.
Les responsables tant au niveau Direction qu’au niveau des services se plaignent de la lenteur des réponses et parfois de la non-réponse de l’IN2P3 sur des points qui font problèmes, comme les astreintes , les promotions, les postes , les 35 heures .
Une réflexion plus générale concerne le statut présent de GIE du GANIL qui arrive a son terme en 2006.Cette réflexion n'est pas indépendante de l'étude en cours d'une installation européenne de seconde génération de type ISOL (EURISOL) que coordonne le GANIL et que la communauté GANIL verrait avec plaisir s'installer a Caen vers 2010 et devenir ainsi le Laboratoire européen pour la physique des états extrêmes de la matière nucléaire .
Examen à 4 ans de l’ISN Grenoble
Suite à l’examen qu’elle a fait de l’Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble, la section 03 du Comité National tient à féliciter l’ensemble de ses personnels pour la qualité de l’activité scientifique du laboratoire et pour le dynamisme qu’il démontre.
Pour ce qui concerne la physique des particules, on doit noter le beau succès de l’entreprise lourde engagée dans ATLAS et les choix judicieux faits lors de l’implication dans D0. Ceci laisse présager un bon impact dans l’analyse des données de LHC, une fois l’ensemble des forces regroupées.
L’ISN de Grenoble a su ouvrir très rapidement et avec une grande réussite un axe de recherche en astroparticules. Le petit groupe AMS devrait sans doute être consolidé par le recrutement d’un chercheur CNRS afin d’aborder dans les meilleures conditions l’analyse des données après avoir bien contribué à la construction de l’instrument et travaillé activement à la préparation de la physique. Le groupe de cosmologie a joué un rôle très important dans l’expérience Archeops et a tous les atouts pour faire de même dans Planck si on veille bien à maintenir son potentiel de recherche. L’évolution du groupe neutrino vers le projet EUSO est prometteuse.
Le programme de physique nucléaire s’articule autour du groupe de physique des réacteurs et du programme de physique hadronique ; les activités de structure nucléaire sont en diminution. Le programme de physique hadronique, réalisé à GRAAL et à JLAB, est d’une grande visibilité au niveau international. Son évolution à l’horizon 2005 est bien balisée. La section fait confiance aux physiciens de ce domaine qui abordent une réflexion ouverte pour qu’ils convergent au meilleur moment dans le choix de leur implication pour l’avenir. Le programme sur l’aval du cycle et la physique des réacteurs est également un engagement clef de l’ISN où s’expriment en particulier très bien les compétences du laboratoire en matière d’accélérateurs. L’implication sur les réacteurs à sels fondus est sans aucun doute un programme d’avenir. La section recommande toutefois que ne soit pas abandonné le travail très important sur l’aval du cycle. Le maintien de l’activité de structure nucléaire qui a une très bonne production scientifique est souhaitable en soi et pour le programme électronucléaire à l’ISN.
L’avenir du groupe de physique théorique se trouve sans doute dans le développement des contacts interdisciplinaires dans son domaine de compétence actuel et dans une ouverture de ses axes de recherche pour embrasser plus largement les activités expérimentales du laboratoire et de l’IN2P3.
La valorisation a également une place de choix à l’ISN de Grenoble. Le laboratoire sait très bien réinvestir ses acquis dans ses divers domaines de compétence, en instrumentation et en physique des accélérateurs notamment. C’est le cas en particulier pour l’interface physique-médecine et dans le domaine des sources d’ions.
La présence forte de l’ISN auprès de l’Université et de l’INPG doit permettre le maintien en son sein d’une composante solide d’enseignant-chercheurs de notre secteur disciplinaire sur le campus grenoblois.
Premier examen à 4 ans du GAM
Le Groupe d’Astroparticules de Montpellier a été crée à compter du 1er Septembre 2000 par le CNRS comme Formation de Recherche en Evolution (FRE 2276) avec l’appui de l’Université Montpellier-2 (UM2). Depuis Janvier 2001, le GAM est une Unité Mixte de Recherche (UMR 5139) associant l’IN2P3/CNRS et l’université de Montpellier-2. Le GAM est dirigé depuis sa création par M. Alain FALVARD.
Le GAM est un laboratoire jeune et très dynamique. Ses choix scientifiques sur l’exploration de l’univers avec les photons de hautes énergies forment un ensemble cohérent. On peut noter la grande ouverture du laboratoire sur le monde extérieur, un nombre exceptionnel de stagiaires et doctorants.
La production scientifique du laboratoire est sur une bonne pente ascendante. Les axes de recherche sont prometteurs à court et à long termes. Les groupes du GAM sont visibles, ont un impact important au sein des collaborations CELESTE et AMS. Les physiciens du GAM abordent très sereinement les prospectives du laboratoire après la fermeture programmée de CELESTE en 2004.
L’évolution des relations avec l'Université Montpellier-2 est très bonne. Le renforcement des liens avec UM2 par des postes de professeur et de maître de conférence est très souhaitable, surtout compte tenu du nombre d'étudiants en stage et de doctorants dans le laboratoire. Le souhait des physiciens de renforcer par les prochains recrutements le profil physicien-expérimentateur semble très raisonnable.
La commission félicite l’ensemble du laboratoire pour son dynamisme, la qualité de ses recherches et sa grande ouverture vers le monde extérieur.
Examen à deux ans de l’IreS
Un hommage a été rendu à la mémoire de J.P.Vivien, décédé brutalement en 2002.
Avis de la section sur le laboratoire :
L’examen de l’IReS s’est déroulé dans un contexte particulier découlant de la perspective de l’arrêt du Vivitron fin 2003. Malgré la tension générée par cette décision et la difficulté d’accepter l’arrêt d’un appareillage dont l’optimisation avait nécessité beaucoup d’effort et qui atteignait son meilleur niveau, les intervenant ont fait preuve d’une responsabilité qui a impressionné les représentants de la section, en étudiant des solutions pour l’avenir y compris dans le domaine des faisceaux stables en physique nucléaire. Cet examen faisait suite aux journées de Giens sur la prospective de la discipline aux cours desquelles les projets pour la physique nucléaire sont bien apparus, projets dans lesquels l’IReS a toute sa place et pourrait y avoir un rôle de premier plan. Suite souvent à des départs, en particulier en retraite, un certain nombre d’équipes se révèlent réellement sous critiques en physiciens, comme Nemo, ou Alice, et ce phénomène va continuer. La nécessité de choix s’imposera à brève échéance, ce qui imposera de définir des priorités qui devront s’attacher a préserver les projets majeurs du laboratoire. L’évolution des problématiques ou des techniques impose désormais d’envisager les projets au niveau européen et d’y être parmi les premiers. Là est certainement la voie pour l’IReS. Cependant une activité de Recherche et Développement locale, et éventuellement de Construction de masse doit être soutenue afin que la place de l’IReS sur le campus de Cronenbourg et vis à vis de l’ULP soit bien visible et reconnue comme lieu d’excellence. Parallèlement le programme du Vivitron sera mené à son terme dans les meilleurs conditions. Le reclassement et la formation du personnel ne pourra intervenir qu’après l’échéance de fin 2003.
La commission entend souligner l’évolution positive et remarquable du groupe CMS et d’une manière générale de l’ensemble des activités du Département « Quarks, leptons et noyaux chauds ». L’arrivée récente de F. AZAIEZ à la tête du Département « Physique du Noyau et Aspects Pluridisciplinaires »doit être considérée comme un élément très positif en faveur du dynamisme des équipes, bien que l’on puisse souhaiter très fortement plus de sérénité dans les rapports humains. Un élément important pour aider à ce qu’il en soit ainsi serait de spécifier clairement quelles sont les responsabilités qui sont dévolues au Directeur Scientifique du Département. Le rôle moteur de D.HUSS est reconnu dans ses efforts pour faire évoluer l’ensemble du laboratoire, de clarifier ses objectifs et d’accroître les relations avec les instances régionales. Toutes les structures du laboratoire doivent maintenant travailler solidairement à la construction du futur du laboratoire, qui s’annonce prometteur étant donné les compétences en présence et les nombreuses perspectives de recherche ouvertes.
La commission soutient l’IReS qui fait face à des défis en particulier en physique nucléaire. Il possède des atouts en particulier en moyens humains y compris ITA. L’IN2P3 doit apporter une attention particulière à ce laboratoire qui va évoluer rapidement.
Renouvellement à 4 ans de l’IPN de Lyon
L’IPNL est un laboratoire très fortement lié à l’université qui conduit depuis longtemps une grande variété de recherches en physique subatomique.
Le laboratoire a souffert de nombreux départs de personnels techniques et chercheurs dans les dernières années mais a su conserver une production scientifique de grande valeur. Des résultats de tout premier plan ont été obtenus ces quatre dernières années dans beaucoup de domaines.
La politique scientifique du laboratoire, à la fois en matière de recrutement et d’arbitrage dans la distribution des soutiens techniques aux expériences nous apparaît équilibrée et susceptible de permettre au laboratoire de tenir sa place au sein des grands projets dans lesquels il est impliqué.
Les évolutions engagées sous la précédente direction, poursuivies par la direction actuelle et portées par les personnels vont dans un sens que le comité juge très positivement. Le rapprochement des groupes de physique nucléaire, la redéfinition des missions des services techniques ou encore la convergence affirmée des thématiques de recherche du groupe théorie vers les problématiques expérimentales du laboratoire en sont autant d’illustrations.
Quelques points liés à la multiplicité des expériences requièrent selon nous une attention particulière dans un futur proche. L’évolution naturelle de l’activité Supernovae vers l’expérience SNAP, tout comme la participation au Run IIb du Tevatron, mériteront un examen attentif au regard des disponibilités en personnels techniques et chercheurs. Le rapprochement affirmé des groupes de physique nucléaire expérimentale doit se poursuivre et trouverait une traduction dans une phase intermédiaire de recherche et développement instrumentale. Enfin, dans le contexte délicat de la collaboration CMS et singulièrement, dans un passé récent, de la calorimétrie électromagnétique, le comité a apprécié le travail de l’équipe et souhaite que la direction continue d’accompagner l’évolution du projet.
Le comité a par ailleurs particulièrement apprécié le virage réussi de l’équipe impliquée dans la trajectographie de CMS après l’abandon par la collaboration de la solution MSGC. Il félicite le laboratoire pour le dynamisme qu’il manifeste dans ses recherches pluridisciplinaires, en particulier dans les domaines des agrégats d’hydrogène et des effets biologiques des radiations, des études de canalisation, de l’aval du cycle et des applications médicales.
Renouvellement à 4 ans du LAPP
Le LAPP est un laboratoire très dynamique. La transition
vers l’après LEP s’est très bien passée.
Les priorités scientifiques affichées par le laboratoire ont
permis à l'équipe ATLAS de mener à bien ses engagements, et à l'équipe VIRGO
d'aboutir aujourd'hui à la phase de commissionning de l'expérience. Par
ailleurs il faut noter que l'ensemble des groupes du LAPP ont un impact visible
et important dans les collaborations.
Les relations entre les groupes de physique et les groupes
techniques sont coordonnées de façon satisfaisante. Le laboratoire a su tisser
des liens avec les partenaires locaux qui permettent de fructueuses
coopérations (LAPTH, ESIA, Université). La section 03 soutient vivement le
projet de structure d'accueil LAPP-LAPTH, qui permettra de former et de
préparer des physiciens français à l'arrivée des données LHC et de renforcer
des échanges avec des phénoménologues en France.
Nous félicitons le laboratoire pour la qualité du travail de recherche qui se traduit par un fort taux d'accueil de stagiaires et doctorants, ainsi que pour son implication dans la diffusion de la culture scientifique.
Examen à deux ans du LPNHE Paris
Le LPNHE Paris VI,VII confirme, comme il avait été remarqué lors de la visite précédente de la commission 03, qu’il est un très bon laboratoire regroupant du personnel de qualité. Il est engagé à la fois dans des programmes de physique sur accélérateurs (Babar, Harp, D0, ATLAS , Lin Coll.) et hors accélérateurs ( Auger, Supernovae, HESS) dans lesquels il a des contributions significatives et parfois prépondérantes . Le programme est bien équilibré entre expériences en prise de données, qui démarrent ou en préparation. Ces expériences attirent un nombre important de doctorants , ce qui est aussi certainement dû à la très grande implication des Enseignants-Chercheurs au niveau des DEA des Universités Paris VI et VIII. Un problème éventuel pour le long terme pourrait peut être venir de la grande dispersion géographique des sites expérimentaux des expériences auxquelles le LPNHE participe et on devra être y attentif dans le futur.
Les services techniques , malgré le grand roulement du personnel de ces dernières années , ont fourni des contributions de qualité et ont assuré leurs responsabilités. Les effectifs sont revenus, grâce à l’aide de l’IN2P3 à des niveaux corrects. Il faudra toutefois anticiper les départs à la retraite qui se profilent.
Enfin , la création de l’APC
–Tolbiac qui avait suscité des craintes ne semble pas poser de problème
actuellement. Il est souhaitable que la
“ mutualisation “ partielle des services de mécanique qui se
pratiquait avec le PCC soit poursuivie avec l’APC.
examen à 2 ans du LLR
Le
LLR est un laboratoire au programme scientifique bien équilibré, aux équipes
dynamiques et aux responsabilités importantes. Les moyens techniques sont en
bonne adéquation avec les besoins des expériences.
Parmi
les questions repérées comme devant être surveillées par le précédent examen,
la structure du groupe d’électronique est maintenant bien établie et reconnue
et son fonctionnement s’en trouve apaisé.
Par
contre la nécessité d’au moins un poste supplémentaire d’administratif est plus
que jamais vérifiée. Le faible nombre de doctorants persiste et affecte presque
tous les groupes : il nous semble qu’une démarche doit être entreprise et
maintenue dans la durée pour espérer inverser cette tendance. Enfin le problème
du statut des personnels de l’École Polytechnique doit absolument trouver une
solution acceptable.
examen à 4 ans du Centre de Calcul (CCIN2P3)
La section 03 félicite le CC-IN2P3 pour l’ampleur et la qualité des services rendus aux expériences et laboratoires de l’IN2P3 et du DAPNIA. Elle note avec satisfaction l’effort d’équipement adapté aux besoins spécifiques de la discipline et félicite la direction et le personnel du Centre pour leur réactivité et leur réussite dans l’adaptation des moyens pour une croissance de la capacité de calcul d’un facteur deux par an.
La section 03 apprécie la mise à disposition de services variés, tant internes qu’externes, et encourage le Centre à poursuivre ses ouvertures.
Néanmoins, certaines difficultés ne doivent pas être négligées :
· Budget : les ressources proviennent presque exclusivement des dotations du CNRS (~75%) et du CEA. Les évolutions du CC-IN2P3, liées aux grandes expériences actuelles et futures, nécessitent des budgets supérieurs aux allocations actuelles.
· Personnel : la croissance des services demandés au Centre n’a pu se faire que grâce à une assez forte augmentation des CDD. L’effort de titularisation de ces CDD entrepris depuis quelques années est positif et doit être poursuivi. Le CC-IN2P3 a besoin que l’IN2P3 poursuive son soutien en matière de postes statutaires.
· Ouverture : La culture informatique de nos domaines de recherche peut servir d’autres communautés, et inversement. Une telle ouverture doit se faire en respectant des conditions vis à vis des utilisateurs actuels.
·
Communication interne : la charge de travail
accrue entraîne des tensions compréhensibles, en particulier notées dans le
service interne. Des efforts réciproques doivent être poursuivis pour améliorer
la communication à tous les niveaux, par exemple quant au fonctionnement du
Conseil d’Unité.
examen à 2 ans du CCSD
inspiré de « arXiv » de Los Alamos, cette base de données de publications scientifiques à l’initiative de la communauté scientifique Française est hébergée au centre de calcul a Villeurbannes. Il est conçu comme complémentaire de arXiv et une interface « HAL » (Hyper Article en Ligne) facilite la consultation et le dépôt des documents.
Phynet est aussi hébergé au CCSD ainsi qu’un serveur de thèses.
On s’interroge sur les liens avec DEMOCRITE.
On s’interroge sur les risques induits par une indexation en vue d’une évaluation, et la proposition faite par un membre de la section d’une grande base de données qui contiendrait aussi les rapports de la section. Il convient d‘être attentifs à ne pas organiser une gestion de la recherche dans une totale opacité. Il y a aussi un risque de transfert de l’évaluation scientifique vers des instances plus administratives que le comité national.
Par ailleurs on peut noter que la société privée qui intervient dans cette base de donnée est très compétente sur ces sujets puisqu’elle gère déjà le science citation index.
Avis favorable pour le renouvellement du CCSD, UPS 2275 (SPM) responsable : LALOE
La section donne un avis favorable pour la nomination de
J.COLLOT comme directeur de l’ISN en remplacement de J.CHAUVIN
B.HAAS comme directeur du CENBG en remplacement de P.AGUER
Et à la reconduction de
J.COLAS comme directeur du LAPP
Y.DECLAIS comme directeur de l’IPNL
A.FALVARD comme directeur du GAM
voir rapports en annexe
Le CESR, centre d’études spatiales de rayonnements, dont D.Lequéaut a été nommé directeur en 1996, a naturellement de nombreuses affinités avec les activités de l’IN2P3. Il a notamment des liaisons à travers Intégral, et par des développement de détecteurs de haute énergie dans le GDR PCHE. Le GIATHE, sous la double tutelle du directeur du CESR et de celui du CENBG, est un groupe de 6 ou 7 enseignants qui ont une importante activité de développement instrumental. Après une participation à CELESTE, ils se réorientent vers des détecteurs solides de photons, en liaison avec un laboratoire de Toulouse et avec des perspectives dans HESS et EUSO. Il serait donc naturel que les relations avec ces laboratoires se développent, de plus dans une région ou l’IN2P3 n’a pas de laboratoire.
Avis favorable pour le renouvellement du CESR, FRE2194, responsable : BIGNANI
Examen
à deux ans
Avis favorable pour
Gédépéon GDR 2287
L’intitulé passe de « gestion des déchets par options nouvelles » à « gestion des déchets et production d’énergie par des options nouvelles »
Directeurs : Delpech et J-M.Loiseaux
SUSY GDR 2305
Bilan à 4 ans :
GREX : (resp : S.Reynaud)
Se tourne vers le spatial (LISA) tandis que l’IN2P3 évolue à travers VIRGO vers EGO. Ce GDR a bien joué son rôle, mais il n’a plus de participation IN2P3.
Au sein du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, trois directions nous concernent plus particulièrement:
la Direction de la Recherche et la Direction de la Technologie, qui dépendent du ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies, et la Direction de l’Enseignement Supérieur. A noter que tous les postes sont gérés par la direction de l’enseignement supérieur.
La MSU, mission scientifique universitaire rattachée à la direction de l’enseignement supérieur, s’appelle désormais MSTP (p=pédagogique), et va devenir la structure d’expertise scientifique unique des ministères. Ceci devrait lui donner plus de prérogatives de ce point de vue, mais par contre elle ne gèrerait plus directement de budget.
En ce qui concerne les personnes en charge de ces structures, on ne prévoit pas de changement à la direction de la technologie, mais la directrice de la recherche devrait être remplacée[5], tandis que Jean Marc Monteil est le nouveau directeur de la direction de l’enseignement supérieur.
Michel Leboucher remplace Jean Francois Mella à la direction de la MSU. Il y envisage une politique ouverte: 11 DS ont été initiées au lieu de 8, physique, SPI et STIC ont été séparées, l’informatique est regroupée, un département transverse sur l’énergie est créé. Daniel Bideau prend la direction de la DS2, qui nous concerne en particulier, avec une équipe de 8 personnes représentant les différentes sous disciplines ainsi que l’international, et les liaisons avec le STIC.
Il faut remarquer que les équipes de l’IN2P3 ne sont pas assez impliquées dans les ACI.
400 postes de postdocs vont être accessibles à des Français, il faut regarder le site web (http://www.recherche.gouv.fr/recherche/aci/ et http://www.recherche.gouv.fr/recherche/formation/postdoccirculaire.htm) qui décrit postdocs et ACI. La probabilité devrait être de une sur trois.
B.Tamain répond à une question de D.Guerreau, en précisant que l’attribution de la gestion des postdocs au ministère ou aux organismes n’est pas encore décidée et pourrait changer d’une année à l’autre. Un principe est cependant établi : Les postdocs nouveaux ne doivent pas se substituer aux anciens.
Pour les ACI il faut essayer de s’insérer dans les priorités, ne pas hésiter à le contacter. Il faut suivre les informations sur le web. Il faut que la direction de l’IN2P3 l’informe des dossiers qui la concernent, au moins pour s’assurer que l’information est bien passée.
Si l’année dernière, il n’était pas obligatoire d’avoir les informations sur la personne concernée par le postdoc, c’était malgré tout un point positif. Il faut noter d’ailleurs que les nouveaux postdocs ne sont pas limités aux Français. Pour les anciens qui visaient plutôt des chercheurs de haut niveau, le salaire était ajusté au profil du chercheur étranger concerné.
J.Dumarchez s’interroge sur le sens de cette nouveauté, est-elle l’expression d’une volonté de remplacer les postes permanents par des postdocs ? B.Tamain n’a pas d’information pour répondre à cette interrogation, mais il constate aussi une diminution des postes, et une augmentation des CDD.
B.Tamain précise, en réponse à une question de D.Jouan, qu’il n’y a pas actuellement d’indication sur le profil (par exemple pour faciliter un retour de postdoc de l’étranger ou pour faire une liaison juste après la thèse)
D .Guerreau s’interroge sur le lien entre les responsables par discipline et la MSTP. Pour B.Tamain il y aura au niveau le plus élevé du ministère des experts qui se chargeront de la politique générale et qui examineront la cohérence de la politique des sites universitaires. La MSTP fera l’expertise et transmettra à ce niveau au-dessus, sans distribuer de financement, contrairement aux pratiques antérieures.
P.Aguer évoque l’épisode du renouvellement des contrats en 1995, où une différence de mode d’expertise a entraîné une diminution des crédits des laboratoires de l’ IN2P3. B.Tamain rappelle que par ailleurs on a retiré des moyens aux disciplines, pour les affecter aux recherches appliquées. A ce sujet il faut remarquer que le développement de la nouvelle direction scientifique pour les questions liées à l’énergie devrait concerner nos disciplines.
M.Baubillier constate qu’il y a des universités où la physique subatomique n’est pas enseignée, mais que les priorités affichées pour les domaines en relation avec les problèmes d’énergie devraient contribuer à corriger ces manques. B.Tamain répond qu’une lettre à été rédigée à ce sujet, insistant en particulier sur le blocage des effectifs dans nos disciplines. On nous fait remarquer que cependant il était possible d’aller enseigner dans d’autres universités.
R.Frascaria s’interroge sur l’utilisation des rapports des comités d’évaluation dans les expertises faites au niveau du ministère, et sur le choix des experts.
B.Tamain confirme qu’il y a une certaine évolution : jusqu’ici la MSU reprenait les conclusions des évaluations. Ceci pourrait changer à l’avenir, sans que ce soit systématique car il ne s’agit pas de dupliquer ce qui a été déjà fait. Le choix des experts est fait en fonction de leurs compétences et d’un certain niveau de confiance.
Pour les concours CR2 et CR1 :
Auditions 13 au 16 mai
Jury d’admissibilité 26 au 28 mai
Auditions et jury d’admissibilité se dérouleront à Paris.
Pas d’audition pour les DR
G.Wormser représente la direction scientifique du département.
La situation de la recherche dans le département PNC présente de très nombreux aspects positifs. De plus certains problèmes ponctuels ont trouvé une solution satisfaisante :
- Au LHC il a été possible de faire un contrat directement avec la société qui assemblait les dipôles, ce qui a résolu le problème posé par une faillite. Un retard dans la livraison des câble n’a pas eu d’incidence sur le planning grâce à un stock disponible suffisant.
- ATLAS et CMS ont résolu leurs problèmes de dépassement. De 70 à 80% ont pu être comblés. Une partie sera étalée dans le temps: ce sont essentiellement des fermes d’acquisition de données qui seront rajoutées a mesure que la luminosité augmentera. La date de démarrage prévue est avril 2007.
- Concernant atlas qui est la responsabilité principale de l’IN2P3 , le calorimètre est déjà a moitié assemblé, ce qui montre que on peut réellement avoir une vision claire du déroulement du processus. CMS est aussi bien avancé.
- En réponse à une question de R.Frascaria à propos du budget machine, G.Wormser précise que en septembre le comité Aymard a présenté un plan approuvé par le conseil du CERN de redéploiement et d’un étalement du paiement qui fait apparaître une réserve de 120 millions de CHF. Il y a des conséquences : il ne serait pas possible de financer un nouveau projet avant 2010, et des activités prévues initialement ne pourront être réalisées.
- En physique nucléaire on note la mise en évidence possible d’un état a 4 neutrons, et la découverte de la radioactivité à deux protons.
- L’APD spiral 2 va démarrer ces jours ci. Les plans financiers sont approuvés par la DSM et l’IN2P3. Le projet va être rediscuté au conseil scientifique de décembre.
- On va récolter dans les années qui viennent les fruits de VIRGO, HESS, AUGER, NEMO, qui ont commencé ou vont commencer à prendre des données. NEMO et EDELWEISS arrivent à point après les derniers résultats sur les neutrinos pour occuper le devant de la scène internationale.
Le futur scientifique à moyen terme est donc très prometteur, sans oublier BABAR, ARCHEOPS. Giens a bien mis en valeur un effort de réflexion à très long terme, par exemple concernant la perspective des faisceaux stables, grâce aux groupes de travail qui ont été mis en place dans les différentes thématiques. On va extraire de ces journées un document. L’idée de journées instrumentation a aussi été une réussite.
Le budget pour 2003 comprendra
- 11 postes pour l’IN2P3 CR1/CR2
- 7 postes DR dont un pour l’ISN Grenoble
- on attend 70 recrutements ITA pour l’IN2P3, donc une année plutôt bonne dans la mesure ou on espère compenser les départs.
- Les pertes en AP (au sens du budget de l’état) ne sont que de 1%. Les financements pour les grands équipement, LHC et GANIL, ont été obtenus. Le budget calcul est reconduit cette année. On n’a pas récupéré le niveau d’il y a deux ans, ce qui diminue ce que le centre de calcul fournissait aux unités, mais le fonctionnement du centre lui même a pu être préservé.
L’Europe ne fournira que 5% du budget de recherche, mais ceci devrait avoir un effet important.
- Les chercheurs IN2P3 sont plus fortement impliqués dans ces demandes, qui est une évolution. EURATOM est dans la continuité mais APECc est une nouveauté. On cherche à mettre en place un réseau autour des accélérateurs de physique des particules (DESY, FRASCATI, … , les laboratoires d’Orsay).
- La France a joué un rôle important dans le 5ème programme cadre autour des projets de grilles et l’IN2P3 joue un rôle important dans ce programme.
- Le budget sur la mobilité des chercheur a doublé ( bourses Marie Curie, centres associés) .
- Un Groupe de travail DSM IN2P3 a été mis en place, présidé par G.Wormser, recommandant une structure pérenne et commune pour réfléchir sur les projets a long terme concernant les accélérateurs. Il y a un potentiel de 135 FTE (full time équivalent) personnes dans ce champ. Une réunion entre les différents intervenants va avoir lieu pour réfléchir a des synergies, il y a en perspective de nombreux projets : hadronthérapie, collisionneurs, faisceaux de haute intensité,… .
- Plus largement on organise un séminaire pour envisager des possibilités de synergie, coordinations, mutualisation, entre labos, où sur des pôles régionaux. Le SMA qui réalise des miroirs alors que le laboratoire concerné n’est pas dans VIRGO, le CCPN, les licences pour la microélectronique, sont des exemples de questions ou d’activités qui sont déjà ou pourraient être concernées par une telle organisation.
- En décembre il y aura une réunion avec la direction du CNRS pour mettre en place une chaîne de contrats, en partant des laboratoires. En 93 on avait essayé de tels contrats, mais ils ne s’appuyaient pas sur ce que le CNRS pouvait fournir. Cette fois ci on veut obtenir des descriptions encore plus précises que pour la contractualisation.
- En réponse à une question de P.Lutz, G.Wormser précise que pour les postdocs il y a 400 postes dont 200 pour le CNRS, d’une durée de 12 mois, 2000 euros mensuels, et extensibles peut être a 18 mois. G.Berger avait indiqué que ces contrats commenceraient vers avril-mai 2003. C’est l’information dont on dispose actuellement, on estime que l’ordre de grandeur est de dix postes pour l’IN2P3. Le ministère de la recherche, qui est l’origine du budget correspondant, pourrait aussi intervenir dans le processus.
On examine les demandes de détachement émanant d’enseignants du secondaire.
Il s’agit d’un projet de développement de matériel pédagogique (TP, DVD,..) de physique nucléaire. La section est unanime.
Avis favorable pour le détachement à mi-temps de Philippe Jean-Jacquot, au près de l’IPN de Lyon UMR 5822
Le rapport de conjoncture dans sa version courte est finalisé, des modifications de détail sont envisageables encore pendant une semaine.
Nicolae CARJAN CENBG avis favorable au prolongement de sa mise à disposition pour un an à Los Alamos à compter du 01/11/2002 (sous condition de participation financière de Los Alamos)
Arnd SPECKA LLR avis favorable à la prolongation de sa mise à disposition à DESY pour un an à compter du 01/12/2002
Anne EALET CCPM avis favorable à sa demande de stage au LAM pour un an à compter d’octobre 2002
Lydie PLOUX URA2210 avis favorable à sa demande d’affectation à l’UPR9068 (institut de chimie des surfaces et interfaces de Mulhouse)
Jacques MAILLARD UPS851 avis défavorable à sa demande d’affectation au PCCdF ou au LPNHE
Les conseils scientifiques de département vont faire des propositions.
Notre département correspond à une seule section, ce qui pourrait suggérer de créer plusieurs sections.. Les interfaces entre sous thématiques sont ainsi bien traitées, c’est aussi très cohérent pour les visites de laboratoires.
L’inconvénient est le nombre de dossiers à traiter, auxquels on pourrait consacrer plus de temps en créant deux sections.
Les théoriciens de physique nucléaire sont pour 1/3 dans l’IN2P3 et pour 2/3 en SPM, et ceux qui sont plus près de l’expérience souhaitent le rester. Ceci ne s’oppose pas complètement à l’existence de plusieurs sections, un laboratoire pouvant être examiné par plusieurs sections.
Finalement la section se prononce pour conserver la géométrie actuelle, avec une seule section par 14 oui 1 non 1 abstention
La section 03 s’associe à la préoccupation générale concernant l’insuffisance du budget de la recherche 2003, qui conduit à une baisse des crédits et des recrutements des personnels dans les organismes de recherche. Ce budget ne permettra pas de s’approcher des 3 % du PIB d’ici 2010, taux du budget pourtant reconnu comme indispensable pour maintenir la recherche française dans la compétition internationale.
La diminution importante dans les perspectives de recrutement, et le développement des postes précaires de jeunes chercheurs, ne sont pas de nature a répondre au problème posé par la baisse de motivation des étudiants pour les études scientifiques, et sont inquiétantes pour l’évolution sociale.
13 oui 1 non 2 abs
La Section 03 réunie en session d’automne (12-16 novembre 2002) rappelle son attachement au développement de l’interdisciplinarité dans tous ses aspects au CNRS : définition des thématiques interdisciplinaires émergentes et des besoins afférents, recrutement, création de laboratoires interdisciplinaires et évaluation des chercheurs et des laboratoires.
La thèmatique astroparticules s’est progressivement et spontanément développée dans la section, et représente une perspective importante pour le futur de la discipline. Des actions interdisciplinaires se sont progressivement mises en place, y compris à l’intérieur du comité national, et il est très positif que ce thème ait été reconnu comme une priorité de développement.
Inversement les CID tels qu’ils ont été présentés ne répondent pas de façon appropriée à la mise en œuvre de l’interdisciplinarité comme priorité. Si différentes habitudes de fonctionnement peuvent effectivement compliquer le fonctionnement interdisciplinaire, rien n’indique que la solution des CID apporte une réponse, et son rapport bénéfice/coût est a priori dramatiquement faible. Le nombre de postes concernés cette année rend encore plus discutable la mise en place de tels dispositifs.
De facon générale, La section 03 souligne la force de proposition majeure que représente le Comité National dans la définition des priorités interdisciplinaires de l’organisme et dans leur mise en œuvre. Elle rappelle que notamment pour le recrutement, une adaptation des modalités de fonctionnement actuel des sections est envisageable. Par exemple un choix souple d’experts en nombre suffisant permettrait de constituer des jurys d’admissibilité parfaitement adaptés à chaque concours interdisciplinaire. Il s’agirait là de solutions plus souples et plus efficaces que la création de Commissions Interdisciplinaires.
La Section 03 soutient donc l'initiative prise par la CPCN de faire des propositions pour améliorer la gestion de l'interdisciplinarité au CNRS, et notamment d’améliorer les textes qui réglementent les concours afin d'introduire plus de souplesse dans la composition des jurys d’admissibilité et de permettre un meilleur suivi des unités et des chercheurs.
12 oui 5 non 1 abs
La section s'élève vigoureusement contre les conditions dans lesquelles elle a trop souvent été amenée à donner son avis statutaire sur la nomination ou le renouvellement des directeurs d'unité.
La négligence qui préside trop souvent au processus de désignation des directeurs et entraîne un manque de transparence et de discussion dans les laboratoires ne permet pas à la commission de se prononcer en toute connaissance de cause.
Elle demande donc instamment à la direction scientifique de l’IN2P3 de tout mettre en oeuvre pour que cette situation ne se renouvelle pas.
Si ces conditions devaient persister, la commission se verrait dans l'obligation de refuser de se prononcer.
Mardi
12 novembre à 9h30
matin :
·
approbation
CR sessions précédentes
·
infos
du président : Commission interdisciplinaire, Redecoupage, et
discussion/candidatures,...
·
titularisation
des stagiaires
·
affectation
des entrants et nominations de leurs directeurs de recherche
·
demande
de subventions (écoles et colloques)
·
avis
sur le(la) directeur de l'IPNO
après midi:
·
examen
à 2 ans du PCC (Collège de France) et des chercheurs associés
·
examen
du CESR de Toulouse (à sa demande)
·
discussion
sur ALICE et l'Aval Du Cycle
·
examen
des GDR en renouvellement et/ou à 2 ans
Mercredi 13 novembre (Bernard Tamain invité) à 9h00
matin :
·
infos
de B. Tamain sur la politique du ministère
·
examen
à 4 ans du CENBG et des chercheurs
associés
· avis sur le nouveau directeur B.Haas
· examen à 2 ans du Ganil
après midi
·
examen à 4 ans de l'ISN Grenoble et des chercheurs associés
· avis sur le nouveau directeur J.Collot
·
premier
examen à 4 ans du GAM et des chercheurs associés
·
avis
sur le renouvellement d'A. Falvard comme directeur
Jeudi 14
novembre, à partir de 9h.
matin
·
examen
à 2 ans de l'IReS
·
examen
à 4 ans de l'IPNL des chercheurs associés.
·
Renouvellement
de son directeur Y.Declais.
après midi
·
examen
à 4 ans du LAPP, des chercheurs associés
·
renouvellement
de son directeur J. Colas
·
examen
à 2 ans du LPNHE Paris
Vendredi
15 novembre, à
partir de 9h
matin :
·
exposé
de politique générale du DS et/ou de ses adjoints
·
examen
à 4 ans du Centre de Calcul (CCIN2P3) [D.Linglin invité]
·
examen
à 2 ans du CCSD
après midi
·
examen
à 2 ans du LLR (Ecole Polytechnique)
·
détachements
/ cas particuliers de chercheurs /reconst. carrières
·
discussion
sur le rapport de conjoncture
·
AOB
ALICE_rapport_12nov
02
D. Jouan, P. Lutz,
J. Péter, P. Quentin
ALICE France comprend environ 40 physiciens et 30 ITA de 6 laboratoires au sein de 900 membres de 77 instituts dans 28 pays. Un des deux porte-parole adjoints appartient à AF, ainsi que le vice-président du Conseil de Collaboration.
ALICE comprend une partie centrale (45 à 135°)qui mesure les hadrons, électrons et photons, et un spectromètre avant (2 à 9°) pour mesurer les muons. Parmi les ensembles qui constituent la partie centrale, AF apporte une contribution au calorimètre électromagnétique PHOS et a en charge le sous-projet SSD de l’Inner Tracking System (ITS) et le sous-projet V0 de Forward Detectors. Sa participation principale concerne le Bras Di-muon (responsable de projet, coordonnateur technique, 2 responsables de sous-projet, coordination et réalisation de plusieurs tâches). Le tableau joint présente une vue, forcément schématique, des responsabilités françaises dans l’organisation, les tâches et les personnels. Cette présentation exagère l’importance de la participation française, car les autres projets (18 au total) ne sont pas mentionnées, ni les comités techniques et sous-projets sans participants français (dans ITS : Si Pixels, Si Drift – dans Forward Det. : FMD, TO).
Problèmes communs aux
différents laboratoires.
¨ Problèmes financiers. Le surcoût demandé à la France est de 11% du coût initial prévu dans le MOU. Il n’a pas pu être donné à 100% : 650 kChF IN2P3 + 150 kChF CEA au lieu de 892 et 172 respectivement. On garde l’espoir que ce sera possible à l’avenir.
¨ Etudes de physique . Elles sont évidemment limitées actuellement aux prévisions théoriques (qui interviennent dans le Physics Performance Report) et aux simulations qui conditionnent les choix stratégiques concernant l’appareillage, notamment les différents niveaux de trigger.
¨ Relations entre laboratoires français.
La répartition des travaux entre plusieurs laboratoires pour une même tâche amène des retards sur l’ensemble lorsqu’un laboratoire n’effectue pas sa partie dans le délai défini.
Chaque automne, une réunion des responsables de chaque laboratoire avec D. Guerreau traite de l’utilisation du budget et des travaux en cours. Cette année, les directeurs des laboratoires concernés sont aussi invités.
Plusieurs tâches reposent sur une ou deux personnes et sont donc menacées par tout départ ou changement d’activité. Exemple : 1 seul ingénieur pour le DAQ du bras di-muon.
¨ Relations avec l’ensemble de la collaboration.
La coordination de tâches avec des laboratoires lointains et mal équipés prend beaucoup de temps et amène des lenteurs.
Le fonctionnement avec les “ managers ” du CERN est pesant : nombreuses réunions et rapports pour leur expliquer puis pour rendre compte.
La représentation au sein des instances centrales d’ALICE s’était affaiblie. La nomination récente de Y. Schutz comme porte-parole adjoint et de J.P. Coffin comme vice-président du Collaboration Board améliore la situation, mais il ne semble pas que la participation française dans ces diverses instances et comités soit au niveau de la proportion de laboratoires et de personnes (une estimation précise est difficile, car les listes accessibles datent souvent d’un an voire deux). Il est souhaitable que les laboratoires ne se replient pas sur leurs tâches techniques et participent plus aux instances et comités, en particulier en ce qui concerne l’analyse.
¨ Participations à
d’autres collaborations.
Actuellement, la plupart des groupes participent à STAR ou PHENIX à RHIC, ou NA60. En plus de l’obtention de résultats de physique, cela sert à acquérir la compétence pour construire des dispositifs et/ou établir des analyses qui seront utilisés dans ALICE . Exemples : · A Subatech et à l’IReS, la construction du SSD de STAR -> participation au SSD de l’ITS d’ALICE ; programme d’analyse de STAR -> préparation de la physique d’ALICE · Au LPC de Clermont Ferrand, en plus de la participation a FOPI, une contribution importante va continuer pendant quelques années sur NA50 et NA60. A un peu plus long terme la participation à PHENIX permettra aux plus jeunes de développer leurs compétences avec des données.
¨ Retard du LHC.
Ceci amène une certaine perte de motivation et une difficulté à prendre des doctorants, ainsi qu’une forte tendance à donner une priorité aux autres expériences.
Problèmes particuliers à chaque laboratoire.
Ce sont essentiellement des problèmes d’effectifs.
Au LPCCF les taches lourdes à assumer au CERN dès 2004, et les départs en retraite d’enseignants-chercheurs vont affecter autour du démarrage du LHC les équipes ions lourds. L’anticipation des remplacements est demandée. Ces équipes ne comportant que deux chercheurs CNRS, un recrutement CNRS est à envisager. En 2005 il faudra dégager un groupe important, notamment technique, pour mener à bien le montage au CERN et la qualification du détecteur. Sur le plan financier, deux points : - le budget d’accompagnement annuel est serré pour, par exemple, développer les nouvelles cartes électroniques ; - dans les prochaines années, le montage au CERN demandera des crédits importants pour des vacataires et des frais de mission de longue durée.
Le
responsable ALICE France appartient à l’IPNL. L’arrivée de
Thieulent a compensé le départ de Gangler. Le groupe participe aussi à NA60
(analyses et développement de détecteurs de contrôle) et des données In-In
devraient être prises en octobre 2003, juste avant la fermeture. Sur ALICE,
deux activités : 1 -responsabilité de V0 (dans Forward Detectors) :
validation des triggers, rejet du bruit de fond dû au gaz résiduel de la
machine ; 2 – sur le bras di-muon,
alignement par le système optique RASNIK (contrôle en continu des
positionnements des chambres). Un ingénieur en électronique s’occupe du
trigger, mais le service instrumentation ne peut fournir de soutien à RASNIK au
delà du conseil.
L’équipe IPNO, malgré le renfort d’un MdC de Clermont-Ferrand dont il est espéré qu’il soit pérennisé, a un effectif insuffisant compte tenu de ses responsabilités (coordination du Tracking du bras di-muon détecteurs et leur électronique) et des travaux engagés : la majeure partie de l’électronique, la station 1 du Tracking, l’intégration et le refroidissement des station 1 et 2 (construite à Calcutta) . Une demande de CR a été mise en priorité par le laboratoire depuis 2 ans, sans résultat.
Le retard du LHC touche particulièrement l’équipe IPNO qui ne travaille que sur ALICE. Elle envisage donc de travailler sur PHENIX, ce qui lui permettra de prendre des doctorants et d’analyser des données dès maintenant et facilitera son implication dans les simulations et analyses d’Alice.
A l’IRES l’équipe a des fonctions au Collaboration Board et au Management Board et la responsabilité du SSD de l’ITS. Son volume a diminué suite à une mutation vers Nantes, et un départ à la retraite pourrait réduire à deux personnes l’équipe de permanents prenant en charge la physique. Outre des recrutements (université ou CNRS), il faudrait rendre attractifs d’éventuels regroupements dans le laboratoire. Actuellement, la construction du SSD de STAR (en collaboration avec SUBATECH) est ralentie par l’arrivée tardive de modules industriels. En 2003 un demi-tonneau devra être mis en place, tandis que les tests de production commenceront pour ALICE, ce qui pose un certain défi à l’équipe technique coordonnée par JR. Lutz.
SUBATECH est bien représenté au niveau de l’organisation de la collaboration ALICE. Le nombre de physiciens est relativement élevé, mais ils sont aussi engagés dans STAR ou PHENIX et ont pris beaucoup de charges de réalisations techniques. Une réorganisation de l’équipe est en cours, avec un responsable local pour le bras di-muon déjà nommé et des responsables locaux pour ITS et PHOS à nommer. Comme à l’IRES, la participation au SSD de STAR représente une charge importante, les engagements déjà pris doivent être réalisés avant de commencer une participation à la construction du SSD de l’ITS d’ALICE, qui ne pourrait donc commencer avant 2003, de même que la participation à la réalisation de PHOS (non soutenue par l’IN2P3). Le prototype de la carte trigger du bras di-muon est terminé et le banc de test est en cours, mais la poursuite de cette activité est compromise par le départ de l’ingénieur responsable. La conception et les tests des chambres à fils pour les stations 3, 4 et 5 a bénéficié de l’expertise du groupe dans ce domaine et la construction commence. Une réorganisation interne du groupe doit arriver à définir les responsables des activités ITS Alice et PHOS Alice, celui de Bras di-muon Alice étant déjà nommé.
A. Tournaire appartient à SUBATECH mais son bureau est à l’IPNO et, en raison de sa fonction de coordonnateur technique du bras di-muon, il est très souvent au CERN.
Le groupe du DAPNIA SACLAY occupe des responsabilités au niveau de la collaboration (MB et TB) et est responsable du projet Bras di-muon. Il comporte 5 physiciens permanents (dont 1 à 100% sur PHENIX) et 2 étudiants (1 Alice, 1 PHENIX). + environ l’équivalent de 3 ingénieurs et 3 techniciens temps complet. Le groupe participe à la construction des lattes des 3 grandes stations avec Subatech Nantes, Cagliari et Gatchina. Le DAPNIA a la charge des cadres des grandes stations et des supports, dont la réalisation est en cours.
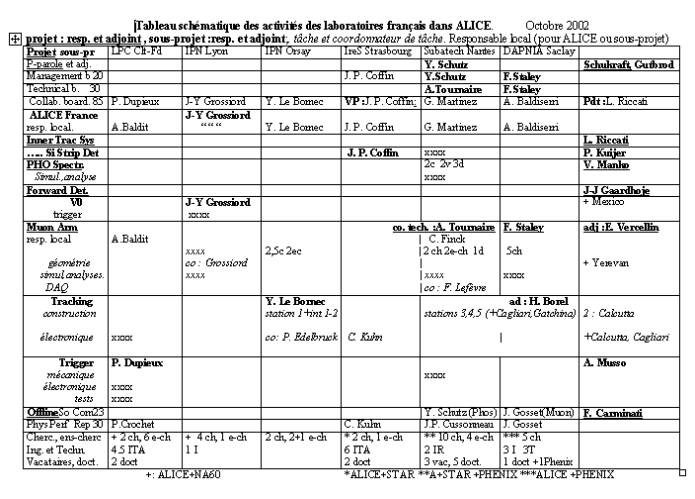
L ‘AVAL DU CYCLE À L’ IN2P3
SIGLES ET ACRONYMES UTILISÉS DANS LE TEXTE :
GEDEON :GESTION
DES DÉCHETS PAR DES OPTIONS NOUVELLES
(CNRS/CEA/EDF/FRAMATOME).
GEDEPEON : DITO PLUS PRODUCTION D’ENERGIE.
MUSE :MULTIPLICATIOND’UNE SOURCE EXTERNE AUPRÈS DU RÉACTEUR MASURCA (CEA). PROPRIÉTÉS NEUTRONIQUES D’UN RÉACTEUR SOUS-CRITIQUE .
NOMADE :NOUVEAUX MATÉRIAUX POUR DECHETS.
PACE : PROGRAMME IN2P3 POUR L’AVAL DU CYCLE ÉLECTRONUCLÉAIRE.
PRACTIS :GDR PHYSICO-CHIMIE DES ACTINIDES ET AUTRES RADIOÉLÉMENTS EN SOLUTION AUX INTERFACES.
HINDAS :PROGRAMME EUROPEEN D’ETUDE DE CERTAINES
REACTIONS NUCLEAIRES.
Les travaux de recherche sur l’aval du cycle électronucléaire constituent un programme interdisciplinaire de trois disciplines :la physique nucléaire, la radiochimie la chimie des solides et représentent un des grands axes des recherches menées par l’IN2P3 au sein du programme PACE. Ces études sont menées en collaboration avec le CEA, EDF, Framatome, l’ANDRA et les Universités en liaison avec les UMR qui développent ce type d’activités.
Ces activités peuvent être regroupées en physique nucléaire en cinq thèmes :
1.- L’acquisition des données nucléaires nécessaires aux études de transmutation auprès de divers accélérateurs ou sources de neutrons
2.- L’étude des conditions de réalisation d’une véritable cible de spallation en métal liquide
3.- L’apprentissage de la maîtrise des réacteurs sous-critiques.
4.- Les développements en direction d’un accélérateur intense de protons.
5.- Le développement de compétences en physique des réacteurs du ‘futur’ .
En radiochimie et chimie des solides, les activités sont regroupées dans deux GDR :
¨ Le GDR Practis qui s’attache à étudier le comportement des radionucléides en solution ou en phase ignée.
¨ Le GDR Nomade consacré à la chimie des solides mène des travaux pour concevoir et tester des cibles de transmutation où les déchets pourraient être introduits en réacteur.
Les laboratoires de l’ IN2P3 qui travaillent sur ces thèmes sont :
· L’IPN d’Orsay travaille sur les thèmes 1.-,3.-,4.- et 5.-au sein du groupe PACS qui comprend 9 permanents. Les expériences de données nucléaires se font au CERN (n-TOF) et à GSI.
Le travail développé au sein du groupe de Radiochimie, qui comprend 11 permanents, porte sur les propriétés physico-chimiques des actinides et trans-actinides pour le cycle nucléaire ou en solution pour le stockage. La division accélérateurs étudie les accélérateurs de proton de haute intensité ( IPN, ISN, LAL et DAPNIA) à des fins de production de neutrons pour la transmutation ou la production d’énergie.
·
L’ISN de Grenoble migre de la
problématique de la gestion des déchets à travers le thème 3 vers celle d’un
réacteur du futur (thème 5) satisfaisant les critères du développement durable.
Le groupe qui comprend 9 chercheurs
permanents ( 4 CNRS, 3 UJF, 2 INPG et 5 thésards) a aussi
participé dans le thème1à une activité de mesures de temps de capture
qui ont permis d’obtenir des profils de sections efficaces importantes tant
pour le cœur du réacteur que pour les matériaux de structure avec GENEPI. Il a
couplé ensuite avec succès GENEPI au réacteur MASURCA dans le cadre du thème 4.
Le groupe accélérateurs réa lise actuellement un GENEPI 2 installé à l’ISN ,
élément essentiel du programme PEREN.
·
Le CSNSM
avec son groupe de physico-chimie de l’irradiation de 5 personnes permanentes effectue des
recherches sur le le stockage en sites profonds des déchets et sur la capacité
de confinement de l’oxyde d’ uranium.
·
Subatech à Nantes participe à trois activités
dans les thèmes 2 et 5.Il y a 5 participants,
4 E-C, 1 ATER et 1 post-doctorant .( et
2 thésards). En données nucléaires nombreuses expériences à Uppsala,
Groningen et Louvain. Expériences de simulation et d’ irradiations à PSI pour
des études mécaniques dans une boucle Pb-Bi liquide (LISOR). Dans MEGAPIE,
simulations nucléaires et conception de cibles par service mécanique.
·
L’IreS de Strasbourg travaille en radio chimie
sur le comportement chimique des
éléments actinides ou produits de fission en solution et dans l’ environnement
naturel à des interfaces solide /liquide. Il s’agit d’ études sur le confinement des déchets sur
des céramiques nucléaires pour le stockage des déchets. Sur le thème donnés
nucléaires , les physiciens travaillent principalement auprès de n-TOF mais
aussi sur GELINA et CRC. L’ensemble du groupe IreS comprend 10 permanents et 4 doctorants.
·
Le LPC de
Caen travaille sur les thèmes 1.- et 2.-. Les expériences de données
nucléaires sont réalisées à Upsala, Groningen et Louvain-la-Neuve en
collaboration avec Subatech. Le travail sur la cible (MEGAPIE) est
principalement tourné vers des simulations et en partie sur des études
mécaniques. Cette partie est presque terminée ; Il y a 4 chercheurs à temps partiel important, 1 IR(30%) et un
IA(60%). Financement partiel dans GEDEON et HINDAS.
·
LeCENBG travaille sur un scénario de réacteur
basé sur le cycle du Thorium en étudiant au Van de Graaf local ou au tandem
d’Orsay des réactions de fission par neutrons. Des réactions n,g ou n,f sur les
actinides mineurs sont aussi étudiées. Ce groupe comprend 5 chercheurs permanents, 3 CNRS, 2MC, 2 doctorants et un visiteur
IN2P3.
·
L’IPN de Lyon travaille dans le programme PACE
et comprend 4 chercheurs permanents ( 3 EC+1CNRS) + 2 thèses. Ils participent à
PRACTIS et NOMADE dans des recherches de diffusion d’actinides dans la zircone
sous irradiation et le rôle des défauts créés dans les gaines en condition de
réacteur
Pour compléter ces informations, quelques éléments en provenance du DAPNIA/SPHN :
¨ Etude de spallations : mesure des sections efficaces à GSI (ALADIN). 5 physiciens
¨ Neutronique : d’une part à GEEL et d’autre part au CERN sur n-TOF. 5 physiciens impliqués sur les expériences, en modélisation et en applications (Mini INCA à Cadarache).
¨
En résumé il y a environ 41 chercheurs qui travaillent en physique nucléaire IN2P3 sur les thèmes 1 à 4 et 21 chercheurs en radiochimie ou physico-chimie sur le confinement des déchets nucléaires, soit un total d’ une soixantaine de personnes réparties dans tous les labos de l’ IN2P3 ayant une tradition en physique nucléaire ou en radiochimie.
Il y a de nombreux GDR qui structurent les recherches mais pas de GDR mixte chimie -physique.
La convention GEDEON est en cours de modification avec de nouveaux objectifs qui impliquent des études orientées sur l’aspect système basé sur les résultats du forum Génération IV :
- système à caloporteur gaz
¨ filière thorium
Les nouveaux scénarios basés sur des réacteurs thermiques à sels fondus nécessitent un rapprochement avec des chimistes en ingénierie de ces sels fondus.
La communauté malgré sa dispersion sur différents thèmes dans différents laboratoires apparaît liée. L’ axe données nucléaires nécessite un travail de fond maintenant en modélisation. Il y aura un problème d’installation expérimentale après 2005 , l’installation n-TOF étant indisponible à cause de l’arrêt programmé du CERN
Une contribution française plus visible sur les études réacteurs en sels fondus est nécessaire en particulier dans le programme européen THERMOST, qui devrait aussi permettre un rapprochement chimie/physique de PNC.
Il y a une forte collaboration entre le CEA et l’ IN2P3 et la participation à de nombreux projets européens comme le projet ADS-XADS se fait en commun avec des industriels du secteur ;
examen à deux ans du PCC UMR 7553
Délégation de la section 3 du Comité Nationale :
Guy Coignet et Amel Korichi
La visite s’est déroulée le lundi 16/10 dans le cadre de l’examen à 2 ans. Après un entretien introductif avec la direction , nous avons rencontré le conseil de laboratoire qui nous a permis de faire le point sur les différents problèmes associés à la vie courante du laboratoire et de discuter sur l’APC Tolbiac. Les différents groupes de physique nous ont exposé les thèmes abordés au laboratoire.. Nous avons ensuite rencontré les différents services techniques et administratif ainsi les jeunes thésards, post-doc et chercheurs. Enfin, une partie du temps a été consacrée aux personnes qui ont exprimé le désir de nous rencontrer personnellement suivant l’usage. L’impression générale est très positive, le programme de recherche est très diversfié et les groupes sont très actifs et visibles.
A - PRESENTATION GENERALE DU LABORATOIRE
Depuis janvier 2001, le PCC est une Unité Mixte de Recherche (UMR 7553) entre le Collège de France, le CNRS/IN2P3 et l’université Paris VII. Depuis le premier janvier 2002, le PCC est membre de la Fédération de Recherche astroparticules et cosmologie (APC) avec comme autres partenaires le CEA, l’INSU, SPM et l’Observatoire de Paris. L’UMR 7553 s’arrête à la fin de 2004 compte-tenu du passage de tout le personnel à l’APC Tolbiac.
Le laboratoire est actuellement dirigé (depuis janvier 1999) par Daniel Vignaud, secondé par Gérard Tristram, coordinateur des services techniques.
Le conseil de laboratoire est régulièrement réuni et consulté. Les orientations scientifiques de l’unité sont examinées chaque année par un conseil scientifique incluant quatre personnalités scientifiques extérieures au laboratoire.
Les thématiques de recherche sont toutes tournées vers l’astroparticule (rayonnement cosmique et neutrinos solaires) et la cosmologie observationnelle. On distingue 5 groupes de physique avec 26 chercheurs et 10 thésards.
Les relations entre la direction et les personnels du laboratoire sont confiantes. Nous avons été très favorablement impressionnés par l’attractivité du laboratoire auprès des jeunes chercheurs, avec une présence importante en son sein de jeunes chercheurs, thésards et post-doctoraux ou visiteurs.
Les
effectifs et leur évolution
|
EFFECTIFS 2002 |
EVOLUTION 2000 –02 |
|
26 Chercheurs
CNRS 18
Enseignants – chercheurs
5 Ingénieurs de Recherche 2 CEA 1 |
+1 DR et 1CR2 +1 MC et 2 Pr (Paris 7) -2 MC (Collège et P6) |
|
Doctorants 10 Post-docs et visiteurs 8 |
|
|
Personnels techniques 48 33 ITA CNRS – 8 TPN CNRS et 7 IATOS (CDF) |
+6 ITA mais 5 départs |
|
% Ingénieurs (IR+IE) 38% |
|
On peut noter :
· Des effectifs chercheurs en légère augmentation
· Une pyramide des ages (voir figures) modifiée. Les deux dernières années, la moyenne d’age des ITA est passée de 55 à 50 mais 55% des ITA se situent dans la tranche d’age supérieure à 55 ans. La distribution associée aux chercheurs et enseignants -chercheurs n’a pas évolué et on constate toujours un creux entre 40 et 50 ans.
· Participation active à la formation des jeunes chercheurs et ITA
· Un rapport ITA/chercheur d’environ 1,8
Le budget
|
Le budget (kE) |
Fonctionnement SB |
AP-scientifiques |
Crédits
Collège |
Autres (Visiteurs) |
Total |
|
|
IN2P3 |
IN2P3 CNES |
|
IN2P3 |
|
|
2000 |
507
|
249
32 |
91 |
33,5
|
881 |
|
2001 |
512
|
319
190 |
91 |
33,5
|
1161 |
|
2002 |
473 +40 APC |
232
0 |
87 |
33,5
|
825 |
On peut noter une diminution de 8% pour le soutien de base (40 kE versés à l’APC)- le soutien de base du collège a aussi diminué.
B -
ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Les activités de recherche se regroupent autour de quatre thèmes : les rayonnements cosmiques de haute énergie, l’astronomie g, la cosmologie observationnelle et les neutrinos solaires. Ces activités sont réparties autour de 5 groupes de physiques :
§
Groupe Rayonnement de très
haute énergie [ AUGER ]
§
Groupe Rayonnement de très
haute énergie [ EUSO ]
§
Groupe Astronomie gamma [CAT,
CELESTE, HESS, (GLAST)]
§
Groupe de cosmologie
observationnelle
§
Groupe neutrinos solaires[
Borexino/LENS, (Hellaz)]
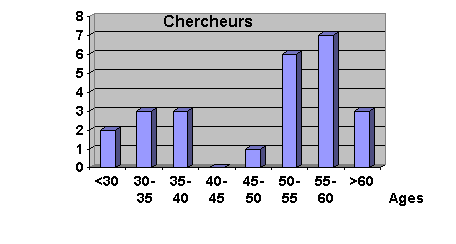
1.
AUGER -
4 physiciens, 2 thésards, 1 post-doc et 1 ATER
L’observatoire AUGER est un détecteur hybride constitué de 2 réseaux (3000 km2chacun) et d’un ensemble de télescopes à fluorescence ayant la même couverture géométrique que les réseaux. Chaque réseau comportera 1600 stations locales (cuves remplies d’eau pour la détection des rayonnements Tcherenkov) espacées de 1.5 km et formant un maillage triangulaire. Les années 2000-2001 ont été consacrées à la réalisation de la première étape, sur le site austral en Argentine : le réseau test constitué de 40 stations locales, de la station centrale,d’un détecteur de fluorescence et de 2 stations de télécommunications . Les premières données ont été collectées. De 2002 à 2004 l’ observatoire austral sera progressivement installé. Présent dans la collaboration depuis 1995, le groupe du PCC a un ensemble de responsabilités important touchant à l’analyse/simulation de l’expérience où la compétence du laboratoire est certaine . Parmi les travaux effectués, on peut citer l’étude de l’effet Landau-Pomeranchuk-Migal qui réduit les sections efficaces des interactions électromagnétiques. Le groupe est très impliqué dans l’électronique associée aux stations locales. Il a la responsabilité du contrôleur de station locale à travers la réalisation de la carte unifiée (contrôleur formant l’intelligence de chaque station). Le groupe est aussi très engagé dans la réalisation des ASIC pour la mesure de temps d’arrivée des gerbes (avec une précision de 15 ns) et des télécommunications (conception de la stratégie de l’expérience dans ce domaine).
La qualité du support technique en électronique et en informatique a été mentionnée.
La collaboration entre les différents laboratoires semblent bien fonctionner et nous avons noté la constitution récente d’un nouveau groupe de travail Parisien (avec une contribution significative du PCC) pour affronter les problèmes d’analyses des données et étudier les algorithmes d’évaluation d’énergie.
2. EUSO (Extreme Universe Space Observatory)- 3 physiciens et 1 ITA
Le projet EUSO est destiné à l’étude des rayons cosmiques de très haute énergie (E>3 1019eV). Il est en Phase d’évaluation (phase A de l’ESA) jusqu'à juin 2003.
Il serait positionné sur la station spatiale internationale ISS car il se donne comme objectif de détecter 1000 gerbes/an à partir de 2009.C’est en fait le prolongement d’AUGER mais avec un taux de comptage 10 fois supérieur. Le détecteur serait constitué de 3 éléments essentiels :
a. un système optique (lentille de Fresnel) permettant une correspondance directe entre une direction de vue et un point de surface focale
b. une surface focale, recouverte par plus de 5000 PM à pixels multiple
c. une électronique numérique et analogique associée à une logique de
déclenchement permettant une détection immédiate de la présence d’une gerbe.
Le PCC est chargé de la mécanique du plan focal d’EUSO, de la construction d’un banc d’essai pour tester l’ensemble plan focal-électronique et trigger d’EUSO. Il est également très impliqué dans les simulations des gerbes compte-tenu de l’expérience dans ce domaine au PCC. La coordination de la communication externe du projet EUSO est sous la responsabilité du PCC/APC.
3. Astronomie
g
à très haute énergie- 5 physiciens, 2 thésards et 2 post-docs
La tradition du PCC dans ce domaine d’activité est forte puisque les physiciens du laboratoire ont joué un rôle très important dans l’émergence de ce domaine d’activité. Le groupe est actuellement impliqué dans 3 expériences (CAT/ Celeste à Thémis et HESS en Namibie). CAT est un imageur utilisant la technique Cherenkov atmosphérique. Ce télescope est en fonctionnement depuis 1996 et une vingtaine de sources galactiques ont été suivies. Un effort particulier a été fait sur la nébuleuse du crabe et deux AGN (Mrk421 et Mrk501). Le groupe joue un rôle très important dans l’analyse des données.
CELESTE a été conçue pour l’étude de certaines sources cosmiques ( pulsars et AGN lointains) ayant des spectres en énergie présentant des coupures à quelques dizaines de GeV. Du fait de son seuil à 250 GeV, CAT ne peut pas étudier ces espèces mais il reste tout à fait complémentaire et utile à cette thématique. La participation du groupe à l’expérience Celeste est très importante -avec le passage à 55 héliostats de l’instrument- le groupe a participé de manière significative à la construction du LIDAR( instrument devant contrôler la qualité de l’atmosphère) ; Il a naturellement développé des méthodes d’analyse très originales
Dans l’avenir à court terme les contributions à Thémis devraient se réduire à la participation à la prise de données. La présence des détecteurs CAT et CELESTE sur le site de Thémis fait de cet ensemble un instrument unique pour étudier l’émission gamma de 30 GeV à 1 TeV
Dans GLAST le groupe a joué un rôle important en participant très efficacement dès la définition de l’instrument pour le proposal de l’expérience. En plus de sa contribution au software de l’expérience et sa responsabilité d’organisation des faisceaux tests pour l’optimisation et le contrôle du calorimètre, le groupe avait en charge l’étude et la réalisation du collage des diodes sur les cristaux de CsI de l’instrument.
(C’est un point très délicat car il faut assurer de bonnes qualités optiques et avoir un ensemble robuste qui puisse résister au conditions du lancement et du fonctionnement dans l’espace. L’expérience, après avoir subi au niveau national une phase de turbulence était repartie du bon pied mais a subi à nouveau de nouvelles turbulences à la fin 2001.
Il s’avère malheureusement, que suite à une réorganisation du partage des tâches (début 2002), le laboratoire s’est trouvé dessaisi de ce travail et le groupe a décidé de se retirer de la construction du détecteur.
Les membres de la commission 03 expriment leur regret compte-tenu de l’investissement intense du groupe du PCC dans cette expérience. Ils regrettent que ce travail soit abandonné à cause d’une mauvaise collaboration avec des collègues du CEA.
HESS est la troisième expérience dans laquelle le groupe est impliqué. Le PCC était présent dans HESS avec un seul physicien permanent (qui est coordinateur technique des contributions des groupes français.). Cette situation singulière a changé puisque les forces qui étaient tournées vers GLAST se sont focalisées sur HESS.
4. Cosmologie observationnelle – 7 physiciens, 5 thésards, 2 ATER et 1 visiteur
L’activité de ce groupe apparaît bien organisée dans le temps. L’activité dans le domaine de la recherche de matière noire baryonique a fait, après la participation à EROS, l’objet d’un développement spécifique nommé AGAPE où l’effet de microlentille gravitationnelle est recherché pixel par pixel sur des objets éloignés (Andromède). Ce développement est incontestablement un beau succès du groupe. Ce travail a donné lieu à une quinzaine de publications et 2 thèses au PCC.
Bien que cette activité soit abandonnée pour le futur elle fait l’objet d’un transfert vers des collaborateurs étrangers (Italie et Inde par exemple)ce qui valorise clairement ce travail qui sera achevé au laboratoire par une Thèse en cours.
Le groupe est maintenant clairement impliqué dans l’étude du fond cosmique diffus avec un programme cohérent. Les expériences en ballon (ARCHEOPS) pour lesquelles les vols de physique ont eu lieu en janvier 2001et février 2002 ont clairement donné des résultats importants. Ces derniers soulignent incontestablement la participation active du PCC dans cette expérience couronnée de succès. Le groupe dispose aujourd’hui d’un outil incontournable permettant d’extraire le spectre de puissance des fluctuations du FCRM. Par ailleurs, le groupe est fortement impliqué dans une expérience embarquée sur satellite (Planck Surveyor), prévue pour 2007, dont le but est de mesurer les fluctuations de température du fond cosmique de rayonnement micro-onde ainsi que la polarisation de ce rayonnement. Le PCC s’investit dans l’instrument haute fréquence (HFI) et dans le traitement des futures données.
Scientifiquement le choix de s’intéresser à la polarisation du fond diffus est original et judicieux. Par ailleurs le groupe a pris en charge la calibration au sol et en vol du détecteur haute fréquence. L’activité sur ARCHEOPS permet de travailler sur des données réelles et donne des atouts majeures pour la mise au point des méthodes générales de traitement de données. Globalement le programme est bien mené et la contribution du groupe est cohérente et significative.
5.
Neutrinos solaires
L’activité « neutrino » est elle aussi à la fois ancienne et dynamique au laboratoire qui a collaboré aux diverses phases d’expériences Chooz avec un impact important sur la question de l’oscillation des neutrinos. Les physiciens du laboratoire ont participé à deux voies d’investigation différentes pour l’étude du spectre des neutrinos solaires
·
Borexino/LENS –
5 physiciens, 2 thésards et 1 ATER
Dans cette première approche les compétences acquises au laboratoire en matière d’électronique (très beau développement d’un flash ADC 400 MHz) et de d’utilisation de scintillateurs liquides sont naturellement exploitées. Techniquement et scientifiquement le choix de Borexino/LENS est justifié puisque les techniques dans lesquelles le laboratoire a de l’expertise peuvent être utilisées en commun dans ces deux expériences. Quant à l’avenir de LENS il fait encore l’objet de questionnement.
La faisabilité de cette expérience est encore en cours d’étude à travers le travail de R&D en cours. Le groupe devra faire le choix de continuer ou non le programme LENS en 2003. Il a été noté que la participation commune à LENS et Borexino est pour l’instant une source d’enrichissement pour l’équipe, en particulier pour le développement des codes et des idées de physique.
· HE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������LLAZ
En ce qui concerne l’expérience HELLAZ, le travail de
R&D a pour objet la conception d’un détecteur intégré à une TPC de grande
dimension susceptible de faire le tracking de l’électron de recul du neutrino
avec une précision angulaire de l’ordre de 5°. Ceci est conditionné par la
détection de chaque électron d’ionisation de la trace. Il s’agit alors de
concevoir un détecteur travaillant à 20 bars avec un gain de 10**6. Une étude
software approfondie a montré que le détecteur prévu pouvait atteindre cet
objectif. Bien que des progrès aient
été réalisés il ne semblait pas jusqu’alors que la technique pourrait être
maîtrisée et/où qu’une collaboration importante pourrait être trouvée pour effectuer
les très gros développements nécessaires pour passer d’un objet de R&D à un
détecteur opérationnel. Le choix d’arrêter ce
R&D à la fin de l’année 2001 a donc été pris. Bien qu’il n’appartienne pas
à la délégation de la section 03 de revenir sur ce choix, son opinion est qu’il
serait utile de publier les résultats obtenus dans le cadre de cette activité.
C - SERVICES TECHNIQUES
Le PCC dispose de services techniques numériquement équilibrés (6 administratifs + 3 documentation, 11 électroniciens, 10 informaticiens, 8 mécaniciens et 5 personnes pour le service intérieur). Le problème le plus fréquemment évoqué est celui de la pyramide des âges.
L’activité des services est très bonne dans les divers métiers mais la crainte de voir se perdre les compétences par des départs insuffisamment préparés est réelle, étant donné la taille relativement modeste de ces groupes techniques.
PYRAMIDES DES AGES
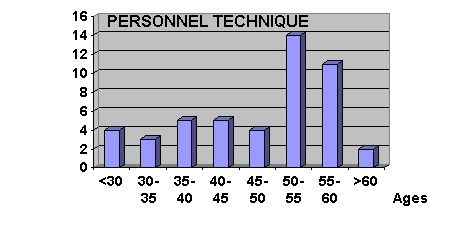
L’ensemble du personnel technique
demande que les embauches ne se cantonnent pas uniquement aux IR et IE mais
également aux techniciens (ce qui libèrerait les ingénieurs des tâches techniques qu’ils
sont obligés de réaliser et leur permettrait de mener à bien leurs études). Le
rapport DOUBRE va donc à l’opposé de l’opinion générale des personnels des
service techniques du laboratoire..
§
Service administratif – 1 IE, 1 AI, 3 T et 1 AJT-CdF
Il a bénéficié d’un renouvellement des personnels et de la formation permanente. Ce service est organisé en un groupe de gestion, un secrétariat pour appuyer la gestion du personnel et un adjoint en secrétariat.
Le point principal qui a été noté est la sollicitation importante du groupe administratif qui fonctionne à flux tendu. Par ailleurs, des besoins en formation ont été exprimés ainsi que des besoins en recrutement dans la perspective de l’APC.
§
Service d’électronique- 4 I, 3 TP,1 AI, 3 T (+ 1 CDD I au LLR)
Ce groupe a un impact évident dans les activités de
recherche menées au laboratoire. On peut noter comme
exemple de réalisation de haut niveau la réalisation du flash ADC 400 MHz
développé pour Borexino et commercialisé par la firme CAEN. Il contribue de
manière significative aux différentes expériences dans lesquelles le
laboratoire est impliqué. On peut citer le développement important des FPGA
pour AUGER par exemple. Par ailleurs, le service est très actif au niveau des
organisations des écoles et formations (1 ingénieur est chargé de
l’organisation de l’école numérique de l’IN2P3 par exemple). Deux départs en
retraite sont prévus en 2003..
§
Service d’informatique (2 IR, 2 IE, 4 AI, 2
T)
Son potentiel lui permet d’assurer de manière
satisfaisante le fonctionnement de l’informatique de laboratoire. Par ailleurs,
on peut noter un soutien aux expériences assez conséquent : ses
compétences dans le on-line (acquisition et contrôle) sont certaines. Il assure
également de manière satisfaisante toute la partie hors-ligne ( gestion et
installations de logiciels spécifiques). Le service a bénéficié d’une arrivée qui
finalement a décidé de réorienter son activité dans un autre laboratoire
(Ganil) et son remplacement est indispensable..
§
Service de mécanique - 2 IR, 2 IE, 3 AI, 1T
Ce service a connu une forte évolution de ses moyens matériels. Ses machines ont été mises aux normes et ses moyens de CAO largement homogénéisés. Un effort important de formation des personnels a été entrepris. Le service est très impliqué dans les différentes expériences du laboratoire. Il mène des actions particulières de formation (un IR est directeur de l’école de technologie IN2P3 par exemple) ; De plus on a noté une participation significative à divers comites et groupes de travail.
L’importance de la démarche d’assurance qualité, en particulier pour les expériences embarquées sur satellite, va devoir être prise en compte et générer de nouveaux besoins. Ce service est lui aussi un élément important de l’impact des groupes de recherche du laboratoire dans leurs expériences respectives. Il est lui aussi considéré comme à la limite d’être sous critique, les départs n’ayant pas été compensés complètement. Il a à sa tête un IR qui gère la mutualisation de ce service avec celui du LPNHE Paris VI/VII. Cette expérience, considérée comme positive, suscite toutefois des interrogations à l’horizon de l’intégration dans la structure prévue à « Tolbiac » avec des questions pertinentes sur le potentiel humain et l’organisation des services techniques du futur laboratoire.
D –Point sur la Rencontre
du conseil de laboratoire et le
projet APC
L’université Paris VII s’implante sur un nouveau campus et a choisi la thématique Astroparticule et Cosmologie comme un de ses deux projets d’implantation de nouveau laboratoire de Physique. La rencontre des membres du conseil de laboratoire nous permis de faire le point sur ce projet dans lequel le PCC est fortement impliqué
La structure (associant l’Université Paris 7, l’IN2P3, l’INSU et le CEA) est relativement définie puisque depuis le premier janvier 2002, le PCC est membre de la fédération de recherche astroparticules et cosmologie (APC). Cette fédération a signé un contrat d’objectifs avec le CEA et la future direction a été définie (Directeur P. Binétruy et Directeur adjoint D. Vignaud)
Dans l’état actuel du projet un Plan Pluri-Formation
(PPF) a été mis en œuvre et ceci constitue une des deux origines budgétaires de
la fédération ( la seconde étant en provenance des départements CNRS et CEA).
Une partie du personnel déplore le manque de transparence et de concertations
entre le conseil de laboratoire et la direction de l’APC. L’exemple cité
concerne plus particulièrement le conseil scientifique de fédération récemment
constitué sans membres élus par exemple.
Le PCC organise prochainement des journées de prospectives dans le cadre de l’APC. Ces journées dites de Dieppe seront couplées aux journées du PCC et seront ouvertes à tout le personnel. Ceci montre clairement la volonté de réussir l’opération APC.
Il ressort de la visite de la délégation de la section 03 que le sentiment par rapport à cette opération est globalement positif dans l’ensemble des catégories de personnel mais suscite des interrogations.
Les questions soulevées sont d’ailleurs pertinentes et touchent en premier lieu aux moyens techniques, principalement en personnels, qui seraient affectés à la nouvelle unité. En effet l’administration du Collège ne serait pas prête à laisser partir ses ITA vers l’APC alors qu’elle s’était engager à le faire, et il serait souhaitable que la situation soit clarifiée. Par ailleurs, on constate clairement un malaise plus général corrélé aux grandes opérations de déménagement des locaux au sein du Collège. Ce problème a fait l’objet de discussions dans plusieurs conseils de laboratoire et malgré les efforts de la direction et du personnels les conditions de travail sont difficiles pour tous les services.
Le problème de recrutement a été posé : il semblerait que l’université Paris VII ait fait l’effort qu’il fallait mais ceci ne répond pas à tous les besoins. Il faudrait que les autres institutions en fassent aussi. Le point extrêmement important à souligner est l’implication forte de l’Université Paris VII qui anticipe déjà sur la réussite de l’opération et affecte des personnels enseignant-chercheurs.
Il nous paraît utile que la section 03 suivre attentivement ce projet et plus généralement s’intéresse à l’organisation des disciplines astroparticules et cosmologie dans les laboratoires rattachés au département PNC dans la région parisienne.
E - Rencontre avec les jeunes chercheurs du PCC
Nous avons consacré du temps aux jeunes chercheurs, thésards et post-docs qui souhaitaient s’exprimer et faire part de leur difficultés et/ou problèmes. De manière générale, on a été impressionnés par le dynamisme et l’épanouissement de chacun. Leur intégration au sein du laboratoire est excellente et ils l’expriment fortement.
F - CONCLUSION
Le PCC est un laboratoire très dynamique, très
équilibré compte tenu des choix scientifiques
formant un ensemble cohérent, concentré sur la physique hors accélérateurs.
La production scientifique du laboratoire est excellente dans tous les domaines de recherche abordés. Les axes de recherche sont tous tournés vers des sujets d’avenir avec un important potentiel de découvertes. Néanmoins, on peut noter la perturbation occasionnée par l’arrêt de GLAST au sein du laboratoire. L’arrêt de l’expérience HELLAZ a également marqué les personnes concernées mais le travail de R&D, lourd, fait l’objet d’un transfert de technologie vers le DAPNIA dont l’accord a été signé.
Nous avons remarqué un impact visible et important au sein
des diverses collaborations nationales et internationales qui se traduit en un
nombre important de stagiaires et thésards.
Tout
ceci mérite que l’on félicite le laboratoire.
Pour l’avenir à court terme la gestion des modifications d’implantation dans les locaux du laboratoire du Collège de France devra se faire de façon à ne pas entraver les activités de recherche : il serait dommage que des difficultés de locaux pénalisent les activités de recherche. A l’horizon 2005 le laboratoire envisage de façon résolue son avenir dans le projet APC dans le cadre d’un partenariat élargi avec l’Université Paris VII, l’INSU et le CEA. Malgré le caractère exemplaire de la démarche entreprise, le comité souligne le réalisme avec lequel cette perspective doit être envisagée. Il n’apparaît pas de problèmes insurmontables mais un des points centraux sera à l’évidence le potentiel technique de la future unité à Tolbiac.
renouvellement à 4 ans du CENBG
(R . Baumgarten, Ph. Chomaz, J.P. Thibaud)
A - PRESENTATION GENERALE
Le Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan est une unité mixte CNRS-Université de Bordeaux 1. Il est dirigé depuis 1997 par P. Aguer, Directeur de Recherches au CNRS, assisté actuellement par un directeur adjoint P. Labarssourque, Professeur des Universités. Le mandat de la direction se termine à la fin de l’année 2002, le successeur pressenti étant B. Haas, D.R. au CNRS. Une Unité mixte de recherches le LCNAB, (environ 20 personnes), autrefois partie prenante du CENBG est hébergée dans les locaux. Enfin, le CENBG abrite en son sein une cellule de transfert de technologie ARCANE ,émanation de la Région Aquitaine. Le laboratoire dispose par ailleurs d’une machine électrostatique Van De Graaff de 4 MV .
A-1 Les
effectifs et leur évolution
|
EFFECTIFS 2002 |
EVOLUTION 1999 – 2002 |
|
Chercheurs CNRS 18 |
+4 |
|
Enseignants chercheurs 17 |
+1 |
|
Doctorants 15 |
-1 |
|
ITA CNRS (+ TPN) 20 |
|
|
IATOS 12 |
|
|
Total personnel technique 32 |
- 5 |
Ce tableau tient compte de la situation réelle des forces du laboratoire, certaines personnes n’étant plus rattachées au laboratoire que pour la forme, d’autres étant en congé maladie avant un départ à la retraite. Il ne comporte pas les personnels de la cellule de transfert ARCANE.
Pour le personnel chercheur, on note un équilibre entre les enseignants-chercheurs et les chercheurs CNRS. Cet équilibre n’est que global, la situation étant très diversifiée selon les équipes, comme on le verra dans la suite du rapport. Sur les 18 chercheurs CNRS, on compte 7 DR et 11 CR et sur les 17 enseignants-chercheurs 8 sont PR.
L’évolution des effectifs chercheurs est favorable sur les quatre dernières années malgré quelques départs, soit de jeunes enseignants-chercheurs (lourdeur des services), soit à la retraite. Ceci est dû à l’arrivée d’un nombre assez important de physiciens venant d’autres laboratoires de l’IN2P3, et de recrutements au niveau CNRS ( 2 en 4 ans ) et universitaire ( 3 ) Cette évolution globale favorable sera discutée plus en détails dans la suite, équipe par équipe.
Avec un taux de doctorant par chercheur d’environ 0.4, le CENBG participe très honorablement à la formation à et par la recherche, même si, ici comme ailleurs, et peut-être un peu plus qu’ailleurs, la recherche de doctorants est quelquefois difficile.
L’ effectif en personnels techniques a quant à lui subi une érosion assez sensible, qui sera discutée service par service. Cette érosion est sans doute un peu amplifiée de manière conjoncturelle dans ce document. Néanmoins, le rapport personnel technique/chercheurs permanents, d’environ 0.9 au moment de notre visite, apparaît insuffisant si l’on veut préserver la remarquable capacité d’intervention technique qu’a manifestée le laboratoire ces dernières années.
Les pyramides des âges des personnels chercheurs et techniques sont données en annexe. Pour les chercheurs on note sans surprise un nombre important de personnes autour de 55-60 ans, situation qui sera discutée plus loin équipe par équipe. Pour le personnel technique, la même remarque est valable, avec cependant un nombre assez important de personnel « jeune » ( < 45 ans ).
A-2 Les
budgets (Kf)
|
Année |
Soutien base IN2P3 |
dotation Ministère |
Fluides Université |
AP IN2P3 |
AP
Région (2001) |
|
|
2002 |
3142 |
112 |
500 |
1000 |
650 |
|
|
<99-2000> |
3169 |
112 |
485 |
1222 |
690 |
|
Plusieurs points émergent:
- Un soutien de base pratiquement constant depuis quatre ans en provenance de l’IN2P3 et du ministère (celui-ci à un niveau très faible d’environ 4% du total)
- Un financement en AP très significatif provenant de la Région Aquitaine. Depuis un à deux ans, ce financement est très ciblé, la politique scientifique de la Région étant de favoriser les aspects pluridisciplinaires d’une part, environnementaux et liés à l’Energie, d’autre part ( financement aval du cycle par exemple).
- Une fois soustraits les frais incompressibles, les services doivent vivre avec seulement 880 KF et le soutien de base pour les sept équipes de physique n’sont que de 1350 kF. Il est vrai bien sûr que certaines équipes émargent heureusement sur d’autres budgets (Gédéon pour l’aval du cycle, collaboration NEMO par exemple) mais ce soutien de base apparaît vraiment faible.
B – LES EQUIPES DE PHYSIQUE
B – 1 ASTRONOMIE GAMMA DE HAUTE ENERGIE
Ce groupe, dont le responsable est D. Smith est composé actuellement de 7 personnes : 3 CNRS au niveau CR1, 1 enseignant-chercheur MC , 2 doctorants, 1 technicien rattaché à Montpellier et présent sur le site de Thémis. Il est privé depuis peu de l’activité d’un jeune CR2 recruté en 1999 qui a désiré changer de thématique.
L’équipe est jeune, bien structurée, avec deux thématiques claires :
· La collaboration CELESTE dont David Smith est le coordonnateur et dans laquelle le CENBG joue un rôle pivot. CELESTE et ses 53 héliostats a maintenant prouvé son potentiel en observant les photons des sources de référence que constituent la nébuleuse du Crabe et le noyau actif de galaxie Mk 421, et cela dans une gamme de longueur d’onde descendant jusqu’à 50 GeV que CELESTE est seul à couvrir actuellement. L’exploitation de CELESTE en terme de résultats physiques est maintenant effective puisqu’une première publication vient de paraître dans « The Astrophysical Journal » sur des mesures du flux g du Crabe au-dessus de 60 GeV. Les observations vont se poursuivre jusqu’à l’année 2004 avec comme objectifs scientifiques l’étude de l’origine des rayons cosmiques, des modèles d’accélération dans les pulsars et les blazars, la supersymétrie enfin qu’étudie l’équipe du GAM. Ces objectifs nécessitent bien sûr l’observation de nouvelles sources avec de bonnes statistiques. Ceci reste un pari, de nature essentiellement météorologique, puisque les conditions climatiques se révèlent globalement mauvaises à Thémis depuis le début des observations.
· Le satellite GLAST. L’équipe du CENBG est responsable des tests sous faisceau des prototypes du calorimètre. Une première campagne en électrons au CERN-SPS a été un succès apprécié par la collaboration et notamment sa composante américaine. Une autre série de tests a été acceptée au GSI pour étudier la réponse des cristaux aux ions lourds, et ce en utilisant le FRS afin de produire et de sélectionner des ions avec une grande souplesse.
Cette équipe apparaît donc de très grande qualité. Malgré les difficultés potentielles signalées sur CELESTE, sa démarche globale est très cohérente et elle noue actuellement des relations, notamment locales (observatoire de Floirac), avec d’autres équipes qui observent les mêmes objets dans d’autres longueur d’onde. C’est un des points forts du laboratoire.
B – 2 NOYAUX EXOTIQUES
Les forces du groupe sur place sont actuellement de 2 chercheurs CNRS jeunes ( niveau CR1 et CR2), et d’un doctorant (un jeune chercheur vient de soutenir sa thèse et va partir en position post doctoral à partir de janvier 2003) Le responsable du groupe, B. Blank DR CNRS, est actuellement détaché à Argonne. Le groupe sera renforcé l’an prochain (9 mois) par la présence d’un visiteur financé sur les mois-IN2P3.
Ce groupe a fait preuve ces dernières années d’une activité scientifique très impressionnante par sa qualité et son volume : on rappellera notamment quelques succès remarquables dans l’étude des noyaux exotiques : la découverte du noyau doublement magique 48Ni, celle de la radioactivité 2p dans le 45Fe dans des expériences au GANIL pilotées par l’équipe. D’autres expériences ont lieu à Jyvaskyla pour étudier les transitions b super-permises de Fermi dans les noyaux N=Z, sans parler de diverses participations à des collaborations au GSI.
Le groupe va continuer dans la même thématique générale des noyaux exotiques. Il a eu, avec le service mécanique du CENBG, un impact technique important dans le développement de SPIRAL ( plate-forme VAMOS et chambre FISH) Un nouveau développement expérimental important est en route avec le développement d’une TPC pour les études de radioactivité 2p.
L’équipe travaille donc avec un grand succès dans ce qui est un des axes prioritaires de L’IN2P3. Malgré le recrutement très récent d’un CR2 CNRS, les forces du groupe sont numériquement limitées. Mais il a su faire preuve jusqu’à présent d’une telle qualité et d’un tel dynamisme que son impact dans cette physique va demeurer même si tous les objectifs affichés ne pouvaient recevoir simultanément la même priorité.
B
– 3 INTERACTIONS
FONDAMENTALES - NEMO
Actuellement le groupe est constitué de 3 chercheurs CNRS (1 DR1 et 1 CR1 dans la tranche d’âge 60-65 ans, 1 CR2 jeune venant de rejoindre le laboratoire depuis l’IRES ) et d’un professeur (tranche d’âge 60-65 ans) très limité dans ses activités de recherche par ses responsabilités à Bordeaux 1. Un jeune CR1 est pour un an mis à disposition d’un laboratoire japonais (étude d’oscillation de neutrinos) Le responsable est Ph. Hubert.
Le groupe a parfaitement assumé les responsabilités qu’il avait dans la construction de NEMO3, notamment dans la mise en route du calorimètre qui est maintenant opérationnel depuis le printemps 2002, et dans les mesures de bruit de fond neutrons et de radioactivité des différents matériaux. L’équipe est faible numériquement et se voit contrainte de se cantonner dans l’immédiat à un rôle de suivi et de surveillance de l’expérience notamment au niveau des calibrations en énergie et en temps. Un impact réel dans les analyses de physique, souhaité évidemment par les jeunes de l’équipe, passe nécessairement par un renforcement numérique de l’équipe.
Deux des membres du groupe sont des spécialistes éminents de la spectrométrie g bas bruit de fond. Dans une analyse de vins bordelais par cette méthode, ils viennent de mettre en évidence une corrélation forte entre le taux de 137Cs et l’année de production. Ce type d’étude, fortement soutenu par la région, peut conduire à de nombreuses applications ( expertise de Ph. Hubert par exemple dans une affaire juridique de fraude sur les millésimes) mais est très limité à l’heure actuelle par des problèmes de « man-power ».
Nous reviendrons plus loin sur ce problème de l’expertise en spectrométrie g très bas bruit de fond qui risque de se perdre par le départ à la retraite des spécialistes bordelais.
B – 4 PHYSIQUE THEORIQUE.
Le groupe de physique théorique comprend actuellement sept enseignants-chercheurs(3 Pr et 4 MC), un chercheur CNRS de la section 2, cinq doctorants, un ATER et un CR de la section 03 actuellement à disposition de Los Alamos.
L’activité du groupe s’articule autour de quatre thèmes :
· Structure et désexcitation des systèmes fermioniques finis (dont le noyau !)
· Physique hadronique
· Rayons cosmiques
· Etude sur les lasers et les faisceaux d’électrons relativistes
La qualité des recherches poursuivies est reconnue et incontestable (nombreuses publications, invitation aux conférences, collaborations internationales nombreuses) et l’attrait de ce groupe auprès des jeunes attesté par le nombre important de doctorants. Les interactions avec les expérimentateurs du CENBG et de la communauté, si elles ne sont pas toujours directes, se manifestent largement au niveau de discussions et d’échanges fréquents. Ce groupe occupe donc une place importante dans le laboratoire (et plus largement l’IN2P3), place qui doit être pérennisée. De ce point de vue, le profil des âges (six départs à la retraite dans les huit ans à venir) est inquiétant. Même s’il est acquis que les activités seront progressivement recentrées sur les deux premiers thèmes cités, des embauches seront nécessaires, à un niveau et/ou à un autre, si l’on ne veut pas voir à terme s’étioler un support théorique indispensable au rayonnement de nos disciplines et à leur enseignement.
B – 5 AVAL DU CYCLE ELECTRONUCLEAIRE
Ce groupe comprend actuellement trois chercheurs CNRS ( au niveau DR 55-60 ans), deux maîtres de conférence, un visiteur IN2P3 (jusqu’à la fin de l’année) et deux doctorants.
Le premier volet des activités concerne l’étude du cycle du Thorium, avec quelques beaux résultats comme la mesure sur le Van de Graaf local des sections efficaces de capture radiative de neutrons par le thorium ou la détermination indirecte au tandem d’Orsay de la section efficace de fission 233Pa(n, f)
Le deuxième volet concerne l’étude des réactions n,g et n,f sur les actinides mineurs qui sont extrêmement mal connues. Les déterminations des sections efficaces seront conduites selon la même méthode de mesure indirecte déjà utilisée pour le 233Pa.
Un troisième thème abordé est celui de la transmutation de déchets à vie longue avec des mesures de la section efficace de capture radiative 129I(n,g)130I.
Une des caractéristiques du groupe est d’utiliser de manière assez intensive le faisceau du Van de Graaf du centre, que ce soit pour des mesures directes ou pour des études détaillées de détecteur, la règle du jeu de beaucoup de ces expériences étant d’améliorer la précision et la fiabilité des mesures.
Le groupe a rapidement su trouver une place de choix dans cette physique sur l’aval du cycle. Il est d’ores et déjà partie prenante des projets du CNRS (GAT 11) sur les énergies du futur, il veut s’impliquer dans le projet PEREN et dans des mesures sur n_TOF et considère comme nécessaire à terme de ne pas se contenter de mesures nucléaires mais de participer aux efforts de simulation des différentes filières. Son effort est soutenu régulièrement par un financement de la Région Aquitaine.
B – 6 INTERFACE PHYSIQUE BIOLOGIE
Ce groupe à la taille un peu sous-critique jusqu’à présent (un professeur, une maître de conférences) vient d’être renforcé par la venue d’un CR1 CNRS transfuge de l’équipe d’astronomie gamma et verra l’arrivée début 2003 de l’ancien directeur du Centre. Il est complété par la présence d’un doctorant. Dans une thématique interdisciplinaire prioritaire au CNRS, il exploite les faisceaux et micro faisceaux du Van de Graaf pour mettre au point différentes techniques d’analyse appliquées à des problèmes biologiques et médicaux. Le groupe a par exemple mis au point une technique d’irradiation ion par ion de cellules uniques et même de constituants spécifiques dans ces cellules.
Les thématiques abordées concernent d’une part la dermatologie (pénétration de nanoparticules dans la peau) avec une participation à un programme européen et une collaboration avec un laboratoire privée de dermatologie (soutien sous forme de contrats) et d’autre part la radiobiologie.
Avec le renfort en effectifs qui était nécessaire, le groupe apparaît maintenant très bien placé dans le domaine de l’interface physique biologie avec un soutien fort de l’Université (programme AIFIRA dont nous parlerons plus loin), de la Région et du CNRS.
B – 7 HAUTS SPINS HAUTES DEFORMATIONS
Cette équipe, animée par JF Chemin, comprend trois professeurs (55-65 ans), deux maîtres de conférence récemment recrutés (sur la thématique laser), une DR CNRS arrivée cette année par mutation et un AI CNRS attaché au groupe.
Historiquement l’équipe poursuivait deux objectifs scientifiques :
· Dans le cadre des projets EUROGAM puis EUROBALL, elle a étudié les états nucléaires très déformés en s’appuyant sur l’utilisation d’un détecteur 4p de particules, DIAMANT, conçu et réalisé au laboratoire en collaboration avec des équipes italienne et hongroise.
· Parallèlement, l’équipe a obtenu des résultats très originaux dans un programme sur les interactions noyau-cortège électronique, tel que la mise en évidence au GANIL d’un nouveau type de conversion interne dans lequel l’état final atomique est lié.
C’est à partir de ce deuxième thème de recherches, que l’équipe a développé depuis deux ans un thème de recherche original à l’interface de la physique nucléaire et de la physique des lasers de puissance. Elle va se consacrer quasi entièrement à ce nouvel axe de recherches dans les années qui viennent. Des résultats prometteurs sont déjà apparus dans des expériences effectuées avec le laser 1J, 30 FS, 2x1019 W/cm2, avec l’accélération d’électrons jusqu’à 200 Merv. Les résultats ont été publiés dans Science. Ce programme est fortement soutenu par l’Université de Bordeaux 1 (deux recrutements MC en quelques années) qui a fait des lasers de puissance l’axe privilégié de sa politique scientifique (création du CELIA) en relation avec le développement dans la région du projet Mégajoule. L’équipe va poursuivre ses expériences sur l’accélération de particules par lasers et veut développer un programme ambitieux sur les changements, éventuellement dramatiques, des probabilités de désexcitation nucléaire sous l’effet de « flashes » laser de très haute puissance.
C - LES SERVICES TECHNIQUES
C – 1 BUREAU
D’ETUDES MECANIQUE
Le bureau d’études, avec trois projeteurs travaillant sur CATIA et EUCLID de manière transitoire, a un effectif stable depuis quelques années. L’atelier de mécanique en revanche ne comporte plus réellement que trois personnes (départ à la retraite en avril 2003 d’un agent en congé maladie jusque-là) ce qui apparaît nettement sous-critique (demande d’un technicien supplémentaire) Ce service a su ces dernières années concevoir et réaliser, grâce à une machine numérique performante, des projets d’envergure essentiellement pour le GANIL, comme la plate-forme VAMOS, la chambre FISH et une chambre pour LISE 2000.
Les implications du projet AIFIRA sur le service, forcément lourdes pendant quelque temps seront discutées dans la suite.
C – 2 SERVICE D’INFORMATIQUE (1IR,2IE,1 CDD niveau AJT)
Avec cet effectif, le service à une structure minimale qui lui permet cependant de gérer de manière très efficace la partie Unix et les serveurs associés, le réseau local, et l’ensemble du parc de microinformatique qui ne cesse de croître notamment sous forme de portables (problèmes de sécurité). L’information réciproque semble bien passer entre le service et les utilisateurs, physiciens ou membres des services techniques.
Le point le plus important actuellement est l���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a pérennisation du poste de technicien (actuellement en CDD) indispensable pour la maintenance. Ceci passe par l’ouverture d’un concours (Université) promise oralement mais qui tarde à se manifester.
C – 3 SERVICE D’ELECTRONIQUE (1IR,1IE,1AI,1T)
Le service est passé de 7 à 4 personnes en l’espace d’un an. Sa plus grosse charge de travail concerne le développement de la TPC pour la radioactivité 2p. S’y ajoutent des travaux pour GLAST, pour le groupe des neutrinos et évidemment la maintenance du parc matériel et logiciel.
En R & D, le service veut devenir compétent en microinformatique. Un des agents (AI) démarre un travail de thèse dans ce domaine sur un sujet intéressant le laboratoire et à terme deux personnes formées en microinformatique sont souhaitées.
Le service est clairement sous-critique du point de vue des effectifs et devra être renforcé rapidement (1AI demandé dans l’immédiat)
C – 4 SERVICE INSTRUMENTATION /ACCELERATEUR ( 2 IR, 3 IE dont un de l’Université, 1 T, 1 AJT Université)
Le service conduit les développements autour du Van De Graf (et sa maintenance), mais également autour d’expériences menées sur d’autres sites (Ganil, Jyvaskyla). On peut citer comme exemple le développement de la chambre d’irradiation ion par ion du Van de Graf avec intervention à la fois sur la mécanique(collaboration avec le service de mécanique) et sur l’électronique et les logiciels. Les autres opérations concernent l’aval du cycle, la chambre TPC. Le service instrumentation est fortement impliqué dans le projet AIFIRA (voir plus loin)
Son effectif parait pour le moment suffisant mais le remplacement à terme de l’ingénieur responsable du Van de Graaf sera nécessaire, surtout avec l’arrivée de la nouvelle machine.
C – 5 SERVICE DES CIBLES (1T université)
Cette activité est importante aussi bien pour les mesures auprès du Van De Graaf (aval du cycle...) que pour le montage de certains détecteurs pour NEMO ou DIAMANT. La personne concernée est proche de la retraite. Laisser cette activité disparaître au CENBG nous paraîtrait dommageable pour les activités de physique notamment auprès du Van De Graaf puis d’AIFIRA.
C – 6 ADMINISTRATION
et MAINTENANCE CAMPUS
Le service se compose de 11 personnes dont 7 personnels de l’Université de Bordeaux 1, 3 CNRS (2T, 1 AI) et 1 CEC. Il y a un problème général de promotions, plus aigu cependant parmi le personnel de l’Université et certains personnels sont dans des catégories ne correspondant pas à leur niveau de responsabilités effectif (la comptabilité est assurée avec grande compétence par une personne au niveau AGT ! ) Signalons enfin que tout comme lors de notre dernier passage il y a deux ans, il n’y a pas actuellement d’administrateur en titre.
D - ARCANE
Arcane est une cellule de transfert de technologie gérée par l’ADER Aquitaine (association loi 1901) Elle est constituée de deux personnes travaillant sur des analyses de trace auprès du Van De Graaf (20 à 25 % du temps de faisceau) La cellule est en état d’autofinancement et ne reçoit pas de subventions publiques (elle bénéficie bien sûr jusqu’à présent de la maintenance Van de Graaf assurée par les personnels du laboratoire)
Arcane fournit des prestations de service pour des industriels. Elle a notamment un contrat
très intéressant avec la RATP pour l’analyse des métaux lourds présents dans l’atmosphère du métro.
L’évolution de la cellule est évoquée dans le paragraphe suivant.
E - AIFIRA
Le projet AIFIRA consiste à acheter et à installer sur le site du CENBG une machine électrostatique moderne de 3,5 MV à un étage aux performances et à la fiabilité très améliorées. Il est porté par le CENBG et par le LCNAB. Le chef de projet est Ph. Moretto, responsable du groupe « interface Physique Biologie » et le responsable technique est L. Serani du service d’instrumentation du CENBG. Les objectifs scientifiques concernent des études fondamentales et appliquées dans les domaines des sciences de la vie (groupe Moretto), de l’environnement et de l’énergie (groupe aval du cycle) et des matériaux. Le projet s’appuie sur les compétences actuelles des deux laboratoires, d’une part dans le domaine de l’analyse et de la caractérisation (micro-faisceau), d’autre part dans celui des mesures neutroniques et des mécanismes de fission pour la physique nucléaire. A cette machine sera associée en fin de programme une nanosonde permettant de faire des analyses avec une précision de l’ordre de 150 nanomètres.
Le coût global du projet est estimé à 17 MF. 12MF sont fournis par le contrat de plan Etat-Région, 1,8 MF par le CNRS (moitié IN2P3, moitié sciences chimiques), 0,5 MF par l’Université et le reste par un financement régional. 7 MF seront débloqués en 2003 pour l’achat de la machine. Il est prévu que le bâtiment (5 MF) sera livré pour le premier trimestre 2004, la mise en service de la machine pouvant intervenir courant ou fin 2004.
La charge de travail pour les services techniques du CENBG (lignes de faisceau, contrôle-commande, nanosonde...) va peser essentiellement sur le bureau d’études, la mécanique et le service d’instrumentation. Les autres équipes devront donc patienter un moment pour présenter des projets techniques d’une certaine ampleur.
Une étude est en cours pour examiner les conditions de conservation du Van De Graaf actuel (avec une seule ligne) pour les seuls besoins d’ARCANE qui se transformerait en cette occasion en une entreprise industrielle. Cette entreprise assumerait la gestion totale de l’accélérateur et les problèmes de sécurité afférents. Ce projet de création d’entreprise a été lauréat du concours national d’aides à la création d’entreprise.
F - LE CENBG ET L’ENVIRONNEMENT UNIVERSITAIRE ET REGIONAL
Les relations du CENBG et de l’Université de Bordeaux 1 sont très étroites. Outre le nombre important d’enseignants-chercheurs au laboratoire, de nombreux collaborateurs du centre sont fortement impliqués dans la marche de l’Université, avec le directeur de l’institut de physique fondamentale, le responsable du DEA, un chargé de mission à l’UFR de physique... Mais ces relations se manifestent essentiellement autour des thèmes scientifiques. L’Université de Bordeaux 1 a décidé d’afficher parmi ses priorités scientifiques fortes de nombreux thèmes qui touchent à la physique des plasmas denses et chauds créés par laser. Une des équipes du laboratoire (HSHD) travaille dans cette problématique et a bénéficié du recrutement de deux maîtres de conférence en quelques années. Les thèmes pluridisciplinaires sont aussi favorisés et plus généralement tout ce qui peut aider à la convergence d’intérêt scientifique entre les différents laboratoires. Le laboratoire est très bien placé dans ce domaine avec le Van De Graaf actuel, l’opération AIFIRA, l’interface physique biologie, les travaux en spectroscopie g à très bas bruit de fond, l’équipe de théorie et les relations avec l’observatoire de Floirac.
Cette politique scientifique forte de l’Université suscite dans certaines équipes du laboratoire quelques inquiétudes quant à une éventuelle contradiction entre les thèmes prioritairement soutenus par l’IN2P3 et l’Université respectivement. Dans un entretien avec le vice-président de Bordeaux 1, il nous a été indiqué que la politique d’affichage fort pratiquée par l’Université au niveau des recrutements MC n’était pas exclusive d’un soutien apporté par ailleurs à des thèmes de grande qualité plus spécifiquement soutenus par l’IN2P3 (noyaux exotiques par exemple)
Le soutien fort au niveau régional a déjà été souligné. La-aussi, il se manifeste depuis un ou deux ans d’une manière plus ciblée qu’auparavant vers les domaines de l’environnement et de l’énergie (aval du cycle) et les activités économiques traditionnelles de la région (vin)
G – CONCLUSIONS ET
RECOMMENDATIONS
Le Centre d’études nucléaires de Bordeaux-Gradignan donne une remarquable impression de mouvement et de dynamisme. Les succès importants qui ont été enregistrés ces dernières années dans les différents groupes de physique (grâce à un support technique de qualité) placent ce laboratoire, petit par la taille, à un excellent niveau au sein de l’IN2P3. Il doit être remarqué que cet excellent niveau est obtenu en dépit d’un soutien de base par équipe qui nous paraît inférieur à celui dont peuvent bénéficier d’autres laboratoires du même genre.
Une caractéristique importante du laboratoire est d’être à la fois très engagé dans les thématiques soutenues par l’IN2P3 (aval du cycle, noyaux exotiques, physique du neutrino, astronomie g de haute énergie) et également fortement intégré dans le paysage universitaire et régional à travers des recherches de type plus interdisciplinaire (physique avec des lasers de puissance, interface Physique Biologie, faibles radioactivités) Ceci nous paraît être un atout très fort pour le laboratoire, atout qui doit être préservé et même développé.
Les équipes travaillant sur des thématiques plus spécifiquement IN2P3 sont remarquables, leurs perspectives pour les quatre ans à venir sont claires, elles doivent être soutenues aussi fortement que possible.
Pour les autres activités, nous émettrons trois recommandations :
· L’opération AIFIRA nous parait très importante par la qualité des objectifs de physique, par son aspect pluridisciplinaire et par l’ancrage qu’elle représente pour le laboratoire au niveau universitaire et régional. Cette opération est bien partie, les moyens du laboratoire ne doivent pas manquer pour qu’elle soit une réussite
· La physique autour des lasers de puissance que développe une des équipes du laboratoire, avec le soutien fort de l’Université, nous parait originale et riche de promesses. Elle représente une certaine prise de risque scientifique qui nous parait pouvoir être soutenue par l’IN2P3, après examen scientifique par les instances compétentes.
· Le développement de la spectroscopie g à très bas bruit de fond par deux chercheurs du laboratoire a été indispensable pour le projet NEMO. Elle a par ailleurs donné lieu localement à des développements pluridisciplinaires originaux. Il serait important de trouver rapidement une solution pour que cette expertise ne disparaisse pas.
Evaluation à deux ans du GANIL
DONNEES STATISTIQUES CONCERNANT LE GANIL
----------------------------------------
Le Grand Accélérateur National d'Ions Lourds est un Laboratoire
mixte de la DSM/CEA et de l'IN2P3/CNRS , de statut GIE.
C'est avant tout un outil pour la physique nucléaire dans l'étude
des états extrêmes de la matière nucléaire, mais présentant une grande
ouverture pluridisciplinaire avec un pole interaction ion- matière
joué par le CIRIL. Constitué en laboratoire d'accueil national mis
à la disposition des physiciens français (360 chercheurs),
il a une grande interaction avec les régions basse et
haute Normandie, ainsi que sur le plan international
avec 250 chercheurs étrangers en provenance de 25 pays qui utilisent
ses installations
Le GANIL comprend comme personnels permanents:23 chercheurs et
physiciens, 80 ingénieurs et cadres , 124 techniciens et personnels
administratifs. Ces personnels sont directement gérés par la
DSM et l'IN2P3..
Le projet de budget 2003 s’ élève en comparaison de 2002 , en équipement : 2.96ME(1.494) plus 3.3ME pour Spiral II.La contribution à Spiral II pour moitié est indispensable pour la partie APD. La région Normandie et l'Union Européenne participent à la dotation budgétaire.
L 'évolution de la dotation budgétaire est a peu pres constante
ces dernières années, après une chute importante entre 1990 et 1994
qui l'a fait passer de 61.745 en 1990 a 44.4 MF en 2000,
en francs constants.
EVALUATION SCIENTIFIQUE:
------------------------
Le GANIL est un ensemble d'accélérateurs (cyclotrons) qui fournit
des faisceaux d'ions lourds dans une très large gamme de masse
allant du carbone a l'uranium et d'énergie, de 100keV a 100 MeV/A.
En 2001, 54% du temps de faisceau a été délivré en faisceau pilote .
Une propriété remarquable de ces installations, est de délivrer simultanément deux faisceaux à moyenne énergie, ce qui permet aux recherches interdisciplinaires du CIRIL de bénéficier de 1700h de programmation.
Un nouvel outil, SPIRAL I, a démarré en 2001. Cet ensemble
cible/source couplé à un nouvel accélérateur CIME, permet de délivrer
des faisceaux exotiques de masse inférieure a 100 et
d'énergie allant de 1.7 a 25 MeV/u.
Le GANIL est aussi un ensemble de grands équipements comprenant de
nombreux détecteurs (SPEG,INDRA, LISE, ORION,SIRA).
Certains sont d’existence récente. Il s'agit des détecteurs VAMOS et EXOGAM.
Le GANIL est un laboratoire de recherche scientifique et technologique
de très grande valeur reconnue sur le plan international.
Il joue un rôle fondamental sur le plan de la formation (il y a
actuellement 18 étudiants en thèse en site propre). Par son
excellente implantation régionale, il est un facteur important de
développement dans sa région. Par ses compétences, il est le
laboratoire sur lequel l'Europe s'appuie pour développer des
faisceaux exotiques de deuxième génération. Un projet important est apparu récemment : le projet SPIRAL II construit sur un driver LINAG à deutons .
Le GANIL coordonne aussi le programme européen EURISOL(5eme et 6eme PCRD), dont le but est de définir une future installation européenne a l'horizon 2010.
EVOLUTION DE PROBLEMES RELEVES PENDANT LA VISITE EN 2000 :
-----------------------------------------------------
Bloquage du démarrage de SPIRAL du fait du
caractère INB du GANIL :
Ce problème a trouvé sa solution en 2001. Depuis le démarrage de cette installation, 7 expériences se sont parfaitement déroulées et l’on peut déjà dire que cette nouvelle installation est un succès sur le plan technologique Les expériences sont limitées à 6 à 7 périodes de 15 jours par an avec changement de l’ensemble cible –source à chaque période quelque soit l’activité déposée ce qui présente de fortes contraintes financières et techniques. La Direction du GANIL est en discussion avec la DRIR pour changer les prescriptions techniques d’utilisation .
Un nouveau problème est apparu et qui concerne la collecte des eaux usées dans une INB. Cette contrainte devrait entraîner un réseau de collecte ceinturant le site et non relié au réseau urbain. Un incident de niveau 1 a été déclaré en avril 2001 suite à une erreur de manipulation sur un échantillon activé.
Passage aux 35 heures.
En accord avec les personnels , un règlement intérieur a été mis en place. Un fonctionnement avec dérogation de 40 heures hebdomadaire et 53 jours de vacances est opérationnel mais sans avoir obtenu en retour l’aval des autorités de tutelle(depuis février 2002 !).
Equilibre entre laboratoire de services et
R&D propre.
La mise en exploitation des nouveaux équipements (SPIRAL et
V����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AMOS/EXOGAM) se faisant a effectif constant, la crainte est vive
d' une part, de ne pouvoir assurer avec la même qualité les
prestations de service aux utilisateurs des installations et d'autre
part, que cela ne se traduise par une diminution du temps et des efforts
réservés au R&D que tout laboratoire d'excellence doit avoir ne
serait- ce que pour garder une expertise dans le domaine des
technologies avancées.
Une structuration en groupe de projet mise en place par la Direction ( sur
les grands projets) permet d'éviter en partie cet écueil. Il nous semble cependant que certains services sont un peu juste pour être sur plusieurs projets comme le bureau d’études ou le service d’aide à la physique .
Pour les projets futurs, en particulier SPIRAL phase 2, une
meilleure coordination entre les laboratoires qui réalisent des
éléments d'un ensemble dont le GANIL a la charge de l'intégration
finale sur le site, doit exister en respectant les règles de bonne
conduite d'un projet d'envergure.
CONCLUSION GENERALES
Le GANIL joue pleinement le rôle qui lui est demandé: il délivre les faisceaux d'ions lourds que la communauté des physiciens de cette discipline attend. Il développe et réalise les accélérateurs et les lignes de faisceaux qui résultent des projets des physiciens et des décisions des autorités de tutelle en respectant les cahiers des charges et les délais qui lui sont impartis.
Il participe et intègre les grands ensembles expérimentaux jusqu'aux acquisitions de données qu'il standardise.
Le GANIL affirme son ouverture pluridisciplinaire avec le CIRIL
et le secteur biologique a travers deux équipements:
une ligne basse énergie -IRRSUD- utilisable en permanence et
une structure d'accueil pour la radiobiologie
Le parc d'accélérateurs et de lignes de faisceaux augmentant,
le personnel permanent restant a peu près constant ,l'emploi du temps associé au nouveau régime des 35 heures posant des problèmes d'organisation du temps de travail-en particulier pour ce qui concerne les astreintes nécessaires à une bonne exploitation des installations- il est à craindre une surcharge de travail qui ne puisse être assumée par un personnel très impliqué dans ses tâches et dans la démarche qualité qu'il y associe. Ce personnel souhaite participer efficacement au projet SPIRAL phase 2, pour lequel un Avant Projet Detaille est
demandé pour l'été 2003.
Les responsables tant au niveau Direction qu’au niveau des services se plaignent de la lenteur des réponses et parfois de la non-réponse de l’IN2P3 sur des points qui font problèmes, comme les astreintes , les promotions, les postes , les 35 heures .
Une réflexion plus générale concerne le statut présent de GIE du GANIL qui arrive a son terme en 2006.Cette réflexion n'est pas indépendante de l'étude en cours d'une installation européenne de seconde génération de type ISOL (EURISOL) que coordonne le GANIL et que la communauté GANIL verrait avec plaisir s'installer a Caen vers 2010 et devenir ainsi le Laboratoire européen pour la physique des états extrêmes de la matière nucléaire .
Examen à 4 ans de l’ISN Grenoble
Représentants de la section 03 du Comité National : R. Baumgarten, A. Falvard, R. Frascaria
La visite de la délégation du Comité National a été organisée conjointement avec celle du Comité d’Evaluation de l’ISN qui se déroulait le 7 Octobre. Deux des membres de la section étaient également membres du CE et le troisième a pu siéger à l’ensemble de ses auditions et discussions.
Présentation générale
L’Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble est une UMR tripartite (UMR 5821) associant le CNRS/IN2P3, l’Université Joseph Fourier et l’Institut National Polytechnique de Grenoble. Depuis 1995 la direction en est assurée par Joël Chauvin. La succession annoncée pour la durée du prochain plan quadriennal semble devoir se faire dans de bonnes conditions, le laboratoire ne manquant pas de personnalités aptes à occuper cette fonction. Le directeur est entouré d’un conseil de laboratoire, d’un conseil scientifique, d’une commission du personnel et d’un comité d’hygiène et de sécurité.
L’ISN occupe un vaste ensemble immobilier appartenant à l’UJF et situé dans le polygone scientifique de Grenoble; le CNRS aide à en assurer la rénovation pour le développement des activités de recherche de l’Institut. En particulier l’ancien halle de Sara recevait au moment de la visite du Comité National ses premiers éléments de R&D pour les sources d’ions.
L’environnement scientifique grenoblois est de très haut niveau et l’ISN y tient son rang. L’impression générale est celle d’un laboratoire très vivant, ayant su gérer dans un intervalle de temps court des évolutions thématiques profondes : transition, après l’arrêt de Sara, vers une activité forte sur l’aval du cycle électronucléaire et les nouveaux systèmes pour la production d’énergie électronucléaire, développement de l’activité de physique des particules avec une très belle contribution à l’expérience ATLAS, émergence remarquable des thématiques astroparticules. Sur ce dernier point on doit noter un rapprochement significatif avec les astrophysiciens du LAOG au niveau de la formation de 3eme cycle et de l’animation scientifique par la création de Cosm’Alpes. Cette dernière est un exemple de l’implication des jeunes chercheurs dans la vie du laboratoire, encouragée par l’actuelle direction dont on ne peut que se féliciter.
L’organisation des services techniques a fait la preuve qu’elle permettait au laboratoire de s’impliquer avec succès dans des développements instrumentaux de grande ampleur dans les collaborations internationales les plus exigeantes. Il convient également de noter que ces services ont su acquérir de nouvelles techniques avec les contraintes de l’assurance qualité, entre autres pour l’électronique et la mécanique spatiales. De ce point de vue le laboratoire a un plan de formation et les personnels sont en général satisfaits des opportunités mises à leur disposition dans ce domaine.
Une activité importante se développe autour de la valorisation et du transfert de technologie avec des partenaires régionaux et un interface physique-médecine qui s’amplifie; plusieurs de ces activités s’appuient sur les compétences en physique des accélérateurs de l’ISN. On doit noter aussi le grand dynamisme du service des sources d’ions.
Au premier rang des difficultés actuellement rencontrées se trouve l’avenir du groupe de physique théorique dont l’interaction avec les chercheurs du laboratoire est bonne et auquel les physiciens expérimentateurs sont attachés. Un autre point qui mérite une attention toute particulière est l’articulation entre le petit groupe de physique nucléaire fondamentale et celui étudiant les systèmes nouveaux de l’électronucléaire.
L’implication des personnels de l’ISN dans l’enseignement est importante dans tous les cycles de formation universitaires. Cela prend entre autres la forme d’enseignements spécifiques à l’UJF et à l’ENSPG auxquels prennent part, outre les enseignant-chercheurs, un nombre important de chercheurs et d’ITA. Pour ce qui concerne la formation doctorale, le laboratoire est associé à deux DEA. La filière de physique subatomique du DEA de Physique de la matière et du rayonnement semble rencontrer un vif succès. En plus des stagiaires de DEA l’ISN accueille chaque année un nombre important de stagiaires (de l’ordre d’une cinquantaine). Par ailleurs le nombre de Thèses soutenues chaque année est important ; 22 doctorants mènent actuellement leur travaux au sein de l’ISN
Les personnels
L’activité de recherche du laboratoire est menée ou soutenue par 166 permanents dont 23 enseignant-chercheurs, 39 chercheurs CNRS, 98 ITA CNRS et 6 IATOS de l’Université Joseph Fourier.
Parmi les 23 enseignant-chercheurs effectuant leurs travaux de recherche au sein de l’ISN, 19 sont enseignants à l’Université et 4 à l’Ecole Nationale Supérieure de Physique de Grenoble. L’évolution depuis 1997 de ce nombre d’enseignant-chercheurs est préoccupante, faisant apparaître une diminution de 40% de ces effectifs. Il y a là au premier ordre un effet mécanique de la pyramide des âges de l’ISN associé à la volonté de redéploiement des emplois de physiciens vers d’autres disciplines, phénomènes qui est d’ampleur national. Il convient de mentionner que cette diminution des effectifs n’est pas liée à un manque de dynamisme et d’implication des personnels dans l’Université ou à l’ENSPG: ceux ci ont au contraire exploité toutes les possibilités de développement de filières et un certain nombre d’entre elles sont reconnues comme très attractives pour les étudiants. Pour l’avenir l’Université et l’ENSPG ont indiqué clairement leur souhait de maintenir un bon potentiel d’enseignement au cœur de l’ISN. Cela passe aussi par des arbitrages entre physiciens dans un milieu très concurrentiel. L’exemple de l’année en cours permet un certain optimisme puisqu’un enseignant chercheur va être recruté alors qu’il n’y avait pas de départ en retraite. Une difficulté résultant de ces arbitrages pourrait être de ne pas irriguer de manière satisfaisante l’ensemble des composantes de recherche du laboratoire.
Globalement le potentiel d’ITA CNRS est pratiquement resté stable avec une évolution des catégories d’agents vers les métiers d’ingénieurs et une diminution des personnels de catégories B, essentiellement dans le corps des Assistant Ingénieurs. Pour positive qu’elle apparaisse pour les activités de l’ISN, les physiciens font ressortir que cette évolution a vraisemblablement atteint sa limite, l’importance des Assistant-Ingénieurs entre autres dans le travail quotidien étant souligné ainsi que la nécessité de s’appuyer sur un nombre suffisant d’entre eux.
Le budget
L’essentiel du fonctionnement du laboratoire est assuré par une dotation d’environ 7,5 MF (dont 2,5 MF pour les frais de mission) en très légère augmentation depuis 10 ans. Une contribution d’environ 750 kF par an avec des fluctuations d’une année sur l’autre est également affectée par le Ministère de la Recherche et par l’UJF (pour l’entretien des locaux). Les points qui doivent être notés sont la forte augmentation des financements par Autorisation de Programme pour une grosse part imputable à l’activité ATLAS et l’augmentation importante depuis l’année 2000 des ressources propres (environ 5 MFF en 2001) émanant de l’Europe, de la Région, du CNES et de divers contrats liés en particulier au domaine du spatial et des sources d’ions. Les programmes interdisciplinaires du CNRS (PACE, IPA) contribuent également à soutenir fortement l’activité de l’ISN. Le budget total du laboratoire en 2001 s’est établi à une valeur record sur les dix dernières années, 22,5 MF.
Les activités de recherche
L’évolution du programme de recherche de l’ISN depuis l’examen précédent a été importante :
- Disparition de l’activité neutrino au sol avec une reconversion vers la recherche de neutrinos de très haute énergie dans le cadre du projet EUSO
- Arrêt de l’expérience DELPHI et mise en place d’une activité sur l’expérience D0 à Fermilab comme expérience relais avant ATLAS.
- Développement du programme de cosmologie observationnelle avec l’implication réussie dans Archeops et Planck Surveyor.
- Evolution du groupe réacteurs avec un intérêt marqué pour la conception d’un réacteur à sels fondus
- Développement de nouvelles activités de valorisation et de transfert de technologie
Globalement le fait marquant de ces quatre dernières années est sans doute, après une phase d’émergence, la consolidation d’un axe de recherche astroparticules avec l’implication forte de l’ISN dans trois programmes majeurs du domaine : AMS, Archeops/Planck, projet EUSO.
Celle ci s’est faite sans pénaliser de manière visible les autres actions majeures du laboratoire que sont ATLAS, l’activité sur les réacteurs du futur et l’aval du cycle, la physique hadronique à Jlab.
Delphi, ATLAS,D0
8 chercheurs CNRS et 3 enseignant-chercheurs consacrent au sein de l’ISN leur activité de recherche à des activités de physique des particules. Les derniers travaux exploitant les données de Delphi ont porté sur la recherche d’éventuelles particules supersymétriques et de leur désintégration avec violation de la R-parité. Les physiciens se sont ensuite orientés vers les activités D0 et ATLAS. L’ISN a pour l’instant consacré ses efforts sur une seule expérience au LHC où il a des contributions bien identifiées, à la fois dans les domaines du hardware et du software de l’expérience. Il convient de noter en premier lieu la remarquable réalisation du pré-échantillonneur de gerbe du calorimètre électromagnétique central à argon liquide. Les premiers modules sont prêts sous gaz inerte, attendant d’être transportés dans les délais au CERN. D’autres réalisations techniques très significatives ont été apportées dans des domaines variés utilisant les compétences techniques présentes au laboratoire, en particulier les compétences en cryogénie. L’ensemble de ces travaux a utilisé une part très importante du potentiel technique du laboratoire et leur réalisation a été rendue possible par une planification très rigoureuse dans la réalisation des tâches qui a été acceptée par les personnels impliqués. L’ISN est également très présent dans l’élaboration des logiciels et dans la préparation de la physique d’ATLAS où ses physiciens ont des responsabilités importantes. On sent néanmoins la préoccupation que le groupe ATLAS reçoive en temps et en heure les renforts pour concrétiser cet effort lourd dans les analyses de physique. Une contribution majeure devrait venir des physiciens actuellement impliqués dans D0 dont le potentiel de 3 permanents a été renforcé cette année par un recrutement CNRS.
La contribution hardware de l’ISN à D0 est dédiée à la mesure de la pureté de l’argon du calorimètre. Les implications software sont importantes : identification des électrons, quark b, Monte Carlo Susy et les sujets de physique fortement connectés aux leptons. Ceci laisse présager une bonne valeur ajoutée si ce groupe sait réinvestir ses efforts dans ATLAS au bon moment.
AMS, Archeops/Planck, projet Euso
10 chercheurs et 7 enseignant-chercheurs sont impliqués à l’ISN sus des expériences ou des projets touchant aux astroparticules ou à la cosmologie observationnelle. Les physiciens impliqués jusqu’alors dans les activités auprès du Bugey se sont principalement réorientés vers le projet EUSO. Le fil conducteur reste les neutrinos que l’on souhaite étudier ici dans leur composante de très haute énergie au delà de la coupure GZK. Ce groupe de cinq chercheurs et deux enseignant chercheurs a des atouts importants et se consacre avec ses collaborateurs à l’étude de Phase A. Le projet hardware concerne l’électronique front end analogique.
Le petit groupe AMS (1 chercheur et 3 enseignant-chercheurs) fait preuve d’une activité de haut niveau. Après la réussite de la phase 1 le groupe a participé activement à l’analyse des données. Pour la phase 2 qui sera installée mi 2005 sur la Station Spatiale Internationale le groupe a fortement contribué au développement du détecteur Cerenkov d’AMS et de l’électronique front end. Il a par ailleurs une excellente activité phénoménologique sur un spectre large d’études liées au potentiel de physique d’AMS. Un soutien par le recrutement d’un chercheur rompu aux techniques d’analyse sur un dispositif proche des expériences de physique des particules serait sans doute appréciable pour ce groupe avant l’installation d’AMS sur l’ISS.
Le groupe travaillant sur Archeops/Planck (4 chercheurs et 2 enseignant chercheurs) a su parfaitement réaliser son intégration dans ces projets. Le groupe grenoblois a développé les outils de calibration au sol, les polariseurs et le système d’étalonnage associé pour Archeops. Il a participé à la préparation des vols ballon et contribué de façon importante à l’analyse des données qui ont conduit à l’obtention du spectre de puissance raccordant les données de COBE avec les données antérieures au delà du premier pic acoustique, résultat qui est sans aucun doute un des résultats phare du domaine astro/cosmo particule de l’année. La présence à Grenoble du CRTBT et du LAOG travaillant étroitement avec l’ISN est un atout important pour le campus grenoblois. La continuation dans Planck se fait naturellement avec ce groupe maintenant rompu aux techniques d’analyse spécifiques à ce type d’expérience et qui apporte des contributions techniques importantes. Il faudra veiller à maintenir le potentiel de recherche de ce groupe pour qu’il puisse rester au meilleur niveau qu’il occupe actuellement sur un sujet très concurrentiel.
GRAAL, JLAB
6 chercheurs et deux enseignant chercheurs contribuent au développement des recherches dans le domaine de la physique hadronique.
Le groupe qui travaille sur GRAAL (2 chercheurs CNRS, 1 enseignant-chercheur) est dans une situation ambiguë. La cible polarisée développée par les chercheurs de l’IN2P3 va être installée. Par contre la participation de l’IN2P3 aux frais généraux du dispositif en association avec les italiens va disparaître. On peut imaginer un an de prise de données en 2003 et une finalisation des analyse d’ici 2004. Les membres du groupe n’ont pas une position commune sur l’avenir qui se fera pour chaque personne sur un base d’intérêt personnel.
Une équipe de 4 chercheurs CNRS et un enseignant chercheur s’est impliquée depuis une dizaine d’années sur les activités menées par des groupes de l’IN2P3 sur la machine CEBAF au Jefferson Laboratory (JLAB). Ce groupe a participé régulièrement à des expériences de physique dans lesquelles il ne prenait pas systématiquement de réalisation technique (on doit toutefois noter la contribution importante au polarimètre de T20). A côté de cela il joue un rôle essentiel dans l’expérience G0 à la fois sur le hardware que sur le software. Au delà de l’expérience G0, dans laquelle l’équipe voit son avenir pour encore 4 ou 5 années, le groupe se pose la question de son futur qu’il voit dans le domaine de la physique du confinement des quarks dans le nucléon. Diverses options sur lesquelles les physiciens se donnent le temps de la réflexion sont envisagées allant de la participation au programme de JLAB avec une augmentation de l’énergie à 12 GeV à diverses solutions européennes. Une échéance de deux ans pour faire cette arbitrage leur paraît raisonnable.
Structure nucléaire, Physique des réacteurs
La tradition de physique nucléaire fondamentale de l’ISN reste représentée par un petit groupe de deux physiciens très actifs (1 chercheur CNRS et 1 enseignant chercheur). Ce groupe travaille par exemple sur l’étude des noyaux exotiques riches en neutrons proches du noyau doublement magique 132 Sn. Il utilise entre autres les installations de l’ILL (Lohengrin) pour lesquelles il y a un projet de développement. Le groupe travaille aussi au GSI Darmstadt, à ISOLDE au CERN et à GANIL.L’avenir de cette activité à l’ISN reste problématique. Le comité pense que le maintien de cette compétence au sein de l’ISN devrait être examinée avec attention en relation avec le groupe de physique des réacteurs.
Le développement de la physique des réacteurs à l’ISN a été extrêmement important et l’équipe grenoblois (3 chercheurs CNRS et 5 enseignant chercheurs) est un groupe de premier plan de l’IN2P3. Elle agit en premier lieu dans le cadre du programme PACE du CNRS au sein du GRD GEDEON. Ces dernières années ont vu une évolution du groupe. Longtemps impliqué sur les questions liées à l’aval du cycle électronucléaire, il marque actuellement une claire réorientation vers la définition d’un réacteur à sels fondus qui est une option intéressante pour les réacteurs nucléaires du futur. Dans le premier cas il s’agit de travailler sur l’incinération des déchets dans des réacteurs sous critiques de type ADS dont un prototype est le réacteur MUSE du CEA. L’avenir de ce programme à l’ISN est conditionné par l’évolution du programme MUSE au CEA. Le calendrier de la mise en place d’un démonstrateur étant problématique les physiciens grenoblois se sont intéressés à la gestion des déchets dans le cadre d’un nucléaire pérenne dont les réacteurs à sels fondus sont un scénario possible. Une des grandes difficultés est de mobiliser une communauté de chimistes sur ce programme. Il nous semble que malgré l’attrait indéniable de ces nouveaux développements le groupe de l’ISN ne doit pas se retirer trop de ses options anciennes fortement axées sur la physique nucléaire. Il devrait aussi inclure, si possible, dans sa stratégie de développement le rapprochement avec le groupe de structure nucléaire afin qu’une compétence de physique nucléaire fondamentale utile pour la physique nucléaire appliquée soit pérennisée à l’ISN.
Autres programmes pluridisciplinaires
L’ISN utilise ses compétences sur les accélérateurs et sur l’instrumentation des expériences dans le cadre de développements élaborés en collaboration avec le milieu médical. Il y a d’abord le projet ETOILE. C’est un projet de hadronthérapie en association avec Lyon dans un cadre rhône alpin. Ce projet est ambitieux et associe de nombreux partenaires dont le responsable technique est un membre de l’ISN. Le laboratoire fait ici partager ses compétences dans le domaine des accélérateurs de particules et dans celui de la production d’ions. Outre le cadre rhône alpin spécifique à ETOILE ces développements se sont dans un cadre européen.
L’équipe ATLAS de l’ISN s’est lancée dans une valorisation de ses travaux pour la définition de l’imagerie par tomographie à émission de positrons (TEP). L’innovation est ici de remplacer les cristaux utilisés classiquement pour la détection de photons de basse énergie par du xenon liquide. Ce travail est pour l’instant effectué dans le cadre de l’imagerie du petit animal. En plus de développements hardware le groupe participe à un effort collectif de développements software pour l’imagerie utilisant GEANT4.
Le point qu’il convient de noter est que dans ces deux cas les travaux sont menés en partenariat étroit avec les utilisateurs potentiels des instruments. Ceci est évidemment important pour le succès de ces projets de grande qualité.
Théorie
Le groupe de Physique Théorique de l’ISN est actuellement constitué de trois chercheurs CNRS et de 4 enseignant chercheurs. Le thème fédérateur de ces diverses activités est actuellement celui des systèmes à petit nombre de corps pour lequel l’ISN a développé une expertise très pointue, très reconnue et utile pour une partie du programme de physique expérimental de l’ISN. Le problème qui se pose à������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ce groupe est celui de sa pérennité en raison de sa pyramide des âges. Une réflexion et une action éventuelle doivent être menées à brève échéance. L’option qui consisterait à maintenir comme axe de compétence principal celui des systèmes à petit nombre de corps nous paraît difficile à tenir, en tous cas vis à vis du CNRS. L’Université a sans doute la possibilité de jouer un rôle spécifique dans ce cas d’espèce. La pluridisciplinarité naturelle des recherche en physique théorique est peut être un argument fort à développer au niveau du campus grenoblois ou au niveau national, dans le cadre de problème qui par exemple touchent à la complexité. Par ailleurs le démarrage de nouveaux thèmes de recherche, proches de la physique des particules, de la cosmologie ou de l’astroparticule, serait sûrement une option prioritaire.
Accélérateurs, sources d’ions
La tradition accélérateur de l’ISN constitue incontestablement un plus pour ce laboratoire, même si les programmes de physique nucléaire lourds ont fait la place à des expériences utilisant principalement des machines sur des sites extérieures, lorsqu’il ne s’agit pas de sites cosmiques. Le développement du projet ETOILE est un bon exemple d’une implication forte spécifique de l’ISN dans le tissu régional. Le laboratoire joue également une part active dans le développement de IPHI (Injecteur de Protons de Haute Intensité). Ce projet CEA/IN2P3/CERN s’inscrit dans un programme d’accélérateur de haute puissance destiné à diverses applications : réacteurs pilotés par accélérateurs, incinérateurs, sources de spallation, … les activités de l’ISN sont variées et significatives dans le développement du linéaire(DTL) associé. L’autre implication forte du groupe accélérateurs est la conception de GENEPI 1 et 2
(Générateur de Neutrons Pulsés Intense). GENEPI a été couplé à Masurca pour obtenir une configuration sous critique MUSE4 en 2000. On ne peut que regretter ici le retard au programme lié, sans doute de façon légitime, à des contraintes fortes de sécurité. La connexion entre ce groupe accélérateur et le groupe réacteurs est évidemment très forte et constitue un élément positif pour l’ISN. Les personnels tiennent à attirer l’attention sur le fait que des possibles pertes de compétence pourraient advenir si les transitions ne sont pas suffisamment anticipées au moment des départs en retraite. Cette préoccupation est évidemment générale mais sans doute plus marqué dans un domaine aussi spécifique que celui des accélérateurs où il n’y a pas de vaste vivier national de recrutement.
Le service des sources d’ions est un service menant des activités de pointe dans les sources à résonance cyclotronique. Il est engagé dans de la R&D sur plusieurs grands programmes européens ou internationaux et notamment dans le développement des faisceaux d’ions lourds pour LHC.
Les services techniques administratifs
Les services techniques et administratifs sont organisés en 8 services autour des quatre grands thèmes, :administration, électronique, informatique, mécanique.
· Administration : Services administratifs, généraux, hygiène et sécurité
· Electronique : Services d’Electronique et Microélectronique
· Informatique : Service d’Informatique, Acquisition des données
· Mécanique : Service d’études et de réalisations mécaniques
Il est à noter que le laboratoire s’est doté d’un Service de Détecteurs et Instrumentation. Les groupes de Physique sont contents du support apporté par ce service. Il doit finir de trouver sa place dans l’ensemble des services techniques ; faisant par nature appel aux compétences des autres services il peut y avoir des questions d’interface à gérer, mais globalement le bilan est très positif. Les discussions avec les services ont fait apparaître la préoccupation commune de bien assurer les transitions au moment des départs en retraite en particulier pour les postes clefs. Ceci a été la plupart du temps bien réalisé. Par ailleurs la perte des catégories plus basses d’ITA au profit des catégories plus élevées est très globalement positive pour la dynamique du laboratoire. Les physiciens comme les ITA insistent sur la fait que l’on s’approche ici de la limite acceptable pour le bon fonctionnement du laboratoire ; leur remarque semble légitime.
Il est à noter que l’organisation matricielle des services donne de la souplesse et en principe une efficacité optimum. L’exemple réussi de ATLAS montre que cela a toutefois pour prix une organisation très bien programmée qui n’est peut être pas garantie en toute circonstance. Le professionnalisme des personnels au divers niveaux, leur évolution dans le domaine de la qualité doivent être salués.
Le laboratoire est également actif dans le domaine de la valorisation en dehors du domaine médical qui a déjà été mentionné. Cette valorisation se fait au contact du tissu industriel local. Le laboratoire de basse radioactivité du laboratoire est également un acteur de cette valorisation.
La pyramide des âges laisse anticiper un départ important d’ITA du CNRS dans le prochaines années (27 d’ici 2006 pour 104 ITA actuellement). Ceci est une source d’inquiétude.
Conclusions générales
La visite de l’ISN de Grenoble a fait apparaître un laboratoire très dynamique, ayant su gérer ses évolutions et faire des choix scientifiques non triviaux, avec une évolution concomitante des services techniques. Des questions pour l’avenir se posent pour les groupes impliqués dans le domaine de la physique hadronique mais les physiciens envisagent les années à venir dans un esprit d’ouverture pour faire le meilleur choix au moment opportun. L’évolution du service de physique nucléaire devrait être imaginé dans une réflexion apaisée avec le groupe des réacteurs nucléaires. L’avenir du groupe de physique théorique reste problématique mais pourrait trouver une issu avec une évolution thématique au moins partielle.
Une présence forte auprès de l’Université et de l’INPG doit permettre le maintien au sein de l’ISN d’une composante solide d’enseignant chercheurs de notre secteur disciplinaire sur le campus grenoblois.
Sur le plan des services techniques leur organisation interne a prouvé son efficacité en face des gros projets. Il faudra maintenir une composante suffisante en son sein de personnels de catégorie B.
Premier examen à 4 ans du GAM
Alexandre Rozanov,
Maryvonne De Jesus, Jean-Pierre Barbe
La visite s’est déroulée le mardi 15 Octobre 2002 dans le cadre de l’examen à 4 ans et du renouvellement de l'unité. Après un entretien introductif avec le directeur , nous avons rencontré les groupes de physique, les représentants des services techniques du site Themis, les représentants ITA, l’ensemble du laboratoire hors directeur et doctorants/post-doctorants. L’impression générale est très positive : le laboratoire est jeune et très dynamique.
A - PRESENTATION GENERALE DU LABORATOIRE
Le Groupe d’Astroparticules de Montpellier a été crée à compter du 1er septembre 2000 par le CNRS comme Formation de Recherche en Evolution (FRE 2276) avec l’appui de l’Université Montpellier-2 (UM2). Depuis janvier 2001, le GAM est une Unité Mixte de Recherche (UMR 5139) associant l’IN2P3/CNRS et l’université de Montpellier-2. Le GAM est dirigé depuis sa création par M. Alain FALVARD.
Le laboratoire est installé dans le bâtiment de l’Université Montpellier-2 dans 5 bureaux d’une surface de 80 m2. Le projet d’extension (+ 220 m2 ) existe et doit aboutir en 2003.
Les thématiques de recherche relèvent des domaines suivants :
Astronomie gamma au sol (Céleste)
Astronomie gamma embarque (AMS)
Recherche de la matière noire non baryonique (GDR PCHE)
Les
effectifs et leur évolution
|
EFFECTIFS 2002 |
|
|
Chercheurs CNRS 3 |
A.Falvard(DR2), A.Jacholkowska(CR1) F.Piron(CR2) |
|
Enseignants – chercheurs 1 |
Eric Nuss (MC) |
|
Doctorants 4 |
|
|
Personnels techniques 4
|
TCN+IR2+AI+CDD |
|
|
E.Giraud (Astr.Adj/) |
|
Visiteurs/postdoc 2 |
J.Bussons-Gordo, M.Sapinsky |
On peut noter :
· Des effectifs chercheurs et personnels techniques en très rapide augmentation
· Une pyramide des âges très jeune
·
Absence de personnel technique de l’Université
· Avec un taux d’environ 1 doctorant par chercheur, le GAM donne un très bon l’exemple de la formation des jeunes chercheurs.
· Un rapport ITA/chercheurs d’environ 1
· Un renforcement important des effectifs est attendu au janvier 2003 avec l’arrivée de Yves Gallant (CR1), un IR informatique en procédure NOEMI et Stéphane Rivoire (AI électronique pour le site Thémis)
Le budget
|
Le budget (kF) |
Fonctionnement |
Equipement |
CELESTE +
Thémis |
Autres |
Total |
|
|
IN2P3 MENRT+Region |
IN2P3 MENRT+Region |
IN2P3 MENRT+Region |
IN2P3 MENRT+Region |
|
|
2000 |
350 |
|
|
|
350 |
|
2001 |
350 35 |
400
226 |
400
170 |
85 0 |
1666 |
|
2002 |
450 35 |
290
21 |
698
0 |
60
0 |
1554 |
On pourra noter par ailleurs un financement significatif de la Région en 2001.
B - ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Expérience CELESTE
Le GAM est impliqué dans l’expérience CELESTE depuis janvier 2001. Ce groupe a participé à plusieurs aspects de l’expérience : prise de données, maintenance du détecteur, algorithme de mesure de l’énergie, rejet de bruit de fond, mise en œuvre du Lidar et la recherche de la matière noire non baryonique.
La spécificité de CELESTE est de réutiliser les héliostats de l’ancienne centrale solaire THEMIS pour la détection de la lumière Cerenkov produite par des gerbes atmosphériques. Cette grande surface de détection permet à CELESTE d’avoir le seuil de détection des gammas le plus bas au monde (50 GeV). Les motivations physiques sont d’un coté de contraindre les modèles d’émission à hautes énergies des noyaux actifs des galaxies, blazars et pulsar ; et de l’autre coté de découvrir de nouvelles sources de blazars, pulsars, fond diffus galactique, matière noire SUSY. Huit physiciens GAM, dont 2 doctorants participent dans la collaboration (5 instituts français et l'Université de Prague, plus de 22 physiciens).
Les physiciens du groupe prennent régulièrement part aux prises de données de l’expérience, assurant plus d’un tiers de la charge. Le GAM est responsable de la calibration en temps de l’appareil, de la calibration des courants, de la simulation de l’électronique. La saison 2002/2003 est très importante pour confirmer l’avantage du passage de 40 à 53 héliostats et l’utilisation de veto pour la sélection des gerbes.
Ce groupe joue un rôle important pour l'exploitation du LIDAR, laser pulsé capable de mesurer les caractéristiques de l’atmosphère sur une dizaine de kilomètres. Le travail sur le contrôle de l’atmosphère pour l’analyse des données et les programmes de simulation est mené au GAM.
Une nouvelle méthode de mesure d’énergie des gerbes et rejet de bruit de fond a permis d'atteindre une résolution de 30%. Ce travail sera utilisé dans la publication sur la nébuleuse du Crabe et sur le blazar Mkn421. Les coïncidences avec les événements du détecteur CAT doivent améliorer les systématiques sur l’échelle absolue de l’énergie des gerbes.
Le GAM a prépare des propositions d’observation (M31, Draco) pour la recherche de matière noire non baryonique de type neutralino.
Les physiciens du GAM ont préparé 10 notes internes de la collaboration CELESTE, un papier sur l'annihilation neutralino dans M31 publié comme preprint astro-ph (soumit à Astrophysical Physics Journal). Un autre article sur le spectre de la nébuleuse du Crabe et une contribution à l’article sur Mkn421 sont en préparation pour la fin 2002.
Expérience AMS
Le GAM est impliqué dans l’expérience AMS depuis le printemps 2002. L’expérience AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) sera embarquée sur la Station Internationale Spatiale (ISS) en 2005. Le GAM s’est impliqué dans l’étude des photons de hautes énergies 2-1000 GeV avec le calorimètre électromagnétique ECAL. Cette orientation est motivée par les études de la matière noire et astronomie gamma des pulsars et GRB. Sept physiciens GAM, dont un doctorant participent dans AMS. Cinq physiciens sont impliqués en même temps sur CELESTE et AMS.
Les principales activités du groupe AMS sont sur l’étude le trigger basse énergie avec réduction de seuil jusqu’à 2 GeV, participation aux faisceaux de calibration du ECAL au CERN, production des données Monte-Carlo pour les études photon/électron, modélisation théorique des GRB et prédictions pour AMS. Le GAM à la responsabilité du groupe physique des GRB et envisage de s’impliquer dans le Slow Control du ECAL.
Animation GDR-PCHE
Les
physiciens du GAM étaient parmi les créateurs d’un groupe pour l’étude de la
recherche indirecte de matière noire non baryonique dans le GDR PCHE. Cinq
physiciens du GAM participent dans ces activités et la co-coordination du
groupe est assuré par le GAM. Les objectifs
sont d’organiser les études de cette recherche, collaborations plus étroites
entre expériences, phénoménologie,
astrophysique et développement d’outils associés. Ce travail a permis une bonne
compréhension des outils de simulation (darkSusy + SUSPEC) et une comparaison avec les benchmarks. Les prédictions
des flux de gamma par les modèles MSUGRA pour CELESTE avec le Crabe comme source a donné 5 photons/mn. Les
projets futurs incluent le développement d'outils de simulation, prédiction
d’autres sources (Centre Galactique, DRACO, fond diffus), interprétations
phénoménologiques des scenarii alternatifs et cas non minimaux.
Prospectives
La fermeture officielle de CELESTE est programmée pour l'automne 2004. Les physiciens du GAM souhaitent poursuivre les études de l’univers au moyen de l’astronomie gamma de haute énergie. Les sujets de physique privilégiés par le GAM sont la recherche de signaux photoniques de matière noire non baryonique et l’étude des sursauts gamma. Les thèmes de réflexions sur la prospective incluent le projet de participation à HESS, études de la feasabilité de Large Cerenkov Array (LCA) ou participation à l’expérience GLAST sur satellite.
C - SERVICES TECHNIQUES
Le GAM dispose actuellement de 4 postes ITA. Le problème de la pyramide des âges n’est
pas évoqué au GAM vue la jeunesse du
laboratoire. L’ensemble du personnel technique a exprimé la confiance en la direction du laboratoire et en sa méthode de
gestion.
Site GAM
Le service est composé de 2 postes ITA basés au GAM : un pour le Secrétariat de Gestion (TCN) et un pour l'informatique (IR2). Il est prévu une arrivée au 1er janvier 2003 d’un IR informatique en procédure NOEMI. Au 1er janvier 2003 il y aura 3 ITA sur le site de Montpellier : 1 TCN secrétariat/Info, 2 IR Informatique. Actuellement il y a clairement le manque de place dans les bureaux, mais le problème devrait se résoudre très prochainement avec le déménagement dans les nouveaux locaux en cours de rénovation. Les améliorations dans l’informatique sont attendues prochainement avec le passage sur le réseau haut débit Renater et l’arrivé du nouvel IR informatique. Le service assure les missions de gestion administrative générale, la gestion de tous les personnels permanents et non-permanent, la gestion des finances, des missions, de secrétariat, organisation des séminaires et enfin la gestion de la documentation.
Site THEMIS
Le service est composé de 2 postes ITA sur le site de THEMIS : 1 informatique (AI) + 1 CDD. Un AI électronique devrait arriver au 1er janvier 2003. Certaines inquiétudes sur l’intégration des ITA sur le site THEMIS dans le GAM se sont résolues quelques jours après notre visite. L'ensemble des ITA travaillant sur le site de THEMIS est affecté au GAM. Au 1er janvier 2003 il y aura 3 ITA sur le site de Thémis, 1 TCN, 2 AI. La prise des données de CELESTE pendant les nuits demande une grande disponibilité des ITA, cette astreinte a été assurée jusqu'à maintenant grâce à leur bonne volonté et leur enthousiasme. Néanmoins il serait souhaitable qu'un système de compensation d’astreinte soit étudié afin de régulariser cette situation.
D - RELATIONS AVEC L’ENSEIGNEMENT ET L’INDUSTRIE
Le GAM est très actif au sein de l’université de Montpellier-2. Au niveau de la Maîtrise de Physique un cours/TD de 25 heures « Astroparticules » a été introduit et assuré par E.Nuss (MC) du GAM. Il est aussi responsable de l’enseignement de l’informatique aux physiciens, chimistes, biologistes des DEUG. Au niveau de l’école doctorale « Terre Eau Espace », un cours de 20 heures « Instrumentation en astrophysique et physique des particules » est assuré par E.Giraud. L’affectation de deux demi ATER pour l’année 2000/2001 a permis de recruter Julien Croix et Gérald Grenier, qui ont joué un rôle important au démarrage du laboratoire. En 2001/2002 GAM a accueilli 21 étudiants en stage de divers niveaux et 4 doctorants. C’est une excellente performance pour le groupe de 7 physiciens. A l’horizon 2003 le recrutement d’un professeur et d’un maître de conférence au GAM est prévu par UM2.
Le projet DEA intitulé « Cosmos Champs et Particules » a été soumis au ministère dans le cadre du plan quadriennal de l’UM2. Ce projet a pour but de créer la première formation de DEA entièrement consacrée aux thématiques de l’astroparticule.
Le GAM est aussi très engagé dans les actions de communications en organisant trois Bars des Sciences, des conférences dans les Lycées et l’accueil de lycéens. Le GAM est en charge pour le CNRS d’être l’interlocuteur de Solytec qui a la responsabilité du centre de communication scientifique sur le site de THEMIS, successible d’attirer 100000 personnes par an.
E - Rencontres avec l’ensemble du laboratoire, avec les doctorants et post-doctorants du GAM
Nous avons consacré du temps aux rencontres avec
l’ensemble du laboratoire et séparément avec les doctorants et post-doctorants.
Les chercheurs ont évoqué plusieurs points:
Ø le besoin de recruter des expérimentateurs
Ø les difficultés de recrutements de phénoménologues entre les commissions 02 et 03 par manque de postes
Ø le peu de possibilités en France de trouver des contrats post-doctoraux,
Ø l'absence de poste ATER au GAM en 2002
Ø la difficulté de trouver des postes de monitorat pour les doctorants
Ø les inquiétudes que le DEA « Matière condensé » a un profil trop lointain des intérêts des chercheurs du GAM,
Ø le souhait d’avoir les subventions pour les doctorants dans la cantine Universitaire.
F - CONCLUSION
Le GAM est un
laboratoire jeune et très dynamique. Ses choix scientifiques sur l’exploration
de l’univers avec les photons de hautes énergies forment un ensemble cohérent.
On peut noter la grande ouverture du laboratoire sur le monde extérieur, un nombre exceptionnel de stagiaires et
doctorants.
La production
scientifique du laboratoire est sur une bonne pente ascendante. Les axes de
recherche sont prometteurs à court et à longs termes. Les groupes du GAM sont
visibles, ont un impact important au sein des collaborations CELESTE et
AMS. Les physiciens du GAM abordent
très sereinement les prospectives du
laboratoire après la fermeture programmée de CELESTE en 2004.
L’évolution des
relations avec l'Université Monpellier-2 est très bonne. Le renforcement des
liens avec UM2 par des postes de professeur et de maître de conférence est très
souhaitable, surtout compte tenu du nombre d'étudiants en stage et de
doctorants dans le laboratoire. Ce point sera à surveiller dans
l’avenir. Le souhait des physiciens de renforcer par les prochains recrutements
le profil physicien-experimentateur semble très raisonnable.
La
commission félicite l’ensemble du laboratoire pour son dynamisme, la qualité de
ses recherches et sa grande ouverture vers le monde extérieur.
Examen à deux ans de l’IreS
M.BAUBILLIER, D.JOUAN et P.QUENTIN.
L’examen de l’IReS s’est déroulé dans un contexte
particulier découlant de la perspective de l’arrêt du Vivitron fin 2003. Malgré
la tension générée par cette décision et la difficulté d’accepter l’arrêt d’un
appareillage dont l’optimisation avait nécessité beaucoup d’effort et qui
atteignait son meilleur niveau, les
intervenant ont fait preuve d’une
responsabilité qui a impressionné les représentants de la section, en étudiant des solutions pour l’avenir y compris dans le domaine des faisceaux
stables en physique nucléaire. Cet examen faisait suite aux journées de Giens
sur la prospective de la discipline aux cours desquelles les projets pour la
physique nucléaire sont bien apparus, projets dans lesquels l’IReS a toute sa
place et pourrait y avoir un rôle de premier plan. Suite souvent à des départs, en particulier en retraite,
un certain nombre d’équipes se révèlent
réellement sous critiques en physiciens, comme Nemo, ou Alice, et ce phénomène va continuer. La nécessité de choix s’imposera à brève
échéance, ce qui imposera de définir des priorités qui devront s’attacher à
préserver les projets majeurs du laboratoire.
L’évolution des problématiques ou des techniques impose désormais
d’envisager les projets au niveau européen et d’y être parmi les premiers. Là
est certainement la voie pour l’IReS. Cependant une activité de Recherche et Développement
local, et éventuellement de Construction de masse doit être soutenue afin que la place de l’IReS sur le campus de
Cronenbourg et vis à vis de l’ULP soit bien visible et reconnue comme lieu
d’excellence. Parallèlement le programme du Vivitron sera mené à son terme
dans les meilleures conditions. Le reclassement et la formation du personnel ne
pourront intervenir qu’après l’échéance de fin 2003.
La
commission entend souligner l’évolution positive et remarquable du groupe CMS
et d’une manière générale de l’ensemble des activités du Département
« Quarks, leptons et noyaux chauds ». L’arrivée récente de F. AZAIEZ
à la tête du Département « Physique du Noyau et Aspects
Pluridisciplinaires »doit être considérée comme un élément très positif en
faveur du dynamisme des équipes, bien que l’on puisse souhaiter très fortement plus de sérénité dans les rapports humains.
Un élément important pour aider à ce qu’il en soit ainsi serait de spécifier
clairement quelles sont les responsabilités qui sont dévolues au Directeur
Scientifique du Département. Le rôle moteur de D.HUSS est reconnu dans ses
efforts pour faire évoluer l’ensemble du laboratoire, de clarifier ses
objectifs et d’accroître les relations avec les instances régionales. Toutes les structures du laboratoire
doivent maintenant travailler solidairement à la construction du futur du
laboratoire, qui s’annonce prometteur étant donné les compétences en présence
et les nombreuses perspectives de recherche ouvertes.
I Physique du Noyau et
Aspects Pluridisciplinaires.
-ViVitron et la physique au Vivitron et la spectroscopie g :
Présentée
par D.CURIEN.
Les
campagnes d’expériences menées auprès du Vivitron en 2000,2001et 2002 ont été
un réel succès grâce en particulier au détecteur EUROBALL. Des résultats sur les noyaux exotiques loin
de la vallée de stabilité, soit riches en protons, soit riches en neutrons ont
apporté un éclairage beaucoup plus vaste sur la complexité de la structure
nucléaire. De même l’observation de noyaux très déformés et de hauts spin
constitue un apport scientifique très important. Depuis 94, environ 235
publications ont été effectuées, soit plus de la moitié de celles du Ganil. En
2001 un workshop a réuni 100 physiciens sur « Future of Nuclear Structure
and g Spectroscopy with stable beams » illustrant la place qu’occupe
l’I������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ReS dans ce domaine scientifique. A posteriori l’entreprise du Vivitron
s’est révélée très fructueuse grâce aux efforts et aux compétences des
physiciens et ingénieurs parmi lesquels il faut citer Jean Pierre VIVIEN décédé
en avril.
-Spectroscopie
Particules(chargées). Présenté par C.BECK.
Le détecteur ICARE, « identificateur de charge à rendement élevé »
A donné naissance à une collaboration scientifique internationale portant le même nom. Un des résultats importants est la mise en évidence de configurations moléculaires dans les noyaux ainsi que l’on peut le découvrir dans le diagramme d’IKEDA étendu par W. von Oertzen allant du 12Be au 36Ar. Ces recherches sont menées à l’IReS, mais aussi à Legnaro et envisagées à Spiral. Le groupe est très dynamique et la physique très originale.
-
Spectroscopie neutrons. Présentée par L.STUTTGE.
Comme dans le cas précédent le groupe est actif et productif. Son appareil
est le détecteur DEMON. Il a des collaborations internationales. Deux thèmes se distinguent : «Etude de la structure des noyaux légers riches en neutrons » et la « dynamique des processus de capture dans la région des noyaux lourds et superlourds à basse énergie ».
-
Les Noyaux Exotiques et les
faisceaux radioactifs.
-
.
Présentés par Ph. DESSAGNE.
Les potentialités de physique dans ce domaine sont grandes en France et
le bilan du groupe très honorable en particulier en ce qui concerne Rex-ISOLDE. Cependant la taille du groupe est notablement sous critique puisqu’il ne comprendra plus que deux physiciens à court terme.
-Physique
Théorique. Présentée par F.NOWACKI.
Le groupe de physique théorique est de taille raisonnable et constitue un atout non négligeable du laboratoire. La collaboration entre théoricien et expérimentateurs est exemplaire pour l’IN2P3 et doit être soutenue. Il doit faciliter la définition du programme de la physique nucléaire de l’IreS.
-La
R&D pour le « Tracking Gamma » : AGATA.
Présenté par G.DUCHENE.
Parmi les projets de développements existe AGATA, détecteur de photons gamma très segmenté, appareil de la génération du 21ième siècle. Ce projet fait l’objet d’une collaboration internationale dans laquelle G.DUCHENE est le coordonnateur français. L’IReS développe des prototypes de détecteur en germanium pour lesquels le laboratoire a une longue compétence, et une tradition de collaboration avec la société Eurisys.
-La
Radioprotection et les Mesures Environnementales. Ramsès.
Présentée par A.NOURREDDINE.
Autour du professeur A.
Nourreddine une équipe d’ingénieurs et aides ingénieurs, et de doctorants ont
acquis un savoir-faire et une notoriété nationale incontestable qui devrait
être confirmées par une accréditation Cofrac en 2003 concernant l’analyse de
radionucléides dans l’environnement. Le groupe dispose d’un matériel très
conséquent et a des actions à l’échelle nationale. Il est important de conserver
cette activité sur le campus, pour ses qualités propres et aussi pour l'image
de l'IReS.
-La
Chimie Nucléaire. Présentée par G.DUPLATRE.
Autour de G.DUPLATRE une équipe relativement jeune
développe des activités de Chimie Nucléaire dans diverses directions et en
particulier pour l’aval du cycle parfois en collaboration avec le groupe
Ramsès. Elle est impliquée dans les GDR Practis et NOMAD. Elle travaille à la
chimie des actinides et des lanthanides en solution, au problème d’adsorption
d’actinides et lanthanides en surfaces et à la séparation de radioéléments à
partir d’échantillons de sols et d’eaux polluées. D’autres sujets sont
également traités comme les effets des radiations sur des systèmes organiques
d’intérêt biologique. Ce groupe mérite
d’être soutenu et encouragé. Sa pérennité à l’IreS est cruciale pour l’image du
laboratoire sur le campus.
-L’aval
du cycle : GRACE. Présenté par G.RUDOLF.
Ce groupe relativement modeste par sa taille vient de recevoir le renfort d’une Chargée de Recherche nouvellement recrutée. Il est en charge de la mesure des sections efficaces(n,xn) en particulier au Cern dans la collaboration n-TOF. Il prend part aussi à des mesures de spectroscopie g en ligne. Compte tenu de l’importance croissante de la question de l’énergie nucléaire et du retraitement des combustibles usés il faut continuer à soutenir cette activité. De bonne relations ( ou collaboration) avec les deux groupes précédemment cités semblent s’imposer de sorte que l’ensemble apparaisse comme très compétent et performant.
CONCLUSIONS
L’activité de l’ensemble des équipes de ce département a été excellente durant ces deux dernières années montrant la qualité et les potentialités des physiciens et ingénieurs. Pour les années à venir des orientations importantes sont à prendre, éventuellement des options ou même des choix à décider. La venue d’un Directeur Scientifique du Département, travaillant en accord avec la direction de l’IreS nous semble à priori aller dans la bonne direction. Sans mésestimer les difficultés liées entre autre à un fonctionnement plus centralisé, mais cohérent et solidaire, la section soutien cette évolution et souligne que l’IReS a une chance à saisir malgré une période difficile et quelque peu désagréable pour certains. L’IN2P3 doit tenir compte de ces faits et accorder une attention particulière à ce laboratoire. Ces conclusions ont été formulées « à chaud » devant l’ensemble du département et en présence de deux représentants de l’Université : Michel GRANET, vice-Président de la Recherche et la Formation Doctorale de l’ULP et Didier CHATENAY, chargé de mission pour la physique à l’ULP.
II QUARKS, LEPTONS et
NOYAUX CHAUDS.
Ce département a l’avantage de ne pas subir la tourmente occasionnée par l’arrêt de l’accélérateur et d’avoir tout à fait surmonté les difficultés causées par l’abandon de la solution MSGC pour CMS décidée au Cerne. Ce département à aussi l’avantage d’avoir des équipes qui collaborent avec celles de l’Université de Haute Alsace. Cependant il doit éviter la dispersion et opérer des choix à l’avenir. Quelles que soient les qualités individuelles des physiciens et ingénieurs, la crédibilité de l’ensemble est à ce prix.
-La physique des neutrinos :
-OPERA. L’expérience
OPERA est un challenge. Compte tenu des résultats expérimentaux sur les
oscillations neutrinos, les signaux attendus seront très faibles. Il est donc
primordial de disposer d’un trigger très efficace. L’équipe de l’IReS, sous la
direction de Markos Dracos a décidé de relever le défis en construisant le
Target Tracker comportant 62 murs de 8 modules avec 64 barreaux de
scintillateurs chacun, au sein d’une collaboration internationale. Un hall de
montage a été aménagé et le premier mur sera terminé en novembre 2002. Une coopération industrielle est
également engagée.
-ANTARES. Présenté par Chantal Racca. Ce groupe comprend 3 Physiciens : C.RACCA, T.PRADIER et O.SUVOROVA auxquels il faut associer A.ALBERT et R.BLAIZ de l’Université de Haute Alsace. Ce groupe comporte également deux ingénieurs très impliqués dans le projet. Le groupe prend part à la construction des cartes mères de lecture des données des photomultiplicateurs ainsi qu’au « Slow Control » de l’expérience. En outre une simulation du flux de neutrinos accompagnant un Gamma ray burst est en cours en collaboration avec l’observatoire de Strasbourg. Ce programme se déroule normalement.
-NEMO. Présenté par Roger Arnold. L’IReS a une longue tradition de participation aux expériences Nemo et sa contribution pour Nemo III est très conséquente et certainement plus importante que le nombre de physiciens impliqués ne l’aurait exigé, déjà. A l’avenir ce nombre est en passe de tendre vers l’unité…Bien que l’on doive admirer les contributions entre 2000 et 2002 pour : l’équipement des pétales(bouchons), les tests électroniques des compteurs à scintillation, leur calibrage et le contrôle de leur stabilité à l’aide de faisceaux lasers et enfin l’acquisition de données il semble clair que la pérennité de cette activité à l’IreS doit faire l’objet d’un choix. L’expérience a démarré en juillet 2002 fournissant de jolis événements.
-La physique
auprès des collisionneurs :
-D0 au FNAL. Présenté par D.BLOCH. Le groupe comprend
deux enseignants et 4 Cnrs.Il s’est intégré sans problème à l’expérience en phase de démarrage et s’est insérée dans l’analyse avec pour objectif la mesure de la masse du quark top. Le groupe se consacre aussi à la bonne marche du détecteur de vertex. Ce programme se déroulera normalement jusqu’en 2005, date à laquelle commencera le run IIb du Tevatron pour lequel une éventuelle participation de l’IReS relèvera d’un choix stratégique entre cette possibilité et les possibilités auprès du LHC..
-Capteur CMOS
et le NLC. Présenté par M.WINTER.
Ce développement de détecteur à pixels repose sur un concept novateur associant capteur et électronique associée. Il s’effectue au LEPSI depuis plus d’une année. Plusieurs prototypes ont été réalisés de dimensions de plus en plus importantes. Ce développement tire partie de l’expérience acquise par le passé au sein du LEPSI. Il devrait être le point de départ à plus long terme d’un groupe préparant la physique au nouveau collisionneur d’électrons.
-Les collisions d’ions lourds ultra relativistes :
-Star-Rhic et Alice-LHC. Présenté par C.KUHN.
Sous la direction de J.P.COFFIN le groupe Alice-Star a construit un ambitieux projet très cohérent. Dans une première phase les recherches se déroulent à Rhic avec l’expérience Star et elles se poursuivront au LHC avec l’expérience Alice. L’objectif est la mise en évidence de matière exotique en observant des dibaryons étranges ( Production anormale d’antihypérons). Sur le plan de la conception et de la construction, la contribution du groupe est la mise en œuvre de détecteurs silicium double face pour les trackers internes, 1m2 pour Star et …5m2 pour Alice. Ces travaux se déroulent au sein d’une collaboration internationale. Le détecteur sera installé en 2003, mais les prises de données ont commencé en 2001 et 2 thèses sont en cours sur l’analyse de ces données.
Le nombre de physiciens engagés est de 3, ce qui est notablement insuffisant. En revanche le groupe comporte une équipe technique compétente et cohérente. Cette activité est un des points solides de l’IreS.
-CMS. Présenté par P.VANHOVE
Ce groupe est le plus important du laboratoire : 11 Physiciens permanents et potentiellement supplémentaires impliqués dans D0 actuellement ; 2 thésards ce qui est peu ; 16 ITA. Cette « force de frappe » a permis au groupe d’occuper une place importante dans la conception et la construction du détecteur central de traces en silicium. Cette réalisation s’opère au sein d’une vaste collaboration européenne dotée d’un planning contraignant. Les investissements et moyens mis en œuvre par le laboratoire sont très importants.
Au-delà de cette réalisation qui mobilise une bonne partie
du groupe, le contrôle de l’acquisition et la reconstruction des traces et des
vertex font aussi partie des taches assumées par l’IreS. Sur le plan de
l’analyse, l’étiquetage des désintégrations de b est aussi une spécialité
locale. On peut envisager sereinement l’avenir du groupe CMS.
-Activités à l’interface physique médecine.
Cette activité a commencé en 2001 et se développe rapidement
sous l’impulsion de D.HUSS avec J.L. GUYONNET, D. BRASSE et J.P.
ERNENWEIN comme physiciens. Des Collaborations ont été initiées en particulier avec le service de médecine nucléaire du CHU de HAUTEPIERRE. Partant des concepts du
détecteur de traces d’OPERA. Ils recherchent des solutions pour l’imagerie du petit animal ainsi que pour la dosimétrie en ligne en radiothérapie.
Conclusions.
L’activité de ce département comporte des points très forts indiquant des perspectives d’avenir : CMS, interface physique médecine, NLC et le projet de détecteurs CMOS. La situation du groupe ALICE STAR mérite attention. Le succès de l’expérience OPERA reposera surtout sur des performances techniques. L’IReS s’y est résolument engagé.
III Entrevue avec le
Conseil du Laboratoire.
Le dialogue avec le conseil de laboratoire a été très limité. Peu de personnes se sont exprimées contrairement a nos attentes et à nos sollicitations. La présence du délégué du CNRS qui s’est imposé contre notre souhait, n’a peut avoir pas contribué à délier les langues. L’un des principaux physiciens concernés par l’arrêt de la machine s’est alors déclaré volontaire pour réfléchir à une nouvelle machine fournissant des faisceaux stables. Cette attitude positive et volontariste doit être soutenue, étant admis que cela n’implique pas la localisation qui pour l’instant a vocation à être simplement européenne. Nous avons souligné une fois de plus qu’il fallait maintenant des projets concrets et précis, et même à la fin chiffrés.
IV Entrevue avec l’Intersyndicale.
L’intersyndicale nous a fait part de son amertume concernant l’arrêt désormais programmé de la machine, alors que le comité d’évaluation et notre commission avait clairement souligné l’excellence des résultats en 2000 obtenus parles équipes travaillant sur le VIVITRON. Notre réponse a été que ces excellents résultats se sont poursuivis en 2001 et 2002 et qu’il doit en être de même en 2003. Cependant qualité et excellence ne signifient pas pérennité pour des dispositifs expérimentaux et que l’on doit être attentif à ne pas hypothéquer l’avenir- avenir qui dans ce domaine a été brillamment envisagé à Giens y compris par l’un des membres les plus jeunes du laboratoire.
La situation des personnels travaillant au Vivitron jusqu’à son arrêt et devant engager des formations pour reconversion sera difficile, car cela entraînera un allongement des heures travaillées. Nous estimons que l’IN2P3 doit tenir compte de cette difficulté pour le personnel et suggère que des primes de sujétions particulières aident à passer ce cap difficile
Renouvellement à 4 ans de l’IPN de Lyon
M.Bex, S.Monteil, P. Quentin
Nous avons examiné les 04 et 05 novembre 2002 les activités de l’IPN Lyon sur la base de la présentation complète des activités techniques et scientifiques ainsi que de la politique scientifique du laboratoire. L’IPN de Lyon est dans la phase de contractualisation avec l’Université Claude Bernard pour la période 2003-2007.
A - ORGANISATION DU LABORATOIRE – PRESENTATION
GENERALE
L’Institut
de Physique Nucléaire de Lyon est une unité mixte (UMR 5822) de l’Université
Claude Bernard Lyon I et du CNRS /IN2P3. Yves Déclais est son directeur
depuis novembre 1999 ; son mandat s’achève en janvier 2003. Maurice Kibler
et Jean-Paul Martin sont ses directeurs adjoints, chargés respectivement des
activités de recherche matière nucléaire, théorie et pluridisciplinaires d’une
part, quarks et leptons, astroparticules
et ions lourds ultra-relativistes d’autre part.
Le laboratoire compte trois conseils :
- Le conseil de gestion qui se réunit tous les deux mois,
- Le conseil de laboratoire qui se réunit deux fois par an,
- Le conseil scientifique qui se réunit deux fois par an afin d’examiner les projets émergeants du laboratoire et d’opérer le suivi de ceux qui sont en cours.
La direction du service administratif est assurée depuis deux ans par Anne-Marie Ferrer.
1) Personnels :
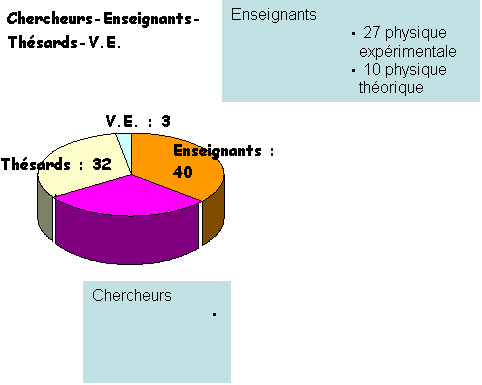
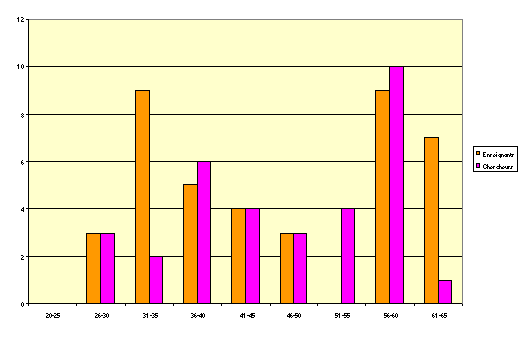
Pyramide des âges
Deux observations :
il y a un creux dans la gamme d’âge 45/50 ans,
il y a un pic d’enseignants-chercheurs de moins de 35 ans. Ce dernier point s’explique par le très bon renouvellement des postes
•2 postes en 2000 (PR théorie, MCF CAS)
•5 postes en 2001 ( PR CMS, MCF 29-34 Supernova, MCF
théorie, MCF Manoir, MCF 27-29 hadronthérapie à l’UFR informatique)
•1 passage PR (46.3) en 2002 (CMS)
•3 postes en 2003 ( PR 29-63 imagerie, MCF D0/CMS, MCF 33-29 ACE
![]() Personnels
techniques
Personnels
techniques
![]()
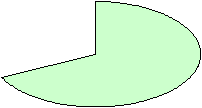

![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
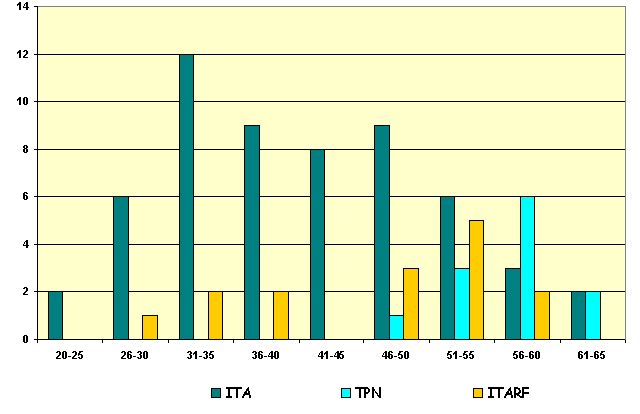
Pyramide des âges
Le pic des départs à la retraite appartient au passé.
L’IPN
Lyon a fait un examen transversal de ses besoins en personnels techniques pour
couvrir les expériences en préparation et les projets futurs ; cet examen
a révélé la nécessité de 20 personnels techniques supplémentaires !
2)
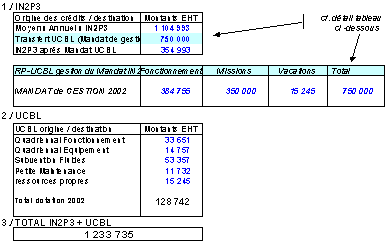
Budget
La stabilité du budget de L’IPN n’appelle pas de commentaires particuliers. Il convient toutefois de noter que la dotation de l’IN2P3 par chercheur est faible en regard de celle de laboratoires comparables.
3) Production scientifique
Les physiciens de l’IPNL sont signataires en moyenne de 90 publications par an; de 1999 à 2002, 129 présentations à des conférences ont été données.
4) Communication
L’IPN de Lyon est un laboratoire dynamique en terme de diffusion de la culture scientifique. Outre les contributions « naturelles » aux fêtes de la science ou conférences dans les lycées, il convient de noter le pilotage de l’école e2phy 2002, la production de plusieurs ouvrages de vulgarisation de la physique fondamentale ou les actions de type graines de physiciens.
5) Enseignement
Les enseignants-chercheurs de l’IPNL officient dans tous les cycles de l’Université Claude Bernard, y compris au sein des IUT A et B de cette même université, à l’ENS, au CNAM, et dans quelques autres filières. Quelques chercheurs s’impliquent également dans ces services d’enseignement offrant ainsi une décharge de service aux jeunes MCF de l’IPNL. L’implication de ces personnels dans la promotion des filières existantes et des projets émergeants est importante et il nous a semblé que ce dynamisme est un des points d’ancrage des bonnes relations entre le laboratoire et l’Université
Formation
par la recherche
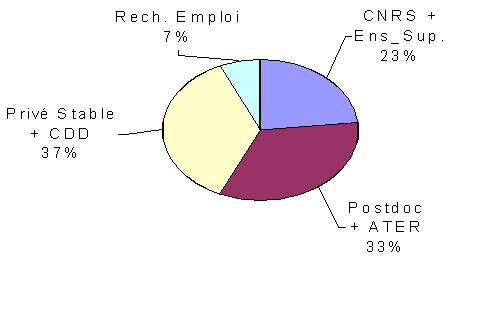
L’IPNL intervient de façon privilégiée dans le DEA PNAP qui accueille une vingtaine d’étudiants par an. C’est le
vivier naturel et principal des doctorants du laboratoire qui sont une
trentaine en 2002. Une formation originale sous la forme d’un diplôme
d’université permet aux doctorants de valider et de faire reconnaître leurs
compétences en informatique. Il existe à l’IPNL un souci réel de suivi des
docteurs (ça va sans dire mais ça va mieux en le disant) et les perspectives
d’emploi post-thèses sont satisfaisants comme l’illustre le diagramme
ci-dessous.
Les trois dernières années ont vu la montée en puissance de l’accueil de stagiaires de licence et maîtrise et d’écoles d’ingénieurs. La fraction de ces étudiants qui se dirigent vers le DEA PNAP est importante et justifie s’il en était besoin la poursuite de cette politique.
6) Contractualisation
De nombreux éléments dans ce qui précède montrent la
qualité des interactions entre le laboratoire et l’Université. Le projet de
contractualisation défendu par Y. Déclais est en excellente voie.
B - Le
point sur l’ACTIVITE SCIENTIFIQUE
1) Théorie
Le groupe de théorie compte 10 enseignants-chercheur, 2 CNRS, 1 post-doc et 6 doctorants, dont 1 thèse mixte (théorie/D0).
Les recherches du groupe théorie s’articulent autour de deux sujets :
- Physique nucléaire, hadrons et matière hadronique dense et chaude ;
- Physique des particules, symétries et supersymétries (avec un souci croissant de convergence entre la physique mathématique et la phénoménologie).
L’activité des deux axes est riche et reconnue : près de 60 publications, 40 communications dans des conférences et 9 thèses soutenues pour les trois dernières années. Il convient également de relever la forte implication des membres du groupe en particulier dans les instances universitaires lyonnaises.
L’enjeu du prochain quadriennal est de conserver l’impulsion en organisant au mieux le renouvellement des permanents ; 6 départs en retraite étant prévus dans les quatre prochaines années. Le comité a apprécié la présentation des perspectives envisagées par le groupe en relation avec la direction. Les grandes lignes sont de poursuivre et renforcer le nouvel axe phénoménologie du Modèle Standard (y compris physique des neutrinos) tout en assurant le renouvellement de la thématique hadrons. L’équipe a obtenu une évaluation de la section 02 (février 2002), dont les conclusions préconisaient 2 postes CNRS dans les prochaines années. Deux postes de MCF complèteraient le dispositif.
Le comité juge très positivement l’évolution adoptée par le groupe et la direction dans la difficile gestion des départs prévus.
2) Quarks
et Leptons
LES
EXPERIENCES LEP (Delphi et L3)
Les expériences L3 et DELPHI ont très largement contribué à la production scientifique de l’IPNL dans la dernière décade. Il reste pour chacune de ces expériences quelques papiers en souffrance dont l’examen en comité éditorial d’expérience est prévu d’ici à la fin de l’année : il n’y aura plus d’activité LEP en 2003, à l’exception notable d’une thèse dans L3 portant sur l’étude des muons cosmiques et dirigée par Michel Chemarin.
La recomposition des équipes de recherche est la suivante :
L3 : 3 chercheurs vers CMS, 3 vers D0, 1 vers OPERA + 1 retraite.
DELPHI : 2 chercheurs vers Snae, 2 vers CMS, 2 vers OPERA, 1 en imagerie médicale.
L’EXPERIENCE
D0
L’équipe D0 compte 4 chercheurs, 1 ATER et 2 doctorants. et participe au sein de D0 France à la gestion des données au centre de calcul, à la production de masse des Monte Carlo. Parmi les travaux engagés dans l’équipe, soulignons l’intercalibration en phi du calorimètre électromagnétique et la calibration de l’énergie des jets en particulier de quarks beaux. Du point de vue des analyses, deux recherches sont poursuivies : nouvelles particules (SUSY) et boson de Higgs.
Pratiquement,
il y a deux chercheurs à plein temps, ce qui rend ce groupe d’une part fragile,
d’autre part légèrement sous-critique en période d’analyses par rapport aux
projets de physique ambitieux qu’ils conduisent. Le recrutement d’un MCF
demandé cette année par la direction nous semble aller dans le bon sens
L’EXPERIENCE CMS
Les deux sous-groupes de CMS (Ecal et traces) ont fait une présentation commune, signe que leur rapprochement est en cours sinon opéré. 8 CNRS, 5 enseignants-chercheurs et 2 doctorants composent l’équipe. 2 chercheurs sont actuellement au CERN en permanence.
Concernant la calorimétrie, le laboratoire a la responsabilité d’une partie de l’électronique de lecture frontale du ECAL et des tests de qualification des capsules (cristal + APD). Ce dernier point est en bonne voie. Quelques mots pour tenter d’expliquer l’état de la situation pour l’électronique ECAL : les travaux sur l’électronique frontale (analogique et numérique) étaient coordonnés par le CERN et de sérieux dysfonctionnements furent à déplorer. Les responsabilités dans ce domaine sont aujourd’hui redéfinies. L’IPNL a en plus de ces difficultés souffert du départ des microélectroniciens moteurs dans les développements dévolus à l’institut.
La situation actuelle est clarifiée, des choix techniques « raisonnables » ont été faits. Il demeure une inquiétude irréductible concernant le planning des tests et de la construction, étant entendu que les modules ECAL (Cristal+APD+VFE) doivent être précalibrés en faisceau et que le CERN a pris des mesures drastiques de réduction/suppression des faisceaux tests.
Concernant la trajectographie, le laboratoire a la responsabilité de la construction des bouchons du trajectographe Silicium, après avoir longtemps été à la pointe des recherches et développements sur les MSGC. Le comité a eu le sentiment que le virage avait été extrêmement bien négocié par l’équipe sous l’impulsion de D. Contardo.
Le laboratoire s’est doté d’un banc de collage des modules Silicium et les deux années qui viennent verront une montée en puissance des travaux de construction avec production à haut flux, qui devront nécessiter le recrutement de vacataires. (budget IN2P3).
Les deux sous-groupes déplorent le peu de temps que les tâches de construction laissent à la préparation de la Physique. Le groupe a toutefois engagé des études portant sur la production du boson de Higgs dans CMS et de sa désintégration en 2 photons. Il existe depuis longtemps à l’IPNL (dans CMS-traces) une activité de prospective pour la physique des ions lourds dans CMS dans laquelle les membres de l’IPNL sont moteurs.
Le comité exprime tous ses vœux de réussite aux membres de CMS-Lyon pour la période charnière à venir.
3) Astroparticules
et neutrinos
L’EXPERIENCE
OPERA
Le groupe OPERA de l’IPNL compte 4 enseignants-chercheurs, 2 chercheurs et 3 étudiants en thèse.
Dario Autiero s’installe et renforce significativement l’équipe.
Les responsabilités, majeures, assumées par l’IPNL concernent le système d’acquisition de l’expérience et une participation active à la définition de l’architecture de reconstruction et d’analyse des données. Un prototype de table de scanning des émulsions fonctionne au laboratoire. L’objectif est de monter un laboratoire, équipé de 4 tables, qui sera mutualisé pour les 4 équipes de l’IN2P3 participant à OPERA.
Le calendrier de l’ensemble des activités OPERA conduites à l’IPNL est maîtrisé. La partie algorithmique pour l’analyse des données est également bien engagée.
Les R&D sur les cartes contrôleur et FE étant pratiquement terminées, les personnels du service électronique impliqués dans OPERA pourront être affectés à d’autres expériences lorsque la fabrication de ces éléments sera engagée.
L’EXPERIENCE
EDELWEISS
Le groupe de l’IPNL est composé de 2 CNRS, 4 enseignants-chercheurs et 2 doctorants. Il y a deux régimes dans la distribution d’âges du groupe : 3 chercheurs de moins de 40 ans, 3 chercheurs de plus de 55 ans.
La collaboration EDELWEISS a publié dernièrement la meilleure limite directe sur la masse du WIMP, basée sur les données d’EDELWEISS I : 3 bolomètres Ge de 320g chacun. L’expérience en compétition avec EDELWEISS est la manip CDMS qui sera très prochainement installée en souterrain dans les mines de Soudan. Il faut par conséquent si la collaboration souhaite conserver son avance passer rapidement à la phase II.
Le futur proche, c’est EDELWEISS II : version 30kg ; dans une première phase, 30 bolomètres seront installés (10 kg). Les engagements de l’IPNL portent sur la cryogénie d’une part et sur l’installation de blindages mobiles (prémontés à Lyon) et d’un veto pour les muons, développé en collaboration avec Karlsruhe, d’autre part. Enfin, l’IPNL participait également à la définition de l’électronique d’acquisition. En raison du déficit chronique d’électronicien au laboratoire, cette partie du travail pourrait être abandonnée. Cela ne remet toutefois pas en cause le calendrier de l’expérience, ces développements pouvant être repris par le groupe du CEA.
Le groupe a exprimé des besoins importants en personnels à la fois chercheur et technique ; dans les deux cas pour préparer les départs en retraite prévisibles.
La direction de l’IPNL a d’ores et déjà demandé un poste d’IE en cryogénie .
SNae : SNIFS, SNAP …
Le groupe est composé de 2 enseignants-chercheurs et 1 chercheur et bénéficie du soutien de 2 IR du service instrumentation.
SNIFS est une manip dédiée à la collection de SNae à faible redshift pour construire une base de données de chandelles standards. Bien qu’elle n’ait pas d’intérêt cosmologique immédiat, c’est un pré-requis pour les futures expériences du domaine et il semble évident que la participation à court ou moyen terme à SNAP est l’objectif de ce groupe. Le projet d’expérience sera présenté devant le conseil scientifique de l’IPNL courant 2003.
Le groupe entretient des collaborations françaises avec le CRAL (Un poste MCF 29/34 a d’ailleurs été pourvu récemment.) et le LPNHE Paris. Le départ de Pierre Antilogus a été compensé par l’arrivée en provenance d’ALICE de E. Gangler.
Le temps de télescope est réduit de six mois en raison de retards du côté américain mais on peut espérer son extension si les résultats de SNIFS sont au rendez-vous. Si l’on passe outre cette incertitude, il nous semble que l’expérience est en bonne voie.
SMA-VIRGO
Cette équipe est composée de personnels techniques de très haute qualification, 7 IR, 3IE et 2AI, dont les compétences sont mondialement reconnues. Elle accueille aussi des étudiants en thèse (une actuellement).
La réalisation des miroirs de VIRGO, qui a été le cœur de l’activité du groupe ces quatre dernières années, a requis la construction d’un nouveau bâtiment , l’installation du coater VIRGO et de l’ensemble des dispositifs de métrologie optique pour mesurer réflectivité, biréfringence et absorption des miroirs.
Le premier miroir VIRGO a été réalisé en décembre 2001 avec des performances meilleures que les spécifications de l’expérience pour tous les paramètres considérés.
Les
perspectives du groupe se situent dans la R&D EGO pour les futurs
interféromètres mais aussi dans la R&D LIGO pour laquelle un contrat a déjà
été passé. Le groupe cherche par
ailleurs une diversification dans le cadre d’un partenariat avec des
industriels.
L’excellence des travaux de cette équipe est
tout à fait exceptionnelle. Les activités qu’elle poursuit sont cependant
parfaitement indépendantes de la production scientifique du laboratoire.
4) Matière
nucléaire dense
Les groupes NA60 et ALICE sont réunis en une seule équipe : 4 chercheurs, un enseignant-chercheur et 2 doctorants. L’essentiel de ses chercheurs travaillait auparavant dans NA38-NA50.
L’
EXPERIENCE NA60
La participation à NA60 se fait avec une contribution technique modeste : l’IPNL a eu la charge de la construction du compteur d’interactions. Le groupe sera essentiellement impliqué dans l’analyse des données. En raison de problèmes de montage des pixels, le run Pb d’octobre 2002 a été annulé. Les runs programmés de l’expérience NA60 se réduisent par conséquent à 5 semaines de protons en 2003 + 3 semaines de run Indium-Indium en octobre 2003.
L’EXPERIENCE
ALICE
Le groupe ALICE de l’IPNL a la charge de la construction du détecteur V0 et du contrôle de l’alignement des chambres du spectromètre.
Le détecteur V0 était initialement chargé de valider le trigger dimuon. Son rôle a été étendu au trigger général de biais minimum de l’expérience ( contrôle du fond faisceau-gaz en proton-proton), impliquant une redéfinition de sa géométrie. L’électronique doit être définie courant 2003 et la réalisation est programmée à partir de 2004. 2 électroniciens et 2 mécaniciens sont affectés au projet. La redéfinition du détecteur implique un surcoût par rapport au MoU qui devrait être absorbé par une contribution de Mexico.
Le contrôle de l’alignement des stations muons sera réalisé par des lignes optiques RASNIK. Là encore, la réalisation du système se fera à partir de 2004 (en collaboration avec Erevan).
Le soutien technique du laboratoire est jugé satisfaisant par le groupe.
Le groupe a choisi de concentrer son activité de préparation à la physique sur la production dimuon de basses masses (rho, omega et phi).
5) Physique
nucléaire
STRUCTURE NUCLEAIRE
(EX-SNIL)
2 PR, 2CR et 1 Doct.
(NB : un PR exerce de fortes responsabilités à l’UCBL, 3 départs récents dans ce groupe)
Etudes de structure de noyaux exotiques en spin (au VIVITRON avec EUROBALL) et en isospin (notamment riches en protons à SPIRAL avec EXOGAM et DIAMANT)
Les thèmes abordés sont d’une part l’étude dans un régime de haute vitesse angulaire, des corrélations d’appariement, du couplage des vibrations octupolaires et des excitations individuelles enfin des propriétés magnétiques, d’autre part l’appariement proton-neutron.
Actuellement très forte activité de prise de données au VIVITRON avant la fin du détecteur EUROBALL (6 expériences en 6 mois), projets de poursuite de certaines études à Jyväskyllä et Legnaro, ainsi que de continuation de ce qui a démarré à SPIRAL.
Le groupe participe aux développements techniques autour d’AGATA (principalement pour la préparation de l’analyse des données, dans une moindre mesure pour le test de prototypes et à terme à la conception de détecteurs ancillaires (cf. plus loin)
L’activité est soutenue et de qualité en particulier à cause de liens forts avec le groupe théorie de l’IPNL assurant une grande lisibilité des résultats obtenus en termes de structure microscopique sous-jacente. Il y a une forte activité de formation (3 thèses réalisées ou prévues entre 1999 et 2003).
Ce groupe doit être renforcé en veillant à assurer la continuation du lien fort avec les théoriciens (une embauche CR pour ce groupe constitue la première priorité de la Direction de l’IPNL)
MECANISMES DE REACTIONS
(EX-MIL)
1CR, 1 MdC, 2 Doct.
(NB : 2 départs récents)
Actuellement l’équipe, qui a pris sa part dans les succès de la campagne INDRA au GANIL, est impliquée dans les analyses des résultats des expériences INDRA au GSI, dans la réinstallation au GANIL auprès de VAMOS et dans une R et D sur un détecteur 4p de particules chargées (AZ4p) dans le cadre d’un PICS franco-italien courant jusqu’à 2004
La taille faible de l’équipe et la volonté (réaliste) de la direction de l’IPNL de rassembler les forces dans les recherches sur la matière nucléaire militent pour que ses membres joignent leurs forces avec l’ex-équipe SNIL au sein d’un nouveau groupe « Matière Nucléaire ». L’expertise de l’ex-équipe MIL en matière de détecteurs de particules chargées doit être mise en œuvre pour étudier un détecteur ancillaire d’AGATA en commun avec l’ex-équipe SNIL.
Note Finale :
Le
Comité a perçu une réelle volonté des deux ex-équipes SNIL et MIL de travailler
en commun à échéance proche (l’échelle de temps étant fournie par le calendrier
de R et D pour AGATA et ses détecteurs ancillaires). Cette fusion passe par un
développement instrumental assumé en commun qui aura en outre l’avantage de
recentrer l’activité des physiciens concernés autorisant un plus fort impact de
l’IPNL dans le développement instrumental (par rapport à la situation actuelle
où le point fort est plus dans l’analyse). Pour pouvoir saisir au mieux cette
opportunité, il convient donc que la direction de l’IPNL offre à ce groupe un
certain soutien en ITA à définir, par exemple en électronique.
6) Activités
pluridisciplinaires
L’importance des activités pluridisciplinaires ou de physique appliquée est une des spécificités du laboratoire.
COLLISIONS ATOMIQUES DANS LES SOLIDES
1DR, 1 CR, 1 MdC, 0.5 PR émérite, 1 Doct.
(NB ce groupe regroupait anciennement le groupe BIAS présenté plus bas)
Les activités de ce groupe demeurent de grande qualité et sont très diversifiées :
- QED : notamment ionisation par création de paires, études de sources de positrons qui pourraient être d’intérêt pour le projet de futur collisionneur linéaire.
- Phénomène de canalisation (notamment mesure du temps de fission par la méthode du blocking et extension future via une expérience acceptée au GANIL pour la mesure de ce temps dans les superlourds)
- Etude du ralentissement d’ions d’Uranium au GSI en condition de canalisation et à très haute charge (ici état 91+) en vue d’utiliser un cristal pour conduire au piégeage de tels ions
- Etude d’une réaction d’excitation résonante cohérente d’un faisceau d’ions en condition de canalisation (effet Ochorokov) en lien avec le groupe de physique théorique et le groupe matière nucléaire
Ce groupe a un fort potentiel de créativité et d’interaction avec diverses équipes du laboratoire ou d’autres laboratoires et la volonté de collaborer pour une part de leurs activités avec le groupe matière nucléaire. Le comité a relevé avec intérêt l’étude de faisabilité de sources de positrons polarisés ; ces études méritent très certainement d’être menées à leur terme.
BOMBARDEMENT IONIQUE ET ANALYSE DE SURFACES
(anciennement une partie du groupe Collisions Atomiques dans les Solides, CAS)
1 CR, 1 DR tous deux de la section 17, 0.5 PR émérite, 1 Doct.
Le groupe conduit une activité de recherche fondamentale portant sur l’étude de l’interaction ions (ou agrégats) – surface solide, et singulièrement les mécanismes de pulvérisation et d’émissions ioniques secondaires. Les applications envisagées (et pour une part entreprises) concernent des analyses d’échantillons biomédicaux ou environnementaux.
Il existe un lien étroit avec l’équipe de l’IPN Orsay (Y. Le Beyec, S. Della Negra, …) les travaux à l’IPNL constituant la partie basse énergie de ces études.
Le groupe utilise le Van de Graaff de 2.5 MV de l’IPNL qui présente des avantages pour ce type d’études (fortes intensités, tube horizontal –important pour la gestion de faisceaux de particules très lourdes, source dédiée). L’arrêt de son exploitation à l’IPNL est prévue à échéance de 1.5 à 2 ans. Alors que l’activité de ce groupe demeure de bonne qualité, il se trouve devant un choix à court terme entre deux options (une combinaison des deux semblant a priori peu réaliste au vu des forces en présence) :
- poursuite des recherches fondamentales pour une part, en vue de fournir des outils de qualité pour des applications (cette option nous a semblé avoir les faveurs du groupe) mais alors le problème de l’accélérateur à utiliser reste entier (déménagement du Van de Graaff dans un autre centre ?), le maintien du couplage avec l’équipe d’Orsay semblant être une bonne option
- recentrage sur le versant des applications, La création de l’Institut des Sciences Analytiques sur le campus de l’UCBL fournissant à ce sujet une opportunité à creuser.
Quelle que soit l’option retenue, il conviendrait que la direction de l’IPNL accompagne le redéploiement des activités de qualité de ce groupe.
GROUPE ACE
1DR, 2PR, 1MC +2 doctorants
Participation à PRACTIS et NOMADE :
a) Etude de la diffusion des produits de fission dans les matériaux de stockage
des déchets nucléaires, effets des irradiations.
b) Etude de la diffusion d'actinides dans la zircone sous irradiation.
- Etude de l'évolution de la gaine en conditions réacteur
- Rôle des défauts créés par les produits de fission sur l'oxydation de la gaine et la diffusion de l'Uranium.
Les activités conduites dans ce groupe sont de grande qualité.
INTERACTION PARTICULE MATIERE
1 CR, 1 MdC, 1 Doct.
Ce groupe présente une très forte activité scientifique, soulignée par le nombre de thèses(trois depuis 1999), plusieurs publications à fort impact (notamment 3 PRL en deux ans), et de nombreuses invitations dans des conférences internationales. Les points forts relevés par le comité concernent :
- la mise en évidence d’une transition de phase dans la fragmentation de petits agrégats d’hydrogène (environ 12 atomes) à partir de l’établissement d’une courbe calorique
- la mise en route d’un programme d’étude des effets ionisants à l’échelle moléculaire pour étudier la radiosensibilité de molécules biologiques.
Les collaborations nombreuses au plan local (Plan Pluri-Formations UCBL), national (GDR) et internationales (PICS France-Autriche, PAI Amadeus, réseau européen COST) assurent les perspectives d’avenir du groupe.
Toutefois, les efforts entrepris par la Direction de l’IPNL pour l’e����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������mbauche d’un jeune Maître de Conférences sur un profil pluridisciplinaire doivent être poursuivis. Une promotion s’impose à court terme.
IMAGERIE MEDICALE
Ce groupe, né il y a deux ans, est composé de physiciens des hautes énergies engagés principalement sur les projets CMS et OPERA. Un seul chercheur y consacre tout son temps.
Les expertises acquises dans les groupes L3, puis CMS, et OPERA dans les domaines des cristaux, des photodétecteurs multicanaux et de leur acquisition ont été mises à profit pour un projet de réalisation d’un micro-TEP à Lyon en collaboration avec des laboratoires locaux . Un premier prototype est réalisé et les résultats sont satisfaisants. Ces recherches sont financées par un programme régional, un BQR de l’UCBL et une ACI.
Une autre direction de recherche dans ce groupe concerne le développement d’un photodétecteur de haute résolution spatiale. Une des pistes de recherche utilise les capteurs MIMOSA développés à l’IreS et au LEPSI de Strasbourg.
Le comité a jugé cette nouvelle activité à l’IPNL très prometteuse.
HADRONTHERAPIE/ PROJET ETOILE
Le projet ETOILE pour Espace de Traitement Oncologique par Ions Légers Européens a été initié par l’UCBL en 1999 dans le but de créer un centre de Hadronthérapie par ions Carbone à Lyon.
Le calendrier envisagé est le suivant : décision en 2003, 2004 à 2006 réalisation, accueil des premiers patients en 2007.
4 enseignants-chercheurs + 1 doctorant composent le groupe de l’IPNL. Ils s’occupent (dans de nombreuses collaborations au sein du projet ETOILE) de l’étude des interactions ions Carbone/matière vivante, du positionnement du patient et du contrôle de la balistique.
En outre, les développements d’imagerie médicale de l’institut (le micro-TEP) s’inscrivent également dans le projet ETOILE.
La participation du laboratoire aux différentes facettes du projet ETOILE est jugée tout à fait satisfaisante
C-EXAMEN
DES SERVICES TECHNIQUES
La réorganisation des services techniques, amorcée sous la direction de JE. Augustin, a été corrigée au cours du mandat d’Y. Déclais. Il n’y a plus de directeur technique et un service d’instrumentation a été créé. Cette création est guidée par le souci d’éviter des affectations de personnels techniques à vie dans une équipe, ce qui était une pratique courante dans le passé. Le groupe instrumentation est dirigé par JL. Castera et regroupe les personnels appartenant à l’ancien groupe de Soutien aux expériences. Le comité a jugé ces évolutions très positives.
L’IPN de Lyon a fait récemment un examen transversal des besoins en personnels techniques pour les projets d’expérience existants et émergeants. L’analyse semble raisonnable et le bilan critique : un besoin de vingt personnels techniques supplémentaires a été mis en exergue. Il n’est néanmoins pas prévu d’abandonner des projets en cours ; le déficit chronique de personnels techniques risque d’empêcher la participation du laboratoire à des projets dont l’échelle de temps est voisine de celle du LHC.
LE Service
d’electronique
11 Personnes : (4)IR (2)IE
(3)AI (1)TCS (1)AJT
Développements d’électroniques analogique (ASIC) et numérique (DAQ, FPGA).
Son activité s’inscrit dans les expériences CMS, OPERA et ALICE.
Les projets à l’étude (analogiques) sont liés à SNAPet matière nucléaire. Un déficit de 4 personnes est relevé.
LE Service dE
MECANIQUE
13 personnes: 6 bureau d’études
(2 AI, 2 IE, 2IR) et 7 atelier (5 T, 1 AI,1 IE)
Les contributions majeures du
service vont vers les expériences ou groupes CMS, ALICE et IPM. Le reste de
l’activité et des développements est portée par les équipes EDELWEISS, SNIFS et
OPERA. Manqueraient 2 IR(E) au BE, 2 techniciens à l’atelier.
LE Service
INFORMATIQUE
11 personnes: 6 IR,3IE,1AI,1T.
Le service est organisé en trois groupes : système et réseaux,
acquisition et développements logiciels. C’est dans ce dernier secteur que les
besoins se font le plus cruellement sentir du point de vue des physiciens. Sur
la base du quadriennal, 3 postes supplémentaires seront demandés, dont un IE
pour la partie développement logiciel.
LE Service
INSTRUMENTATION
7 ingénieurs.
La moyenne d’âge du service est assez élevée et 3 départs en retraite sont prévus à courte échéance. Une demande prioritaire du laboratoire cette année est le recrutement d’un cryogéniste afin qu’il y ait un recouvrement temporel suffisamment grand pour transmettre le savoir-faire existant au labo. Le comité a jugé par ailleurs la définition des missions et le fonctionnement de ce service très positifs.
LE Service
ACCELERATEURS
3 ingénieurs.
le laboratoire compte 4 machines, 2 VdG (2.5 et 4 MV) et 2 implanteurs ioniques. Les faisceaux sont utilisés essentiellement par les groupes de recherches pluridisciplinaires.
Le VdG 2.5 MV sera arrêté d’ici à deux ans. Des projets de rénovation des machines et de modernisation de leur contrôle sont engagés. Un rapprochement avec le groupe de hadronthérapie est en cours.
LE Service
ADMINISTRATIF
17 personnes :
Le service est dirigé par Anne-Marie Ferrer depuis deux ans ; sous son impulsion, une entreprise de réorganisation a été conduite. Les secrétariats particuliers des expériences ont par exemple été regroupés au sein du service administratif. Une fois la restructuration accomplie, la taille du service devrait être satisfaisante. Une personne s’occupe de la gestion du personnel et doit être remplacée prochainement. Une demande de poste IE a été faite.
DOCUMENTATION/COMMUNICATION
4 personnes (1IE,3T) sont en charge de la documentation. La cellule communication regroupe 7 personnes : chercheurs, infographiste et documentaliste. Les actions mentionnées plus haut dans ce document relèvent de la cellule communication ; on peut y ajouter l’édition d’une e-lettre interne trimestrielle et de la responsabilité éditoriale du site web.
D-DIVERS
Lors de notre visite, deux heures avaient été réservées pour des entretiens individuels, un entretien avec le conseil du labo et un entretien avec les chercheurs et enseignants-chercheurs recrutés depuis moins de cinq ans.
Personne ne s’est présenté aux entretiens individuels. Nous regrettons que le conseil de laboratoire n’ait pas été prévenu suffisamment à l’avance du créneau qui était réservé à cette discussion. La rencontre avec les chercheurs et enseignants-chercheurs recrutés depuis moins de cinq ans a été l’occasion d’un point d’information sur les délégations offertes par le CNRS. Nous n’avons pas relevé au cours de ces différents entretiens de difficultés particulières.
Renouvellement du directeur
Y Déclais est candidat à sa propre succession. Il a
exprimé des regrets (que le comité partage), sur l’organisation de l’examen de
son renouvellement par la direction de l’IN2P3. Le comité porte par ailleurs un
avis très favorable sur le renouvellement d’Yves Déclais dans ses fonctions.
E-CONCLUSIONS
L’IPNL est un laboratoire très fortement lié à l’université qui conduit depuis longtemps une grande variété de recherches en physique subatomique.
Le laboratoire a souffert de nombreux départs de personnels techniques et chercheurs dans les dernières années mais a su conserver une production scientifique de grande valeur. Des résultats de tout premier plan ont été obtenus ces quatre dernières années dans beaucoup de domaines.
La politique scientifique du laboratoire, à la fois en matière de recrutement et d’arbitrage dans la distribution des soutiens techniques aux expériences nous apparaît équilibrée et susceptible de permettre au laboratoire de tenir sa place au sein des grands projets dans lesquels il est impliqué.
Les évolutions engagées sous la précédente direction, poursuivies par la direction actuelle et portées par les personnels vont dans un sens que le comité juge très positivement. Le rapprochement des groupes de physique nucléaire, la redéfinition des missions des services techniques ou encore la convergence affirmée des thématiques de recherche du groupe théorie vers les problématiques expérimentales du laboratoire en sont autant d’illustrations.
Quelques points liés à la multiplicité des expériences requièrent selon nous une attention particulière dans un futur proche. L’évolution naturelle de l’activité Supernovae vers l’expérience SNAP, tout comme la participation au Run IIb du Tevatron, mériteront un examen attentif au regard des disponibilités en personnels techniques et chercheurs. Le rapprochement affirmé des groupes de physique nucléaire expérimentale doit se poursuivre et trouverait une traduction dans une phase intermédiaire de recherche et développement instrumentale. Enfin, dans le contexte délicat de la collaboration CMS et singulièrement, dans un passé récent, de la calorimétrie électromagnétique, le comité a apprécié le travail de l’équipe et souhaite que la direction continue d’accompagner l’évolution du projet.
Le comité a par ailleurs particulièrement apprécié le virage réussi de l’équipe impliquée dans la trajectographie de CMS après l’abandon par la collaboration de la solution MSGC. Il félicite le laboratoire pour le dynamisme qu’il manifeste dans ses recherches pluridisciplinaires, en particulier dans les domaines des agrégats d’hydrogène et des effets biologiques des radiations, des études de canalisation, de l’aval du cycle et des applications médicales.
Renouvellement à 4 ans du LAPP
(M. Bex, M. De Jésus, J. Dumarchez)
Présentation Générale
Le LAPP est une Unité Mixte de Recherche (UMR 5814) du CNRS et de l'Université de Savoie. Il est dirigé par Jacques Colas depuis janvier 2000 secondé par Marie-Noëlle Minard. Ses thématiques de recherche sont réparties entre la physique sur accélérateur (ALEPH, L3, ATLAS, CMS, Babar et LHCb) et la physique hors accélérateur (VIRGO, AMS, OPERA et EUSO). La fin des expériences ALEPH, L3 et NOMAD a permis un redéploiement des physiciens vers des expériences existantes, mais également vers de nouveaux projets tels que LHCb ou EUSO. Le conseil scientifique est un sous-ensemble du conseil de laboratoire : en dehors de fournir des avis sur de nouveaux projets, les conseils examinent régulièrement les expériences afin de définir et répartir au mieux les besoins techniques des différents groupes de physique.
Les personnels du laboratoire se répartissent de la manière suivante : 43 chercheurs CNRS, 8 enseignants chercheurs, 72 ITA, une quinzaine de doctorants. En ce qui concerne les chercheurs, les effectifs CNRS n'ont pas changé entre 1998 et 2002, les départs en retraite étant compensés par les embauches et les mutations. Néanmoins pour l'avenir les départs en retraite seront nombreux (estimés entre 8 à 16 entre 2002 et 2006 suivant que les départs se feront à 60 ou 65 ans ) et les perspectives de recrutements d'enseignants chercheurs ne sont pas très bonnes : au rythme actuel d’une embauche CNRS par an en moyenne l’effectif décroîtra d’un chercheur par an. Par ailleurs l’impossibilité depuis 2000 de payer des « mois-visiteur » sur les budgets propres des laboratoires s’est traduite pour le LAPP par une diminution sensible du nombre de visiteurs.
Les personnels techniques et administratifs sont en baisse depuis 8 ans (-8%). Les départs en retraite dans les prochaines années concerneront pour la plupart la catégorie BAP C.
Les ressources financières du laboratoire proviennent essentiellement de l'IN2P3 (voir détails tableau). L'université de Savoie, le département et la région apportent une modeste contribution en dehors d' actions spécifiques (AMS, ligne transfix vers Archamps, convention de collaboration CERN-LHC...)
|
en kFrs HT |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Soutien de base |
7208 |
6844 |
7136 |
7143 |
|
Visiteur étranger |
309 |
335,8 |
355,2 |
355,2 |
|
Vacations |
167,5 |
280 |
193,9 |
135,4 |
|
Université |
289,7 |
253,9 |
360,9 |
275,4 |
|
Département |
(599) |
(1038,6) |
(326,1) |
(85,9) |
|
Région |
|
(1275) |
|
|
|
Total(hors dép. et région) |
7974,2 |
7713,7 |
8046 |
7909 |
L'augmentation du poste vacations en 2000 et 2001 provient de l'embauche de CDD pour la construction d'ATLAS (la somme de l'année 2002 correspond aux 8 premiers mois de l'année).
Les relations entre le LAPP et l'université de Savoie se font au travers des enseignements dispensés par les enseignants-chercheurs ou chercheurs, mais également par l'accueil d'un nombre très important de stagiaires de tous niveaux et par le nombre de thèses soutenues chaque année (en moyenne 5 par an). Il est important pour le dynamisme du laboratoire de maintenir cette tradition d'accueil.
Entre 1998 et 2002, 20 thèses ont été soutenues au LAPP avec des financements très variés : allocations AMX, AMN, BDI et MENRT. Les doctorants sont issus de divers DEA : Lyon, Grenoble, Chambéry, mais peu de la région parisienne à cause de la politique d'attribution des allocations de recherche.
1.
Les groupes de recherche
1.1 LEP: ALEPH et L3
Les physiciens du LAPP impliqués dans les expériences du LEP, ALEPH et L3, ont eu des contributions très importantes à la prise des données, à l'analyse ainsi qu'au fonctionnement des détecteurs. Les dernières analyses pour ALEPH sont actuellement en phase terminale et devraient s'achever complètement courant 2003 par 1 thèse et 2 HDR. Les physiciens des 2 groupes sont pour la plupart déjà très fortement sinon complètement impliqués dans d'autres expériences du laboratoire. Le travail de la combinaison des résultats des quatre expériences LEP dans lequel sont encore impliquées quelques personnes du laboratoire devrait s'achever dans les prochains mois.
1.2 BABAR
Le groupe est composé de 8 chercheurs (dont 1 Ens. Ch, 1 émérite, 1 départ prochain) et a été renforcé par l'arrivé d'un CR2 (Vincent Poireau) qui prendra ses fonctions en janvier 2003.
Babar est actuellement le seul groupe du LAPP à prendre des données, et attire donc des thésards : 2 thèses soutenues et 2 en cours de préparation. Le LAPP participe à l'expérience depuis le début en 1993 et a pris des responsabilités importantes aussi bien dans la coordination des runs sur place que dans toute la partie calcul qui a valu au CCin2p3 d'être impliqué comme Tier A. Cette dernière participation est en particulier compensée par une diminution substantielle de la contribution financière française à l'expérience. La place importante et reconnue du groupe du LAPP au sein de la collaboration Babar n'aurait pu se faire sans la présence sur place et pour des séjours longue durée de plusieurs physiciens. Néanmoins cette présence à un coût : 50% du budget missions hors France du laboratoire, et il faudra que cet effort financier soit maintenu si on veut que la participation des groupes français à la phase prise de données et analyse continue de recevoir la même reconnaissance que pendant la phase de construction au sein de la collaboration. Les arrivées récentes (mutation et CR2) dans le groupe permettent d'envisager une participation du LAPP au moins jusqu'en ~2006.
1.3 LHC:
Le LAPP participe maintenant à 3 futures expériences LHC : ATLAS, CMS et LHCb. Cette participation doit être néanmoins modulée par la priorité clairement affichée du laboratoire pour ATLAS depuis plusieurs années ; le groupe CMS malgré une contribution importante et reconnue dans l’instrumentation pour le futur détecteur, n'est pas une priorité pour le laboratoire. L'engagement du laboratoire dans l'expérience LHCb est très récent (2001).
Ø
ATLAS
Le groupe ATLAS se compose de 14 physiciens dont un visiteur étranger et 3 doctorants. Plusieurs départs (retraite, mutation et détachements) sont prévus dans les prochaines années
Les contributions du groupe au sein de la collaboration ATLAS sont importantes et reconnues. Le groupe a pris des responsabilités dans la réalisation du calorimètre électromagnétique à Argon liquide de l'expérience. Les équipes techniques impliquées sont :
- la mécanique : 3 ingénieurs, 3 AI, 3 techniciens et 2 à 3 vacataires
- l'électronique : 5 ingénieurs, 2 AI et 1 technicienne
- l'informatique : 4 ingénieurs et 1 AI
La contribution mécanique intervient dans :
- le pliage des électrodes qui a nécessité le développement d'une machine dédiée. Cette partie a été arrêtée fin 2001
- l'assemblage, le câblage et le test au froid des modules du calorimètre baril. Le LAPP est un des 3 sites d'assemblage des modules, cette activité devrait se terminer début 2003.
- l'assemblage des roues du calorimètre
- les tests électriques des modules qui a fait l'objet d'une thèse.
La contribution électronique intervient dans la conception, la mise au point et les tests des cartes d'étalonnage en collaboration avec le LAL.. Le groupe est également impliqué dans la réalisation et les tests des cartes de lecture ROD (Read Out Driver) permettant le traitement en ligne des données. Un physicien du laboratoire a la responsabilité du projet pour l'ensemble de la collaboration.
Le groupe informatique intervient aussi bien dans la mise au point des logiciels d'acquisition (pour le faisceau test et pour l’expérience finale) que dans le développement de logiciel d'analyse et de stockage des données brutes.
Le groupe participe à la qualification du calorimètre ainsi qu'aux différents runs tests combinés dans lesquels il assumer certaines responsabilités (on-line software manager par ex.). Un physicien du groupe assumera la coordination de ces tests en faisceau à partir de fin 2002. Les activités en mécanique du groupe devraient se réduire dès courant 2003 libérant ainsi des forces pour renforcer les autres équipes du laboratoire. Les efforts pourront dès 2003 se concentrer sur l'intégration du détecteur et la préparation de la phase d'analyse : il est donc essentiel pour ce groupe que le calendrier du LHC ne dérive pas au delà de 2007, ce qui pourrait être très démotivant.
Ø
CMS
Le groupe CMS du LAPP est composé de 11 physiciens, 13 ITA et 4 post-docs (à temps souvent très partiel) ; il a eu une contribution très importante et reconnue au sein de la collaboration dans la technologie de fabrication et de caractérisation des cristaux et des logiciels de simulations. Le groupe a participé au développement et à l'utilisation de plusieurs dispositifs expérimentaux afin d'étudier la tenue aux radiations des cristaux. Le groupe semble avoir souffert du manque de soutien local et du choix de la collaboration CMS concernant la calibration électronique : l'absence de renforcement du groupe par l'arrivée d'un jeune condamne ce groupe à disparaître avec les départs à la retraite prévus. Cela est d'autant plus regrettable que pour la phase d’analyse le laboratoire ne récoltera pas les bénéfices de cet effort et que l’expérience acquise dans l’instrumentation ne sera pas transmise.
Ø
LHCb
Le groupe LHCb du LAPP a été crée en 2001, il est composé de 5 physiciens dont 1 doctorant ; il devrait se renforcer par des mouvements internes. Le groupe a pris des responsabilités dans une partie de l'électronique de la chaîne de lecture des données issues des calorimètres. L'expérience n'étant pas encore complètement figée il reste encore la possibilité pour le groupe de prendre d'autres responsabilités en particulier sur la mécanique, ce qui ne devrait pas poser de problèmes pour le laboratoire compte tenu du fait que le service devrait voir sa charge de travail allégée par la fin de ses activités sur ATLAS.
1.4 Spatial :
Ø
AMS
L'expérience AMS est dédiée principalement à la détection d'antimatière dans l'espace, mais on pourra également détecter indirectement de la matière noire et étudier des objets astrophysiques extragalactiques à travers la détection des Gamma Ray Burst.
Le groupe est composé de 8 physiciens dont 1 post-doc CNRS et 2 doctorants. Le groupe a participé au vol test AMS-1 qui s'est déroulé en juin 1998 sur la navette Discovery. La version AMS-2 est fixée pour octobre 2005 sur l'ISS avec un vol Atlantis. La prise de données est prévue sur une période de 3 à 5 ans. Le groupe du LAPP est engagé dans la construction du calorimètre électromagnétique composé de plans de plomb et de fibres scintillantes : il a d’importantes responsabilités à la fois en mécanique (calcul, intégration et assemblage) et en électronique de lecture. Les tests sur faisceaux au CERN sont très encourageants. Le groupe étudie la faisabilité d’un trigger gamma stand-alone (utile en particulier pour les GRB). Le groupe composé essentiellement de physiciens des particules est conscient de ses lacunes dans le domaine de l'astrophysique et de la cosmologie, il souhaiterait un renforcement sur un poste interdisciplinaire.
Ø
EUSO
Le projet EUSO en est encore au stade d'étude et de définition jusqu'au printemps 2003; c'est un projet embarqué destiné à l'étude des rayons cosmiques d'énergie extrême (>1019 eV). Ces rayons cosmiques vont produire des gerbes dans l'atmosphère induisant une production de lumière fluorescente isotrope ainsi qu'une lumière Cerenkov dans la trajectoire de la gerbe. Le groupe du LAPP impliqué dans le projet se compose essentiellement de 3 physiciens dont un visiteur étranger et un doctorant avec le support technique d'un ingénieur et d'un technicien. Le groupe participe au projet au travers de l’étude de la surface focale et d'étude de simulations en particulier sur le bruit de fond et l'albedo de la terre, mais également en faisant des mesures de fluorescence. Le groupe est à l’évidence sous-dimensionné pour passer à la phase B et devra trouver des renforts.
1.5 Neutrinos :
Ø
NOMAD
L'expérience NOMAD dédiée à la
recherche d'oscillations neutrinos auprès du faisceau de neutrino du CERN s'
achève en 2002, 4 ans après la fin de la prise des données. Le LAPP s'est
impliqué très fortement dans l'expérience dès le début aussi bien dans la
construction du TRD (structure mécanique, électronique de détection du signal,
système de surveillance du détecteur,... ), que dans les logiciels de contrôle
et les programmes de simulation et d'analyse. L'activité Nomad étant terminée
au LAPP depuis un an, les physiciens se sont intégrés dans des expériences
existantes ou ont lancé de nouvelles activités.
Ø
OPERA
Le groupe est composé de 5 physiciens dont 1 doctorante, et bénéficie du soutien d'une équipe technique de 6 personnes. Le groupe a pour activités principales : la réalisation du manipulateur de briques et le développement de programmes de simulation et d'analyse. Le prototype réalisé par le groupe se fait en collaboration avec l'école d'ingénieur l'ESIA et l'IUT d'Annecy pour tout ce qui concerne l'automatisme. Le groupe aimerait se voir renforcé dans ses effectifs et avoir un soutien financier de l'IN2P3 aux proportions de sa contribution.
1.6 VIRGO
L'expérience VIRGO dédiée à la détection d'ondes gravitationnelles est un projet franco-italien impliquant différents départements du CNRS, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes de gestion et de communications auxquels les physiciens de l'in2p3 n'étaient pas habitués. Le groupe Virgo du LAPP est composé de 11 physiciens dont 3 doctorants et bénéficie d’un fort soutien technique (9 ITA, c’est à dire >20% du potentiel technique affecté aux expériences). Le groupe du LAPP a en charge :
- la construction des enceintes à vide qui depuis leur installation en 1999 ont subi des améliorations
- le système de détection installé en 1999 et testé en 2000 et 2001.
- la mise au point sur le site et l'acquisition des données, qui fonctionne depuis 2001 avec une assistance sur place
- la mise au point de logiciels d'étalonnage de l'instrument et d'analyse.
Malgré le retard, les premiers résultats sont encourageants et laissent espérer un début de prise de données sensibles courant 2003. Ils montrent aussi les limites actuelles et la nécessité de R&D pour des améliorations et la nécessité d’un fonctionnement en réseau mondial d’interferomètres.
Le travail du groupe est de très
haut niveau, il semble néanmoins que les groupes de l'IN2P3 souffrent d'un
manque de reconnaissance de la part de la collaboration VIRGO; ils ont
l'impression de n'être considérés que comme des prestataires de services. Il
est également regrettable que la communication ait du mal à passer au sein même
de l'IN2P3. Il serait souhaitable que des efforts de communication soient faits
aussi bien à l'intérieur de l'IN2P3 qu'à l'extérieur, dans la communauté
française et dans l'ensemble de la collaboration VIRGO.
2.
Les Groupes techniques
Excepté pour les services administratifs, les personnels techniques sont majoritairement affectés à une expérience.
2.1 Service informatique
Le service informatique compte 21 personnes (17 il y a 4 ans) réparties dans 3 catégories :
- le service général,
- le soutien aux expériences,
- les contrats et valorisation.
Le service a connu une évolution des personnels vers un niveau de qualification plus élevé (embauche ou promotion). Le groupe participe en soutien aux expériences et projets par la conception et l'écriture de logiciels en collaboration avec les physiciens. Il faut noter la présence dans le laboratoire d'un spécialiste de G3 et G4 dont la réputation dépasse les laboratoires français. L'administration des systèmes et des réseaux, le développement et l'installation des logiciels ainsi que la maintenance des équipements sont une part croissante de la charge du groupe qui demande le renfort par un AI. Concernant le réseau informatique le laboratoire possède une ligne 2MB avec le CERN qui représente dès maintenant une limitation. Il serait souhaitable que le LAPP possède une ligne haut débit compte tenu des responsabilités prises par plusieurs groupes concernant le développement et l'analyse de données dans les futures expériences LHC. Cette ligne HD est d'autant plus justifiée par la place de Tier A qu'occupe le CCin2p3 au sein de la collaboration Babar grâce en grande partie aux efforts fournis par plusieurs physiciens du groupe du LAPP. Le groupe participe également aux développements concernant la Grille à travers 2 personnes.
Le groupe possède un service infographie qui assure différents travaux de communication (photos, vidéos, archivage, conception de pages web, ...)
2.2 Service électronique
Le service électronique a connu en 4 ans une très nette diminution de ses effectifs passants de 24 postes à 20,5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (avec 14 départs et 11 arrivées). Le service est maintenant relativement jeune compte tenu des nombreux départs en retraite. Le service est subdivisé en 2 sous-services :
- le soutien aux expériences
- le service général : achats et CAO (6 personnes à temps partagés)
La baisse des effectifs, les nouveaux outils et la diminution des budgets de manière générale ont engendré une évolution du métier de l'électronicien : utilisation systématique de logiciels de simulation, plus de sous-traitance, moins de techniciens, plus d'investissement dans la formation permanente (400 jours de 99 à 02). Le laboratoire est centre expert FPGA depuis 10 ans. On note une certaine inquiétude et impatience concernant les retombées pour les équipes techniques des nouvelles expériences (LHCb) ou projets (EUSO).
2.3 Service mécanique
Le service mécanique compte un effectif de 17 personnes (5 IR, 1 IE, 4 AI, et 7 techniciens). Le service est structuré en projets et se répartit suivant 2 types d’activités :
- l'atelier (8 personnes)
- le bureau d'étude (9 personnes)
Tous les personnels du service sont à temps partagé entre les services généraux (CAO, documentation, gestion atelier, machines, labo, matériaux/vide) et le soutien aux expériences. Avec les tâches d’intégration, en particulier dans le spatial, on voit émerger un besoin d’élargir les compétences vers l’instrumentation d’une façon plus générale.
Courant 2003 le service va voir sa charge de travail sur ATLAS diminuer très fortement ce qui devrait permettre une prise de responsabilités dans les expériences LHCb ou/et EUSO.
2.4 Locaux, sécurité, entretien
Le laboratoire est relativement récent et par conséquent ne souffre pas de problèmes particuliers de mise en conformité. La réfection de la toiture suite à des malfaçons reste une préoccupation actuelle. Le comité d'hygiène et sécurité est composé de membres volontaires représentatifs de l'ensemble des personnels du laboratoire. Une réunion annuelle réunit l'ensemble des instances concernées (médecin du travail, inspecteur IN2P3, direction, services généraux, assistante sociale, ACMO et PCR) donnant lieu à un compte-rendu consultable par l'ensemble du personnel. Le service a travaillé à la mise en conformité des machines outils de l'atelier, au recensement et "recyclage" des sources radioactives, à la formation de secouristes, à l'élimination du halon, et plus spécifiquement à la gestion des risques liés à la cryogénie pour ATLAS (Argon liquide) et à la manipulation de lasers pour VIRGO.
À l'avenir le laboratoire et donc le SHS pourrait avoir à gérer les badges de radioactivité de son personnel, il est également prévu que d'ici 2010 les transformateurs au PCB soient éliminés
2.5 Service administratif et services généraux
Le service est composé de 16
personnes (15,2 équivalent temps plein en 2002 contre 16,4 en 1998) soit une
diminution de l'équivalent d'un poste et demi alors que la quotité de travail a
augmenté. Ce sont les services administratifs et financiers qui ont vu leurs
effectifs diminuer de 2 postes. On note une évolution des métiers et des
fonctions qui ont amené les services à se réorganiser, en particulier on peut
citer les problèmes posés par les réglementations concernant les marchés
publics très compliqués à gérer et pour lesquels le CNRS n'a pas prévu de
formation particulière. Le service administratif est relativement jeune et
mobile : les personnels ont pratiquement toutes changé de fonction en 5
ans.
3.
Projet de structure d'accueil LAPP-LAPTH
Le LAPP et le LAPTH ont de très fortes collaborations; en particulier dans le domaine de la physique des particules de hautes énergies, mais également en astrophysique. Des séances de travail et des ateliers sont organisés régulièrement par les expérimentateurs et les théoriciens des deux laboratoires. Certains travaux aboutissent à des publications communes. Depuis plusieurs années le LAPP "donne" au LAPTH un poste de visiteur étranger (phénoménologue) sur son contingent propre. Afin de préparer les expériences et l'analyse des données LHC, les deux laboratoires projettent la création d'un centre de rencontres thématiques ayant pour objectifs de renforcer la position française dans des thèmes tels que les extensions du modèle standard et ses conséquences expérimentales, la limite de basse énergie des cordes, les dimensions supplémentaires,... Un thème serait choisi chaque année par un comité ; des physiciens étrangers seniors et juniors seraient invités pour de longs séjours, ainsi que des physiciens des autres laboratoires français.
4.
Projet d'extension du site de recherche d'Annecy-le-Vieux
Le LAPP et l'ESIA (l'Ecole Supérieur d'Ingénieurs d'Annecy) présentent un projet commun d'extension du domaine scientifique universitaire d'Annecy le Vieux. La création de ce pôle régional d'excellence en mécatronique et management s'appuie sur le tissu industriel haut savoyard mais également sur la proximité du CERN. Le LAPP et l'ESIA ont déjà collaboré et échangé des expertises dans des projets tels que le mécanisme de changement des briques de l'expérience OPERA, mais également dans la mise au point des cristaux de l'expérience CMS. Cette collaboration se fait également par le biais de l'enseignement puisque 1 enseignant chercheur du LAPP effectue son service d’enseignement à l'ESIA, et que des ingénieurs et techniciens y dispensent aussi des enseignements.
5.
Valorisation et partenariat industriel
Les différents développements pour les expériences LHC ont permis au LAPP d'acquérir des expertises ( électronique, logiciels,...) reconnues par des partenaires tels que l' ESA, le CERN mais également par des industriels tels que Thomson ou des PME/PMI.
6.
Information, Vulgarisation et Culture Scientifique
Le LAPP participe très activement à la valorisation et à la diffusion de la culture scientifique par différentes actions :
- tous les deux ans le laboratoire participe à la "Science en fête" en accueillant dans ses locaux des classes de différents niveaux et le grand public.
- en intervenant dans les lycées
- en organisant plusieurs fois dans l'année l'accueil dans ses locaux de classes de différents lycées de la région et de groupes d'étudiants de l'IUFM.
- en participant à des émissions télé ou radio locales
Un groupe de physiciens travaille sur la mise en place d'une exposition permanente constituée d’éléments de détecteurs et de petites expériences de physiques.
7.
Entretiens particuliers
Quelques membres du groupe CMS s'interrogent sur l'absence de soutien local pour cette activité depuis le début, alors qu'il bénéficiait de celui de l'IN2P3 et de la collaboration.
On nous a également fait part de l'intérêt que portent ces mêmes personnes pour un projet de mesure de la durée de vie de l'orthopositronium nécessitant un faisceau pulsé de positons. Ce projet a été présenté en conseil scientifique du laboratoire en 2001 et a été refusé. Depuis, une première expérience a été faite au CERN et a donné lieu à une publication sans la référence du LAPP. Les promoteurs de ce projet souhaitaient son installation au LAPP avec des financements extérieurs (Région, Université de Savoie, Zurich,...). La direction, en accord avec le conseil, estime que le laboratoire n'a pas actuellement les compétences nécessaires pour jouer un rôle de leader dans ce projet.
8.
Rencontre avec le conseil de laboratoire
Les membres du conseil de laboratoire nous ont fait part du malaise créé au sein de l'ensemble du personnel par la manière dont l'IN2P3 a imposé l'application de la RTT.
Le jour de la visite des
représentants de la commission 03, le conseil de laboratoire n'avait pas encore
été consulté pour donner son avis sur le renouvellement de la direction. Le
directeur actuel, Jacques Colas, n'étant en place que depuis janvier 2000
et venait juste d'être informé par
l'IN2P3 que son mandat devait être renouvelé en même temps que l'unité, il
n'avait pas encore lancé la discussion dans le laboratoire sur son éventuel
renouvellement. On doit encore regretter à ce propos la pratique de la
direction de l’IN2P3 en ce qui concerne la procédure de nomination des
directeurs de laboratoire.
9.
Conclusions
Le LAPP est un laboratoire très dynamique. Le redéploiement des physiciens impliqués dans les expériences LEP a été très bien géré.
Les priorités scientifiques affichées par le laboratoire ont permis à l'équipe ATLAS de mener à bien ses engagements, et à l'équipe VIRGO d'aboutir aujourd'hui à la phase de commissionning de l'expérience. Par ailleurs il faut noter que l'ensemble des groupes du LAPP ont un impact visible et important dans les collaborations.
Les relations entre les groupes de physique et les groupes techniques sont coordonnées de façon satisfaisante. Le laboratoire a su tisser des liens avec les partenaires locaux qui permettent de fructueuses coopérations (LAPTH, ESIA, Université). La section 03 soutient vivement le projet de structure d'accueil LAPP-LAPTH, qui permettra de former et de préparer des physiciens français à l'arrivée des données LHC et de renforcer des échanges avec des phénoménologues en France.
Nous félicitons le laboratoire pour son fort taux d'accueil de stagiaires et doctorants, ainsi que pour son implication dans la diffusion de la culture scientifique vers le monde de l'enseignement (lycées, IUFM...) et le grand public.
Examen à deux ans du LPNHE Paris
Rapporteurs : G. Coignet, J.
Péter membres de la Commission 03.
1) Présentation Générale du Laboratoire
UMR (7585) CNRS/IN2P3- Paris VI/Paris VII
abritée dans les locaux de ParisVI.
-
Effectifs
Chercheurs : 27 CNRS, 20 Enseignants-Chercheurs, 18 Doctorants, 7
Post-Doctorants ou Visiteurs Etrangers
, 10 Emérites et bénévoles.
soit au total 82 personnes en recherche.
Pendant
les 3 dernières années il y a eu 6 départs en retraite et
6 recrutements : 3 au CNRS (dont 1
section 14) et 3 Maîtres de Conférences
.
Ils ont été affectés de la manière
suivante :
1 BABAR,
1 D0, 2 ATLAS, 1 AUGER, 1 HESS.
De
plus, 2 CR (F.Fleuret et F.Hubaut ,
ATLAS ) sont partis et 2 CR sont arrivés : B. Andrieu (D0) et
P.Antilogus
( Supernovae)
Services Techniques : Ingénieurs et techniciens: 18 en
Electronique , 12 en Informatique, 11 en Mécanique, Total = 41 personnes.
Administration / Gestion et Services
Généraux = 9 et 4 Personnes ,
respectivement.
Malgré de nombreuses rotations de
personnels, le nombre des ITA s’est amélioré mais reste encore limité.
Total général : 134 personnes
-
Budget
Le
budget du laboratoire , 13350 KF ( 2035 Keuros ) en 2001 en incluant les
Autorisations de Programme, dont 6670 KF (1010 Keuros) pour le budget de
fonctionnement, est principalement attribué par l’IN2P3. Paris VI et Paris VII
contribuent au niveau de 350 KF (53 Keuros) et les ressources propres sont au niveau de 290 KF (44 Keuros). Une
partie importante des dépenses concerne
les missions, 3490 KF ( 520Keuros) en
incluant les vacations et les visiteurs étrangers, dont
3250KF(495 Keuros) en missions seules.
Ceci est du au fait que le laboratoire effectue ses recherches dans des sites
situés dans le monde entier : CERN, SLAC, Fermilab, Namibie, Argentine,
Hawaï…
Il
est a remarquer que le soutien de base qui était en diminution les années
précédentes est revenu à un niveau acceptable.
- Les Conseils:
le Laboratoire est doté d’un Conseil Scientifique, un Conseil de laboratoire,
d’une Commission Paritaire des ITA et récemment
d’un Comité d’Hygiène et Sécurité. Chacun
se réunit en moyenne 2 fois par an.
-
Rapports avec Enseignement Supérieur
Le LPNHE continue à être très bien
implanté dans ses universités de
tutelles .Un trentaine de membres donnent des enseignements à Paris VI ( Pierre
et Marie Curie) et Paris VII( Denis Diderot):
Il
est site d' accueil pour 4
formations de 3ieme cycle: DEA Modélisation et Instrumentation en Physique, DEA de Physique et Technologie des Grands
Instruments, DEA s Champs, Particules
,Matière , DESS Physique des Capteurs et Systèmes de Mesure . Ceci se traduit
par un bon quota d’étudiants en thèse, avec en particulier 7 nouveaux thésards
cette année.
La création de l’APC à Tolbiac , qui avait
suscité quelques craintes ne semble pas poser de problème.
En
effet, pour le moment , un seul Enseignant-Chercheur, avec un doctorant, ont exprimé leur intention de déménager et la mutualisation de la mécanique semble
^etre pérennisée . Toutefois le LPNHE
souhaite garder ses liens forts avec Paris VII, ce qui ne semble pas être remis
en question par cette université .
- Vie scientifique.
2) Les Groupes de Recherche
Physique sur
accélérateurs
-
D0 à
FNAL
Ce groupe a
rejoint l’expérience D0 en 1998. Il a cru de 2 à 4 chercheurs permanents et de
2 à 3 doctorants depuis la précédente visite de la commission 03 (automne
2000).Sous la responsabilité de G. Bernardi, il est composé de 3 CNRS, 1
Enseignant-Chercheur (recruté en 2001), 1 Visiteur Etranger et 3 Doctorants.
Après avoir
eu en charge la conception et la réalisation du système de calibration
en ligne du Calorimètre Electromagnétique, il contribue à cette calibration en
collaboration avec le LAL.Il a des responsabilités hors ligne ldans l’identification des électrons ainsi que dans la
reconstruction des jets et de l’énergie manquante (suppression des cellules bruyantes) .
Dans les données du Run II, qui a débuté en 2001, le
groupe s’intéresse plus particulièrement à la physique du top ainsi qu’ aux
recherches du quark stop et du boson de Higgs.
Le potentiel de physique et prometteur et c’est aussi
une bonne préparation pour la physique au LHC.
Le groupe doit veiller à sa liaison avec le groupe
ATLAS.
-
BABAR
à SLAC
Ce groupe ,dirigé par J.Chauveau, comprend 5 CNRS, 5
Enseignants –Chercheurs, 2 doctorants et 1 Visiteur Etranger. Il est resté
pratiquement stable malgré le départ de 3 de ses membres.
Il a joué un rôle important dans l’électronique du
DIRC : En particulier , suite a un bruit de fond de la machine plus élevé
que prévu, il a du développer et produire une nouvelle version de TDC en un
temps très limité. Cette nouvelle électronique est opérationnelle sur
l’expérience depuis le début octobre,
prête pour le redémarrage de l’accélérateur. En plus du rôle assuré par certains de ses
membres pendant la prise de données, il a aussi la responsabilité de la
production Monte Carlo (15 % du total) au CCIN2P3.Les analyses concernent les
désintégrations des B en hadrons chargés ou neutres, la durée de vie du tau et
plus récemment, avec la montée en luminosité, les désintégrations rares du B.
Le cout des missions, déjà mentionné en 2000, reste
un problème pour ce groupe qui a
exprimé le souhait d’obtenir un renfort
CNRS.
-
ATLAS au CERN
Le groupe, dirigé par P.Schwemling, comporte
actuellement 9 personnes : 3 CNRS,
3 Enseignants-Chercheurs, 1Visiteur Etranger, et 2 doctorants. Il a été
renforcé en 2002 par l’arrivée de 1 CR2
(F. Derue) et
1 MC . C’est un groupe jeune, avec une moyenne d’age de 31 ans.
En mécanique
il est fortement impliqué dans la construction du Calorimètre
Electromagnétique: Métrologie des plaques de plomb et absorbeurs, tests des
électrodes , intégration, base de donnée de production. L’assemblage du premier demi-tonneau s’est terminé fin
septembre 2002.
En
électronique le groupe a en charge la production pour mi 2003 de 135 cartes de
contrôleur de châssis ainsi que des liens de contrôle série SPAC de ce
contrôleur. Courant 2003 un test du châssis complet est prévu au BNL.
Enfin,
l’équipe a participé au CERN aux tests en faisceau de 4 modules du tonneau.
En
ce qui concerne la physique, le groupe s’intéresse à la mise en évidence
possible de Dimensions Supplémentaires.
Une solution devra etre trouvée pour la
gestion de la base de données de
production du calorimètre car l’ingénieur en charge prendra prochainement sa
retraite.
Dans
les discussions privées les problèmes liés au retard du LHC sont mentionnés.
-
DELPHI
et Collisionneur Linéaire
Cette équipe
regroupe 3 CNRS, 3
Enseignants-Chercheurs, et deux
Doctorants. Il est constitué essentiellement du groupe DELPHI, dirigé
par M. Baubillier, qui termine ses analyses sur la fragmentation du quark b et
la recherche du quark stop (2 sujets de thèse) .Dernièrement
elle s’intéresse à la production de paires de quarks
charmés et beaux dans les collisions gamma-gamma à LEP.
Ce groupe qui naturellement s’intéresse à la physique
des Collisionneurs Linéaires e+ e-, vient de lancer, sous la responsabilité de
A. Savoy-Navarro, une activité de Recherche et Développement sur les détecteurs
de traces au Silicium. Il effectue également des simulations d’évènements
produits dans les collisions gamma -gamma à plus haute énergie.
On peut noter que la réorientation progressive des
activités de l’ensemble du groupe
s’effectue sans dispersion, comme demandé
-
HARP/NEUTRINOS
au CERN
Ce petit groupe a conservé le même effectif de
permanents : 1 CNRS, 1 Enseignant-Chercheur,1 Visiteur Etranger, et 2 doctorants ,sous la
responsabilité de F.Vanucci et J. Dumarchez , s’intéresse à la production de
hadrons dans les collisions de protons de 2 à 24 GeV sur différentes cibles. Ces mesures sont utiles pour
améliorer la connaissance des données nécessaires aux projets de sources de
neutrinos intenses ainsi que pour les neutrinos atmosphériques. Le LPNHE a
contribué à cette expérience en
assurant les modifications puis le fonctionnement de 20 chambres à dérive préalablement utilisées
par l’expérience NOMAD. L’expérience est maintenant terminée. Les données ont
été collectées en 2001 et 2002 , et leur analyse ,qui a pris du retard,
commence avec pour but initial d’en tirer les informations utiles aux
expériences K2K et MiniBoone. Il faut veiller à ce que les Doctorants puissent
terminer leur thèse dans de bonnes conditions et que les résultats ne tardent
pas trop .
{ Le futur des expériences neutrinos au LPNHE devra
être discuté au CS du laboratoire si une proposition actuellement en gestation
voit le jour.}
Physique hors Accélérateurs
-
HESS
en Namibie
Ce groupe dirigé par P.Vincent, est également constant
en permanents : 1 CNRS, 2 Enseignants-Chercheurs, 1 Visiteur Etranger et 2
Doctorants .Il s’intéresse à la détection de photons Cerenkov émis par les
particules chargées produites lors de l’interaction de photons primaires avec
l’atmosphère. Le site, dans
l’hémisphère sud
en Namibie,
doit être équipé de 4 télescopes dans sa Phase I. Chaque télescope comprend une
caméra avec 960 photomultiplicateurs.
En 2000-2001 le laboratoire a assuré la conception et la production des
cartes électroniques pour la première caméra et a assuré son assemblage . Le groupe a aussi pris des responsabilités dans l’acquisition
des données, la gestion des bases de données et le contrôle à distance.
La première caméra
a été installée en juin 2002. Le taux d’acquisition étant plus élevé que
prévu une nouvelle carte doit être produite. La seconde caméra devrait être
installée sur le site fin 2002-début 2003, les 3ième et 4ième
caméras venant ensuite.
Ce groupe
de jeunes chercheurs a bien tenu ses engagements au niveau technique et l’on
peut espérer qu’il puisse maintenant commencer à s’investir dans l’analyse des
données.
-
AUGER
en Argentine
Le groupe , sous la responsabilité de A.
Letessier-Selvon, comprend 5 permanents : 3 CNRS, 2 Enseignants-Chercheurs
dont le responsable d’AUGER-France et 2 Doctorants . Il s’intéresse aux
évènements cosmiques de Ultra Haute Energie à l’aide d’un système de détection hybride (Cerenkov et fluorescence)
. Dans une première phase un ensemble
de 40 cuves, disposées sur une surface de 3 Km2 ,est opérationnel depuis l’été
2001. C’est la première étape d’un ensemble qui devrait avoir une surface
finale d’une centaine de Km2(1600 cuves).
Le LPNHE a des responsabilités dans le système
d’acquisition centrale, en particulier avec le physicien-responsable, et dans
les logiciels de reconstruction des évènements. Actuellement une centaine
d’évènements ont été observés. Les sujets de physique considérés par le groupe
concernent la physique des canaux rares : Neutrinos et gamma d’Ultra
Hautes Energies.
-
SUPERNOVAE
Ce groupe , qui s’est renforcé de 3 permanents au cours de ces 2 dernières
années, comprend 5 CNRS,dont
P.Antilogus en provenance de l’IPNL, 3 Enseignants-Chercheurs, 1 postdoc,
et 3 Doctorants. Il s’intéresse à la mesure du diagramme des
supernovae Ia afin d’accéder à l’histoire de l’expansion de l’univers. Il est
dirigé par R.Pain. qui est aussi le coordinateur au niveau français.
Après avoir participé à la mise en évidence (SCP,
grand z) d’une « énergie sombre » responsable d’une accélération de
l’expansion de l’univers, le groupe est engagé, avec d’autres laboratoires de
l’IN2P3, l’INSU ,le CEA et américains ,
dans un programme de cosmologie
observationnelle qui a pour but
d’essayer de comprendre la
nature de cette énergie sombre :
- SNFactory
(petit z), CFHTLS/SNLS (diagramme de Hubble) avec des télescopes au sol 2003-
2007 ;
- SNAP
(diagramme de Hubble) dans l’espace à partir de 2007 permettant l’accès aux
grands z.
Le groupe du
LPNHE a développé une chaîne logicielle permettant de mesurer le flux et les
quantités sidérales des candidats à partir des données brutes et il contribue à
la recherche et la photométrie des SNIa. Il participe (mécanique et logiciels
de lecture) à la préparation d’un spectrographe grand champ qui sera
installé sur le télescope d’Hawaï . Il développe une activité R et D sur
l’électronique de lecture qualifiée spatiale pour le spectrographe de SNAP.
Malgré ces divers projets, correspondant toutefois à
un programme cohérent, le groupe semble s’être bien adapté à cette sociologie
différente et y jouer un rôle moteur.
-
THEORIE
Depuis 1998 un petit groupe de 5 chercheurs ,
dont 2 CNRS de la commission 02, et 2
Professeurs à la retraite sont hébergés dans des locaux supplémentaires mis à
disposition par l’université de Paris VI. Ils travaillent à la QCD chirale et la QCD non -
perturbative. Dernièrement ils se sont intéressés à la phénoménologie des
mésons B , un domaine qui pourrait , en principe, leur permettre
d’interagir avec leurs collègues du LPNHE (Babar en
particulier).
3) Les Services
-
MECANIQUE
L’équipe, dirigée par D. Imbault, s’est renforcée
depuis l’automne 2000 . Elle comprend 11
personnes, dont 1 CDD. Elle contribue aux programmes expérimentaux au
niveau des études à l’aide de logiciels performants, des réalisations et de
coordinations.
L’activité sur ATLAS (métrologie, bancs de tests,
intégration du Calorimètre Electromagnétique) qui représentait 80% de celle du laboratoire et en
décroissance depuis le début de 2002 et ne devrait plus représenter qu’environ
10% en 2003. Elle est compensée par les contributions
- au
programme des Supernovae ( coordination et fabrications pour SNIFS )
représentant environ 50% jusqu’en en
février 2003 pour se stabiliser probablement
a environ 30% .
- et au programme SET de R et D sur les détecteurs au
Silicium pour Collisionneur Linéaire.
Il faut noter que le responsable de l’équipe coordonne aussi la « mutualisation LPNHE-PCC« des activités de mécanique (15 % de volume de travail). Le LPNHE souhaite pouvoir maintenir au laboratoire une équipe de la taille actuelle . Pour un avenir proche, il soutient l’utilisation commune avec l’APC du Hall de montage prévu à Tolbiac
-
ELECTRONIQUE
:
Depuis
l’automne 2000, cette équipe a eu un renfort
de 2 personnes et un départ en retraite compensé par un AFIP.C’est la plus
grosse équipe du laboratoire: 18 personnes , dont 2 CDD. Elle est placée sous
la responsabilité de H. Lebollo. Elle est bien équipée en logiciels et matériel
de CAO. Elle fournit ou a fourni des
contributions à tous les groupes du laboratoire(y compris polarimètre de H1
jusqu’en 2001). Elles concernent
l’analogique , le numérique, ainsi que différentes technologies: composants discrets, circuits
intégrés. Elles sont balançées entre
les phases de développements, de
productions et d’adaptations en fonction des demandes expérimentales.
Depuis 2000 l’équipe
a eu un renfort de 2 personnes pour un départ en retraite compensé par 1
AFIP.
-
INFORMATIQUE
Ce service sous la responsabilité de E. Lebreton
comprend 12 personnes. 6 sont affectées au service local, (réseau, serveurs,
Sécurité, back-up …) , 6 au soutien aux expériences (développements
détecteurs/donnés , Datagrid) . Certaines personnes contribuent aux deux
activités.
Des problèmes concernant le matériel (différences entre les serveurs pour les
expériences ) sont mentionnés. Le
service reçoit l’aide de 5 stagiaires mais un manque
d’informaticiens est ressenti pour le support aux expériences (Supernovae, D0, Harp ) . De plus 2 départs
à la retraite sont prévus d’ici fin
2003.
-
Administration et
Services Généraux
Cette
équipe , sous la responsabilité de E. Méphane depuis 2000 comprend 9 personnes qui s’occupent de la gestion
administrative du personnel (IN2P3/ Paris VI et VII) et de la gestion
financière(Achats et Missions) ; Deux outils différents sont
utilisés : XLAB et NABUCO( Paris VI) qui ne facilitent pas cette gestion.
L’équipe fournit un soutien administratif aux enseignements de DEA, à
l’organisation de séminaires et manifestations et de la bibliothèque .
Le rapport d’activité 2000-2001 vient de paraître et
il est aussi disponible a la page web du laboratoire.
Un problème récurent, soit le manque de personnel
pour la gestion de la bibliothèque est mentionné. Peut être pourrait-il être
résolu dans le cadre d’une « mutualisation » avec l’ APC . Plus
sérieux encore semble être le fait que 6 départs sur les 9 personnes sont prévus dans les 3 prochaines années . Des
solutions devraient être anticipées.
-
Locaux et Sécurité
Une
équipe de 4 personnes, dont 1 à 50% et
1 CDD, s’occupent de l’entretien des
3900 m2 actuellement disponibles. Ces dernières années , entre autres,
une 2ième salle d’Informatique et une salle de vidéo-conférence ont
été créées en plus de travaux de réfection. Avant la fin de l’année 2002 de
nouveaux locaux désamiantés (barre
32/42) seront échangés avec une partie des locaux actuels ( 23/33 et T12) ce
qui devrait rendre la géographie du laboratoire plus homogène au prix d’une
perte de quelques 75 m2.
Il
faut également signaler la mise en place en 2001 d’un Comité d’Hygiène et
Sécurité qui n’existait pas lors de la visite précédente de la commission 03.
4) Conclusions
Le
LPNHE Paris VI,VII confirme, comme il avait
été remarqué lors de la visite précédente de la commission 03, qu’il est
un très bon laboratoire regroupant du personnel de qualité. Il est engagé à la fois dans des programmes de physique
sur accélérateurs (Babar, Harp, D0,
ATLAS , Lin Coll.) et hors accélérateurs ( Auger, Supernovae, HESS) dans
lesquels il a des contributions significatives et parfois prépondérantes . Le
programme est bien équilibré entre expériences en prise de données, qui
démarrent ou en préparation. Ces expériences attirent un nombre important de
doctorants , ce qui est aussi certainement dû à la très grande implication des
Enseignants-Chercheurs au niveau des DEA des Universités Paris VI et VIII. Un
problème éventuel pour le long terme pourrait
peut être venir de la grande
dispersion géographique des sites expérimentaux des expériences auxquelles le
LPNHE participe et on devra être y attentif dans le futur.
Les
services techniques , malgré le grand
roulement du personnel de ces dernières années , ont fourni des contributions de qualité et ont assuré leurs responsabilités. Les effectifs
sont revenus, grâce à l’aide de l’IN2P3 à des niveaux corrects. Il faudra
toutefois anticiper les départs à la retraite qui se profilent.
Enfin,
la création de l’APC –Tolbiac qui avait suscité des craintes ne semble pas poser
de problème actuellement. Il est souhaitable que la « mutualisation
« partielle des services de mécanique qui se pratiquait avec le PCC
soit poursuivie avec l’APC. L’IN2P3 et la commission 03 devront veiller, avec
les moyens dont ils disposent , à ce que cette situation , ainsi que les
contacts avec Paris VII en général, perdure.
examen à 2 ans du LLR
J. Dumarchez,
A. Rozanov
Introduction
La visite s'est déroulée le jeudi 10/10
dans le cadre de l'examen à 2 ans. Elle a permis, après un entretien
introductif avec la direction, de faire le tour des groupes de physique et des
services techniques et administratif. L'impression générale est très positive:
une bonne visibilité des équipes et des moyens en adéquation.
Le LLR comprend 97 personnes, dont 39
chercheurs et 58 ITA. Si le nombre de chercheurs est stable, avec un
recrutement CNRS par an en moyenne, la diminution d’une dizaine de personnes en
6 ans de l’effectif ITA est préoccupante et ne saurait se poursuivre sans
remettre en cause la qualité du programme de recherche. Le faible nombre de
thèses est un problème persistant et l’absence d’enseignants chercheurs est à
noter (bien que un quart environ des chercheurs enseignent, majoritairement
dans les Grandes Ecoles).
Le budget poursuit sa lente
décroissance pour ce qui concerne le soutien de base, de même que la part Ecole
Polytechnique, qui peut en plus s’avérer erratique ! Les ressources
propres sont faibles, hormis les crédits GLAST en ce moment.
1. Les groupes de
physique
1.1 H1
Le groupe H1 du LLR, présent dans
l’expérience depuis sa conception, est actuellement composé de 4 physiciens,
mais pas de doctorant. Le programme de physique se présente comme une fenêtre
complémentaire au Tevatron, en particulier sur la recherche de nouvelles
particules, mais reste unique sur l’exploration fine de la structure du proton
et de QCD. L’activité du groupe ces 2 dernières années s’est inscrite dans le
programme d’amélioration du détecteur en vue de la haute luminosité : la
réalisation du luminomètre et de son électronique associée (en collaboration
avec le LPNHE et le LAL) a nécessité une forte implication des physiciens mais
aussi des ingénieurs (électroniciens et informaticiens). Son installation
courant 2001, avant les premières collisions, a été suivie d’une période de
mise au point et d’améliorations (acquisition et analyse) encore en cours, pour
arriver à la précision requise de 1%, avant le printemps 2003. La maintenance
sera ensuite assurée par des russes de Moscou.
Le programme de physique à venir est très
riche et on doit regretter que le groupe n’ait pas pu accueillir de thésard
dans cette phase privilégiée de l’expérience.
1.2 BaBar
Le groupe BaBar du LLR est également
présent dans l’expérience depuis ses débuts, avec une participation visible
tant du côté détecteur (électronique, HT et slow-control du DIRC) que du côté
simulation et analyse. Sa reconnaissance en terme de postes de responsabilité
dans la collaboration BaBar et dans as composante française est remarquable.
Son impact sur la formation des jeunes (19 stagiaires et 4 thésards depuis
1994) ne se résume pas au caractère attractif d’une expérience en prise de
données : il est le résultat d’une action constante auprès des maîtrises,
DEA et écoles d’ingénieurs. Les canaux d’analyse privilégiés par le groupe (B
-> J/Psi Kstar) lui ont permis d’avoir une contribution originale, y compris
dans la détermination de sin(2beta) et
cos(2beta).
Le soutien du laboratoire est constant
mais le groupe souhaiterait un renfort en physicien, après un départ en retraite
et un détachement (G. Bonneau, représentant CNRS à Washington).
1.3 CMS
Le groupe CMS du LLR est engagé dans la
construction du calorimètre électromagnétique à cristaux. Le groupe comprend
actuellement 8 physiciens CNRS, 1 post-doc et un visiteur étranger. Il reçoit
un soutien fort du laboratoire et de ses équipes techniques : la
réalisation des structures mécaniques destinées à maintenir les cristaux
s’achève ; l’électronique reste sur le chemin critique (son design a été
profondément modifié par la collaboration début 2002) : le laboratoire est
centre test pour un tiers des cartes du front end digital et participe aussi –
entre autre – à l’étude du transfert des données et à la calibration des
senseurs de température ; contributions à l’informatique générale à
travers un outil de validation de programmes ou la participation aux tests de
Grille et de production d’événements (data chalenge 2003). La préparation à la
physique se fait par la participation à la rédaction du TDR, en particulier sur
le canal du Higgs -> 4e et sur la recherche de dimensions supplémentaires.
Il semble que la situation se soit
assainie depuis 2 ans dans les relations avec le management de la collaboration
. Par contre le problème de l’absence de thésard persiste.
1.4 FLC
En parallèle avec une fin d’activité
d’analyse sur les taus dans ALEPH, le groupe s’est fortement engagé dans
l’étude d’une calorimétrie fine W-Si pour une expérience auprès du futur
collisionneur linéaire, dont le principe et la priorité ont été reconnus au
niveau mondial, et dont l’implantation pourrait se faire en Allemagne (TESLA).
A l’origine de cette proposition de calorimètre, le groupe a pris la direction
d’une collaboration internationale (CALICE) de recherche et développement sur
ce projet. Le groupe travaille d’une part sur la simulation et la
reconstruction pour valider le concept, qui permettrait de séparer les bosons
par une reconnaissance de jets plus précise qu’au LEP. Il intervient d’autre
part sur les études générales de mécanique (y compris via la construction de
prototypes) ou sur l’étude de matrices
de silicium (en collaboration avec un autre laboratoire de l’X, le PICM). Il
s’intéresse aussi à la possibilité d’une lecture purement digitale du
calorimètre hadronique.
Le programme est très ambitieux et le
groupe devrait donc être renforcé (il est d’ailleurs fortement demandeur d’un
recrutement CNRS).
1.5 Phénix / NA50
Après une participation décisive à
l’expérience NA50 du point de vue du hard, de la maîtrise du faisceau et
surtout des outils d’analyse et de l’analyse elle-même, l’essentiel du groupe
s’est tourné vers l’expérience Phénix à BNL. En effet suite au refus de l’IN2P3
de participer au financement de NA60, seule une activité de soutien ponctuel
(détecteur et trigger) y sera possible. Une activité d’analyse, en particulier
sur le psi’ et sur la production de charmonium est cependant encore en cours
sur les données de NA50. Sur Phénix, la contribution française porte sur le
bras muon nord, en collaboration avec les coréens. La participation du LLR se
concentre sur l’électronique front-end. La production (1125 cartes) est sous
traitée dans l’industrie, mais les tests et l’installation est à la charge du
groupe, qui a aussi hérité de la maintenance du bras sud, non prévue
initialement. Cette activité a mobilisé 3 ingénieurs électroniciens et 2
physiciens. Le soutien en informatique a été moins conséquent, par manque de
forces. Une étude de trigger de niveau 2 est néanmoins envisagée.
Le travail d’analyse a déjà commencé
sur les premières données enregistrées en 2001 et avec l’arrivée d’une
thésarde. L’activité du groupe est bien définie jusqu’en 2006.
1.6 Astronomie Gamma
Le programme s’articule autour de 2
expériences en cours (CAT et CELESTE) et 2 projets (HESS et GLAST). Y
participent 7 physiciens CNRS, un doctorant et un visiteur étranger. Une forte
composante du service de mécanique a rendu possible les engagements pris sur
chacun de ces projets.
Malgré des conditions météo moins
favorables que prévu à Thémis, les expérience CAT et CELESTE ont pu poursuivre
leur programme. CELESTE est passée à 53 héliostats et le groupe a dû procéder à
des améliorations (FADC, monitoring ...) pour compenser une sensibilité moins
bonne que prévue. CAT a pu observer Mk501 simultanément avec BeppoSax (X) et
EGRET (gamma<10 GeV) et confirmer l’effet compton inverse dans le spectre.
Après des participations techniques importantes (mécanique), le groupe se
limite maintenant à la prise des données et à l’analyse.
HESS dans sa phase 1 prévoit
l’installation de 4 télescopes en Namibie. Le LLR fournit en particulier la
mécanique des caméras (actuellement 1 installée, et 1 en montage à Paris). La
participation française d’une façon générale est importante sur le hard de
l’expérience, mais les 3 groupes étant de taille modeste, leur poids dans
l’analyse n’est pas acquis et demande un investissement important, soutenu et
un renfort à court terme.
La participation à GLAST est une
première incursion dans le spatial. Là aussi le groupe intervient au niveau de
la mécanique du calorimètre, dont le design a été accepté par la collaboration.
18 tours seront construites d’ici 2004, accompagnées de tests en faisceau et en
avion. Un ingénieur informaticien contribue également à l’adaptation
d’algorithmes de clusterisation dans le cade GAUDi (venu de LHCb). L’activité
soft en France se trouve déséquilibrée par le retrait du groupe du PCC.
Une constatation reste d’actualité pour
l’ensemble des activités du groupe d’astronomie gamma : malgré des
contributions importantes dans les 4 expériences et une cohérence des thèmes de
physique visés et malgré l’arrivée d’un CR1 en 2001, le renfort du groupe
paraît nécessaire.
2. Les groupes
techniques
2.1 Service administratif
Le service est en sous effectif
persistant : passé de 10 personnes en 1996 à 6 personnes en 2002, son
fonctionnement est constamment critique et se trouve gravement perturbé en cas
de maladie ou de congé ; Cette situation n’est plus viable, au point que
la priorité absolue du laboratoire est le recrutement d’une personne au moins
pour ce service.
2.2 Service d’électronique
Après une période d’intérim et de
concertation assurée par F. Moreau, la direction du service est maintenant
revenue à un ingénieur électronicien, dans une situation aplanie. L’effectif
est stable (14 au 01/01/03 avec l’arrivée d’un IR) et correctement réparti en
âge. Le plus gros de l’activité porte sur l’expérience CMS�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������, où le service est
présent dans toute la chaîne du calorimètre, hors front-end. C’est d’ailleurs
peut-être là que se situe une relative faiblesse du service, qui souhaiterait
se renforcer par le recrutement d’un ingénieur spécialiste de front-end. Le
niveau de formation permanente est très bon, la participation aux écoles
thématiques (enseignants et stagiaires) importante, et le service accueille
souvent des stagiaires et même des thésards (2). La question d’une mise en
commun de compétences ou de matériels avec d’autres laboratoires de
Polytechnique ne se pose guère : ils ne disposent en général que de 2 ou 3
ingénieurs.
2.3 Service informatique
Le service s’est restructuré suite à
plusieurs départs. Les services généraux mobilisent 5 personnes: un
effort d’uniformisation des matériels a été fait pour réduire un peu la charge
sur ce service très exposé. Le développement de logiciels pour les expériences
concerne 10 personnes, qui interviennent souvent dans le développement d’outils
généraux (OVAL, ORCA, I/O, graphique ...) permettant aux groupes
expérimentaux de peser d’un poids
conséquent dans la préparation à l’analyse. Le besoin de renforcer les
compétences en on-line / temps réel, en collaboration avec le service
d’électronique (IR), se fait sentir. Le bouleversement attendu des méthodes de
travail avec l’introduction des techniques de contrôle qualité et le niveau de
participation à DataGrid seront des sujets d’attention pour l’avenir.
2.4 Service de mécanique
Le service est passé de 18 à 15 personnes (13 permanents et 2 CDD) en 4
ans. Il est structuré en projets et divisé en 3 sous-services (atelier, bureau
d’étude, instrumentation et projets). On y sent une évolution des métiers par
le recours à la sous-traitance (dans CMS par ex., après l’étape proto, il y a
eu transfert vers l’industrie et le service a gardé la responsabilité sur les
non conformités) et par l’irruption des techniques spatiales (GLAST) et
l’utilisation plus fréquente de matériaux composites. On a pu ressentir une
certaine appréhension de divergences des compétences dans le service, mais
aussi des à-coups de la programmation de la charge de travail en fonction de la
vie des projets. Il faut toutefois signaler que ce service a une excellente
réputation à l’extérieur.
2.5 Personnels de l’Ecole Polytechnique
Le problème des statuts des personnels
dépendant de l’X, en contrat CDD, reste non résolu à ce jour. Le nouveau statut
est maintenant annoncé pour le premier trimestre 2003. Nous ne pouvons que
renouveler notre consternation devant un comportement administratif qui
continue d’afficher un tel mépris de la loi et des personnes.
Conclusion
Le LLR est un laboratoire au programme
scientifique bien équilibré, aux équipes dynamiques et aux responsabilités
importantes. Les moyens techniques sont en bonne adéquation avec les besoins
des expériences.
Parmi les questions repérées comme
devant être surveillées par le précédent examen, la structure du groupe
d’électronique est maintenant bien établie et reconnue et son fonctionnement
s’en trouve apaisé.
Par contre la nécessité d’au moins un
poste supplémentaire d’administratif est plus que jamais vérifiée. Le faible
nombre de doctorants persiste et affecte presque tous les groupes : il
nous semble qu’une démarche doit être entreprise et maintenue dans la durée
pour espérer inverser cette tendance. Enfin le problème du statut des
personnels de l’Ecole Polytechnique doit absolument trouver une solution
acceptable.